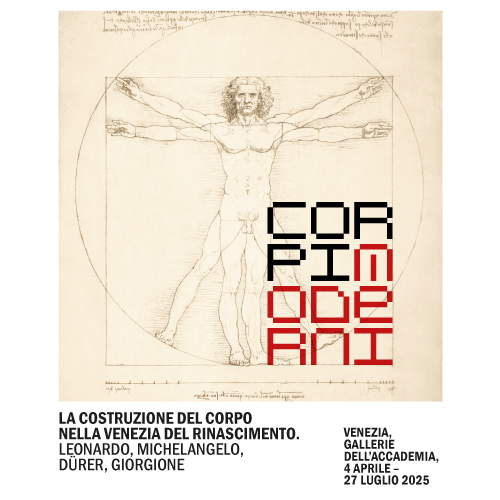Si le Van Gogh de la télévision est Alberto Angela, alors l'île de la tentation est bien là.
Commençons par le tableau d’ensemble : des années d’études, d’expositions, de livres, d’articles et d’activités diverses pour briser tous les stéréotypes sur Vincent van Gogh, pour transmettre au public l’idée que la figure de Van Gogh était un peu plus complexe que celle du génie fou à l’âme sensible que personne ne comprenait, pour redonner une ombre de dignité à l’artiste le plus banalisé de l’histoire, au sempiternel des expositions à guichet, à l’idole de millions de téléspectateurs qui, sur les réseaux sociaux, mettent du cœur dans ses œuvres quand leur propre cœur est touché. pour redonner une ombre de dignité à l’artiste le plus banalisé de l’histoire, à l’éternel des expositions en salle, à l’idole de millions de téléspectateurs qui mettent leur cœur sur ses œuvres quand leur influenceur les leur montre sur les médias sociaux, mais s’ils l’avaient eu comme voisin, ils auraient déjà appelé la police, déposé une pétition auprès du conseil de quartier, alerté les caméras de Rete4. Des années de travail qui commençaient à porter leurs fruits : la dernière vague d’expositions sur Van Gogh que nous avons eue en Italie (celle de Rome, celle de Milan et celle de Trieste) allait dans cette direction. Et voilà qu’arrive Alberto Angela, avec son Van Gogh de première heure. Comme l’ami malicieux qui souffle sur le château de cartes. Malgré les assurances données à la veille de l’émission, assorties d’hyperboles (“les lettres sont peut-être plus intéressantes que les tableaux”), le programme d’Angela n’a pas dérogé d’un iota à toutes ces conventions que le chantre de la vulgarisation lui-même avait plus ou moins explicitement promis de contourner.
Plus de deux heures pour raconter la vie de Van Gogh, en commençant par la fin et en revenant en arrière. De tout cet échantillonnage, Alberto Angela ne nous épargne rien : l’oreille coupée, la famille qui ne le comprend pas, l’attachement à son frère, l’entrée à la clinique, les méthodes des médecins pour le soigner, etc. L’art ? On n’en a vu que très peu. En revanche, Angela nous a montré des expositions immersives utiles, des images fondamentales de tournesols projetées sur les murs des carrières des Baux-de-Provence, des animations incontournables qui font voler des corbeaux au-dessus des champs de blé peints par Van Gogh. Et puis, entre une Angela déambulant et gesticulant sur les arches du Pont du Gard et un Recalcati qui, en lien avec l’exposition immersive, nous propose son analyse du tableau clinique de Van Gogh, voici des scènes d’une fiction sur Van Gogh diffusée à la télévision néerlandaise en 2013 et qui occupent une bonne partie, peut-être la moitié, de l’émission d’Angela. Qu’en est-il de la complexité de la figure de Van Gogh ? Ses lectures ? De sa culture ? Ses relations avec d’autres artistes dans la France de la fin du 19e siècle ? Pourquoi son art est-il si important ? Rien : vous ne voulez pas ennuyer le téléspectateur, parce qu’alors il changera et commencera à regarder l’émission de téléréalité sur Channel 5, et alors qui peut entendre les indignés qui sont déjà dans une frénésie et sont impatients d’écrire des éditoriaux et des posts sur le public ignorant et déséquilibré qui préfère l ’île de la tentation à la culture.
On peut se demander quelle est la différence entre l’île de la tentation et ce Van Gogh banal et soporifique. Le problème ne réside pas dans les erreurs (par exemple, Van Gogh commence à peindre à Nuenen, le moulin de Gennep “fait partie des toutes premières œuvres”), mais dans le fait que la belle-soeur qui publie l’ouvrage n’est pas la même que celle qui l’a publié.Ce ne sont pas les erreurs (Van Gogh commençant à peindre à Nuenen, le moulin de Gennep “parmi les toutes premières œuvres”, la belle-sœur qui publie les lettres des deux frères avant de faire quoi que ce soit d’autre), ce ne sont pas les banalisations extrêmes (Van Gogh déménageant en Provence pour rechercher la campagne et devenir sobre, Van Gogh se querellant avec Gauguin à propos d’un tableau qu’il n’aimait pas), ce ne sont pas les expositions immersives, ce ne sont pas les images des fictions de la télévision néerlandaise . Le problème est que nous ne nous éloignons pas du biographisme, nous ne nous éloignons pas de l’anecdotique ne serait-ce qu’une demi-seconde. Le problème est que Van Gogh, traité de cette manière, devient une émission de télé-réalité en soi. Si nous devons regarder deux heures d’un roman sur la vie de Van Gogh à une heure de grande écoute, n’aurait-il pas été plus rapide de diffuser directement le drame néerlandais , qui, soit dit en passant, hormis les parties fictives nécessaires, semblait également intéressant ? Nous aurions tout aussi bien pu regarder deux heures de film.

Bien sûr, le lecteur incapable d’accepter l’idée qu’une émission de télé-réalité minable vaut mieux qu’un documentaire sur Van Gogh dira : "C’est peut-être le roman de sa vie : C’est peut-être le roman de sa vie, c’est peut-être une banalisation extrême, on n’a peut-être pas vu d’œuvres d’art, on a peut-être dû avaler malgré nous les images de l’exposition immersive ou les animations ridicules des corbeaux qui survolent les champs de maïs, mais, dira-t-il, au moins Van Gogh aura touché quelqu’un. Près de trois millions de téléspectateurs ont en effet regardé le documentaire d’Alberto Angela. Mais qui ne connaît pas ce Van Gogh ? Le documentaire n’a pas proposé de nouvelles lectures intéressantes. Au contraire, il a ravivé des stéréotypes. Et puis, à quoi bon ? L’exposition de Rome, il y a deux ans, s’est terminée avec près de six cent mille visiteurs. Et nous disons presque six cent mille, alors qu’une grande exposition dépasse à peine les deux cent mille (et ce serait encore une exposition bien visitée). Dans la liste des best-sellers de Feltrinelli du mois dernier, la première place est occupée par Lettres à Théo. On ne compte plus les films. Ceux qui vont déjà voir les expositions Van Gogh sont déjà dans le registre des personnes averties. Les deux autres millions et quelques, après avoir vu les mines immersives de Provence et les corbeaux qui s’animent sur les champs de blé, ont éteint la télé.
Le vrai défi n’est donc pas d’amener Van Gogh à une heure de grande écoute. Ou, comme dans les prochains épisodes, de nous faire découvrir Londres, Istanbul et Lucrèce Borgia. Tout le monde aime gagner facilement (moi aussi, car la seule fois où j’ai été appelé à faire quelque chose dans un théâtre, j’ai amené Johanna Bonger, la belle-sœur de Van Gogh). Bien sûr, le lecteur qui se soucie des recettes publicitaires de la RAI dira : si en prime time, au lieu de Van Gogh, Londres, Istanbul et Lucrezia Borgia, vous mettez Guido Reni, Albissola, Piacenza et Plautilla Nelli, alors vous rêvez de trois millions de téléspectateurs, personne ne vous regarde. Mais comment ? L’été dernier, nous nous sommes retrouvés sous un déluge de critiques envers la RAI pour avoir suspendu Noos, les appels au service public pour qu’il fasse du service public et qu’il se foute de l’audimat parce que la RAI ne doit pas suivre la logique de la télévision commerciale, parce que l’objectif est de faire quelque chose d’utile pour le public et non de courir après l’audimat, et donc nous accueillons le Van Gogh télévisé parce que sinon Guido Reni personne ne le regarde ? Et donc, s’il faut parler d’utilité pour les téléspectateurs, le roman de Van Gogh est-il plus un service public ou serait-il plus un service public de faire savoir au téléspectateur que s’il éteint la télévision et sort son nez de la maison, il peut tout voir, et qu’il n’est même pas nécessaire d’habiter Rome, Milan, Florence ou Naples pour s’émerveiller ? Pour le spectateur de Celle Ligure, la mine immersive de la Provence est-elle plus utile, ou est-il plus utile de savoir qu’à deux arrêts de train de chez lui se trouvent des lieux où ont été écrites des pages fondamentales de l’art mondial des années 1950 et 1960 ? Pour le spectateur de San Rocco al Porto, l’animation du corbeau survolant le champ de blé est-elle plus utile, ou est-il plus utile de savoir qu’à un quart d’heure de vélo de chez lui, il peut voir le Guercino, il peut voir les splendeurs de Farnese, et il peut même voir un Botticelli, s’il aime vraiment l’artiste best-seller ? Bien sûr, diront les prétoriens d’Alberto Angela, ceux qui veulent s’informer sur Albissola, sur Piacenza, sur Guido Reni, sur Plautilla Nelli ont Raiplay, ils ont des émissions nocturnes. Ici : sommes-nous sûrs que c’est une bonne idée de confiner tout ce qui n’est pas Van Gogh, Pompéi et Caravaggio à Raiplay ou à la deuxième nuit ? Si oui, entre la télé-réalité Van Gogh et la télé-réalité trash, regardez plutôt L’île de la tentation. C’est moins ennuyeux et, à certains égards, même plus intéressant. Ensuite, pour la culture, il y a Raiplay ou la deuxième nuit.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.