La Madone de Michel-Ange et d'autres chefs-d'œuvre dans l'église Notre-Dame de Bruges
La ville de Bruges est un passage obligé pour tous les amateurs d’art lors d’un voyage en Belgique. La capitale de la Flandre occidentale est un joyau brillant, avec sa vieille ville médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000, embellie par de somptueux palais, monuments et églises, ainsi que d’importants musées abritant d’extraordinaires peintures de l’histoire de l’art, avec des œuvres de Bosch, Van Eyck, Hans Memling, pour n’en citer que quelques-unes. L’une des curiosités les plus remarquables est l’église Notre-Dame( Onze-Lieve-Vrouwekerk ) qui, avec son clocher, domine l’horizon de la ville (c’est aussi la deuxième plus haute tour en briques du monde, avec sa flèche qui culmine à plus de 115 mètres). Mais ce n’est pas seulement son architecture exceptionnelle qui en fait l’une des attractions les plus visitées : c’est surtout grâce aux chefs-d’œuvre conservés à l’intérieur, dont un rôle prépondérant est sans aucun doute joué par l’œuvre connue sous le nom de Madone de Bruges, une sculpture de Michel-Ange, la première des rares sculptures à avoir quitté l’Italie du vivant du maître toscan.
L’église gothique est l’un des plus anciens lieux sacrés de Bruges: construite à l’époque carolingienne, elle a été remaniée à de nombreuses reprises au cours des siècles (la nef date de 1210, tandis que le beau chœur polygonal à arcades rampantes a été construit entre 1270 et 1335). Dans l’église, dont l’accès est gratuit, quelques œuvres significatives sont conservées, dont une somptueuse chaire en bois du XVIIIe siècle de style baroque, mais les véritables trésors sont conservés dans le musée, relativement récent.Mais les véritables trésors se trouvent dans le musée, relativement récent, qui s’étend sur une partie des transepts, du déambulatoire et du presbytère, créant un ensemble certes peu étendu mais justifiant un prix d’entrée qui serait bien trop exorbitant pour une seule œuvre, même s’il s’agit de l’un des chefs-d’œuvre les plus importants de l’histoire de l’art.
De grande qualité sont les confessionnaux sculptés en bois de chêne par les mains de Jacob Berger et Ludo Hagheman, scannés par l’insertion de figures en ronde-bosse symbolisant le Vice, la Foi et quelques saints. Il s’agit de l’un des ensembles sculpturaux les plus importants de la ville flamande. Parmi les premières chapelles que l’on rencontre en entrant dans le musée figure celle commandée par Louis de Gruuthuse, influent conseiller des ducs de Bourgogne et chevalier de l’ordre de la Toison d’or. Le somptueux palais qu’il habitait et qui porte encore aujourd’hui son nom était relié, à son initiative, à l’église par une chapelle à deux étages, du haut de laquelle lui et sa famille pouvaient observer les offices religieux, tandis qu’au niveau inférieur, il pouvait être rejoint par un prêtre pour recevoir la communion. Les autres chapelles ont pour la plupart été remodelées récemment, notamment la chapelle du Sacrement, commandée par l’évêque J.B. Malou au milieu du XIXe siècle dans un style néogothique et ornée de précieux vitraux, et la chapelle des Lanchals. Cette dernière appartenait à Pieter Lanchals, conseiller et ami proche de l’archiduc Maximilien de Habsbourg qui, en 1488, à la suite d’un soulèvement dans certaines villes flamandes, fut décapité lors d’une exécution à laquelle l’archiduc fut contraint d’assister. La légende raconte que, pour se venger, l’archiduc décréta que quelques spécimens de ces élégantes plumes vivraient à jamais dans la ville de Bruges, parce qu’un cygne se distinguait dans le noble symbole de Lanchals, et qu’on les trouve encore aujourd’hui dans ce qu’on appelle le “lac de l’amour”.





Le corps du conseiller repose derrière l’imposante pierre tombale baroque qui domine la chapelle entre les deux fenêtres. Dans cet espace se trouvent également trois tombes d’origine médiévale qui témoignent d’une coutume en vigueur à Bruges depuis environ 1270, selon laquelle l’intérieur des tombes était peint en brique. Les peintures aux couleurs vives représentent des figures sacrées, des croix et des fleurs. Ces représentations étaient exécutées très rapidement, car au Moyen Âge, les morts étaient souvent enterrés le jour même de leur décès, ce qui obligeait les peintres à travailler en toute hâte et à s’accroupir dans les tombes, où ils exécutaient leurs dessins sur de la chaux humide, mais avec des résultats plutôt grossiers.
Plusieurs peintures et dossals disséminés dans l’espace du musée sont d’un grand intérêt, les plus remarquables étant uneAdoration des bergers peinte par Pieter Pourbus en 1574 et commandée par un juriste de Bruges, qui est représenté avec ses enfants dans le panneau de gauche, tandis que sa femme et ses filles sont éternellement représentées dans le panneau de droite. Une croix rouge est visible sur le front de certains d’entre eux, car ils étaient déjà décédés lorsque le peintre a réalisé l’œuvre.
L’intervention de Pourbus se retrouve également dans le triptyque de la Transfiguration du Christ, commandé à Gérard David, peintre d’origine néerlandaise formé dans le style de Hans Memling. L’œuvre, datée du début du XVIe siècle, présente une mise en page fraîche et scénique dans le panneau central, tandis que les deux panneaux latéraux peints par Pourbus quelque soixante-dix ans plus tard révèlent les difficultés de l’artiste à s’adapter au style de David.
Une Cène monumentale est également de Pourbus, tandis que le chef-d’œuvre d’Adriaen Isenbrandt, qui a suivi les enseignements de Gérard David et dont l’œuvre est également conservée dans l’église San Pancrazio de Gênes, se trouve également ici. Le panneau avec la Vierge des Sept Douleurs témoigne d’un certain intérêt pour l’art des Primitifs, mais aussi d’un goût pour les éléments classiques auxquels est confiée l’architecture de la scène principale, autour de laquelle se développent les récits des Sept Douleurs. A noter également un Souper à Emmaüs de Hendrik Ter Brugghen, un artiste qui s’est frotté au style du Caravage lors de son voyage en Italie, et une Crucifixion d’Antoon van Dyck.
Mais c’est dans le chœur que se concentrent certaines des œuvres les plus extraordinaires de l’église : sur l’autel est accroché le luxueux Triptyque de la Passion peint par Barend van Orley et Marcus Gerards en 1534. L’installation du tableau et des grilles fait partie d’une rénovation globale de l’espace sacré, réalisée en vue du déplacement des restes de Charles le Téméraire, qui n’ont été accueillis ici qu’en 1563, plus de quatre-vingts ans après la mort du souverain. En effet, le très puissant duc de Bourgogne, qui cultivait depuis longtemps des ambitions d’expansion et de puissance, espérant même échapper au joug de la vassalité du roi de France et pouvoir ainsi voir ses possessions se transformer en royaume, mourut en 1477, alors qu’il assiégeait Nancy en Lorraine. Son corps ne fut retrouvé que deux jours plus tard, le crâne ouvert, et il trouva longtemps le repos dans une église de la ville française.
Mais avant le duc, l’église abritait déjà le corps de sa malheureuse et unique fille, Marie de Bourgogne, qui vit de son vivant les royaumes qu’elle avait hérités de son père considérablement réduits et qui périt enceinte en tombant de cheval en 1482. C’est à la demande de son mari Maximilien de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, que le somptueux tombeau a été commandé. Le modèle en bois a été créé par le sculpteur Jan Borreman avec l’aide de Renier van Thienen, puis doré et émaillé par l’orfèvre Pierre de Beckere.
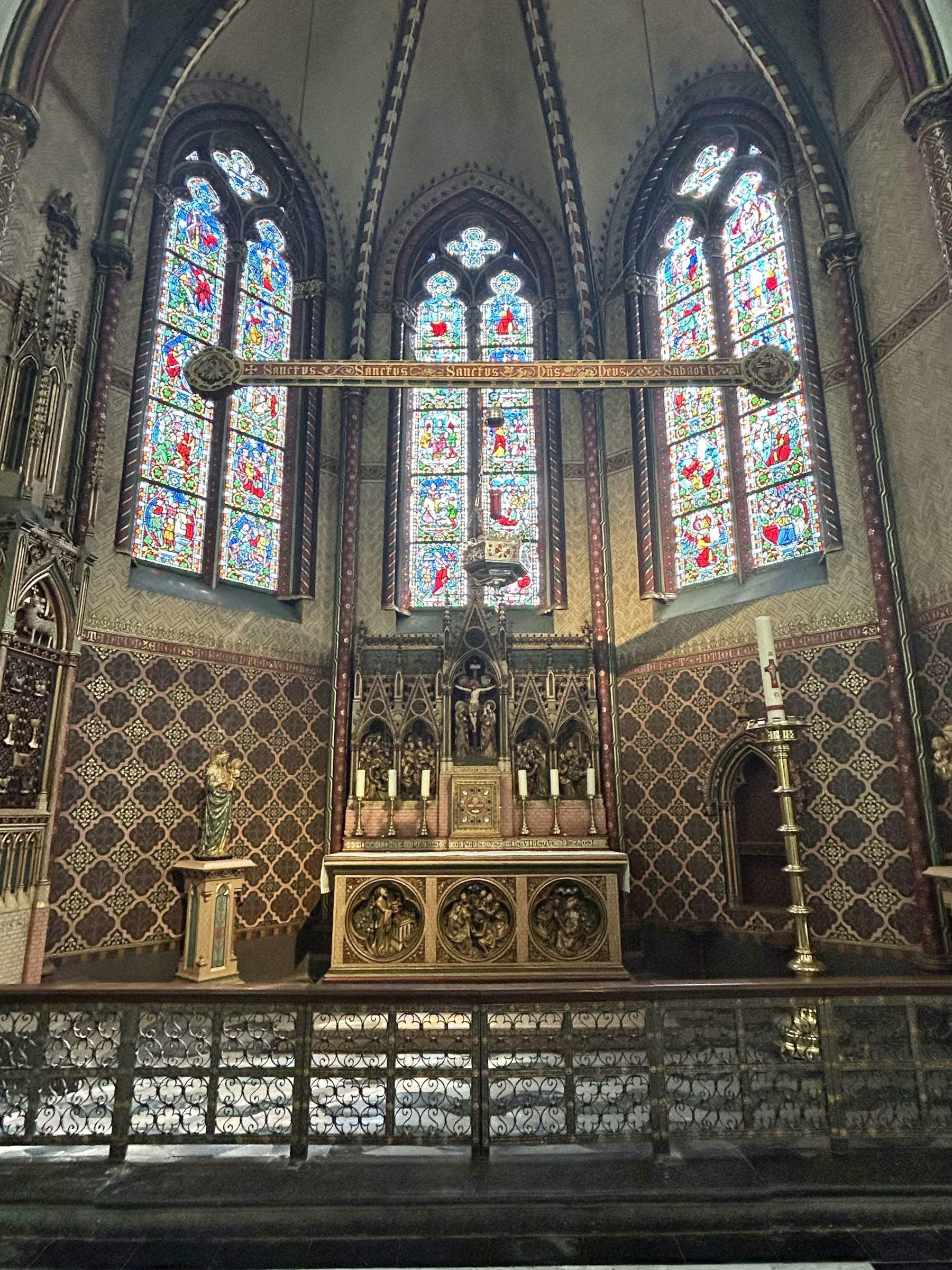








Réalisé entre 1490 et 1502, le monument funéraire de style gothique tardif, qui représente la noble couchée, les mains en prière, parée d’une robe et d’une couronne luxueusement décorées, est un chef-d’œuvre de naturalisme frais, notamment dans le rendu des expressions du visage. Le sarcophage de marbre noir sous-jacent est orné des arbres généalogiques en cuivre de la mère et du père, tandis qu’au pied s’étire un chien symbolisant la fidélité féminine.
Le tombeau de Temerario répond lui aussi à un dessin assez similaire qui, étant plus tardif, présente également des éléments qui s’ouvrent plus résolument à la Renaissance, comme les nymphes qui soutiennent le bouclier et le style de l’armure portée par le duc, qui arbore également les symboles d’appartenance à l’ordre de la Toison d’or, tandis qu’à ses pieds se trouve un lion, symbole de la force. Il s’agit d’une œuvre de Jacques Jonghelinck, qui a également étudié en Italie dans l’atelier du sculpteur Leone Leoni.
L’église recèle encore de nombreux trésors, mais parmi l’or, les vitraux, les sculptures gigantesques et les imposants dossals d’autel, c’est un peu moins de 130 centimètres de marbre qui attirent l’attention du visiteur, constituant le véritable chef-d’œuvre inégalé de l’église. La célèbre sculpture de la Vierge à l’Enfant, œuvre éternelle de Michelangelo Buonarroti, est si grande que, malgré ses dimensions modestes, elle est qualitativement gigantesque dans le contexte dans lequel elle est insérée, un autel monumental en marbre noir et colonnes, construit d’après un projet de Jan de Heere de Gand, pour le compte de la riche famille de marchands de Mouscron, ceux-là mêmes qui ont commandé la statue à Michelangelo. L’autel a été construit plusieurs décennies après l’arrivée de l’œuvre de Michel-Ange, probablement, d’après la plaque à la base de l’autel, peu avant la mort de Pierre Mouscron en 1571 : Pierre Mouscron, comme d’autres membres de sa famille, a été enterré ici.
L’autel semble absolument disproportionné par rapport à la petite statue, à côté de laquelle se trouvent deux gigantesques allégories qui, comme l’autel, parviennent à s’effacer devant le chef-d’œuvre. La blancheur pâle de la statue s’imprime sur le marbre noir de la niche, ce qui renforce sa virtuosité formelle. Michel-Ange a taillé la statue dans un seul bloc et représente une Madone assise sur un trône, d’après l’iconographie byzantine Sedes sapientiae, dont elle s’écarte, car l’enfant n’apparaît pas dans ses bras, mais comme s’il se dégageait de l’emprise de sa mère pour faire quelques pas vers le spectateur. C’est sur le dualisme mère-enfant que repose la force du groupe sculptural, la Vierge et l’Enfant, placides et immobiles, faisant preuve d’une grande énergie vitale, de même que le lourd drapé de la femme, qui se résout en plis abondants et couvre chaque centimètre de peau, s’oppose à la douce nudité de Jésus, ou à l’air pensif et triste de Marie qui contraste au contraire avec l’impétueuse confiance du Rédempteur.
Le manteau drape et encadre gracieusement la tête de la Vierge, faisant ressortir son visage préoccupé et absorbé, dont les yeux évitent le contact avec l’Enfant autant qu’avec le public, signe prodromique symbolisant la prise de conscience du destin malheureux auquel son fils est destiné pour racheter toute l’humanité du péché. Elle a peut-être lu les événements dans le livre des Saintes Écritures qu’elle tient d’une main, tandis que de l’autre elle tente en vain de retenir Jésus, de le garder pour elle, de le protéger de sa tâche glorieuse et sanglante.
Toute la tendresse et l’intimité entre les deux est confiée au croisement de leurs mains. À la fragilité affective et à la grâce féminine s’oppose l’audace de l’enfant, grand et robuste comme un petit Hercule : il est prêt et n’hésite pas à accomplir la tâche qui lui incombe. Son corps tendre et poli est prêt à se détacher de celui qui l’a engendré. L’ensemble du groupe est empreint d’un tempérament classique, perceptible dans le rendu anatomique des deux, autant que dans les riches plis de la robe de la Vierge, et dans cette tête d’Antinoüs méditerranéen de l’enfant. La Madone a été sculptée en ronde-bosse, avec un traitement translucide du marbre, capable de garder le secret d’un éclat lumineux qui se réverbère sur les corps, à l’exception de quelques pièces, comme une épaule et les rochers à ses pieds qui portent encore les traces du ciseau.




Malgré l’incommensurable renommée du groupe statuaire, les origines de la genèse de ce chef-d’œuvre restent obscures, notamment parce que c’est l’auteur lui-même qui les a gardées confidentielles. Michel-Ange s’est vu confier la commande de la Vierge à l’Enfant alors qu’il était relativement jeune, mais dans ces mêmes années, sa carrière connaissait un tournant décisif et sa renommée se répandait comme une traînée de poudre. En 1499, il s’était distingué en réalisant son premier grand chef-d’œuvre, la Pietà créée pour la basilique Saint-Pierre de Rome, tandis que deux ans plus tard, à son retour à Florence, il recevait la commande du David.
En fait, les critiques s’accordent à dire que les prémisses de la Madone de Bruges sont à rechercher dans le laps de temps qui sépare les deux œuvres, ou en tout cas dans les années florentines entre 1501 et 1505. Mais c’est Wilhelm Reinhold Valentiner qui, en 1942, a proposé de la rattacher à l’autel Piccolomini. Michel-Ange, en effet, avait accepté en 1501 une commande du cardinal Francesco Todeschini Piccolomini, futur pape Pie III, pour réaliser quinze statues destinées à l’autel Piccolomini de la cathédrale de Sienne. Ce projet, interrompu et repris cinq fois, n’a jamais été achevé par Michel-Ange, qui n’a réalisé que quatre saints, décidant par la suite d’abandonner une commande qui devait s’avérer trop contraignante pour le prestige artistique qu’il acquérait peu à peu.
Selon Valentiner, Michel-Ange aurait décidé de sculpter la Madone, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le contrat siennois, pour la niche centrale de l’autel Piccolomini entre 1504 et 1505, pour décider peu après de réaliser un plus grand profit et de la vendre aux frères Mouscron, de riches marchands de tissus originaires de Bruges mais ayant également des intérêts en Italie (où ils étaient également connus sous le nom de “Moscheroni”). Aujourd’hui encore, l’hypothèse de Valentiner est vivement débattue. Ce qui est certain, c’est que l’artiste a gardé le secret absolu, à tel point que ses principaux biographes, Vasari et Condivi, parlent de la Madone de Bruges en des termes absolument vagues, le premier parlant d’un tondo et le second d’un bronze.
Les informations peu connues proviennent de lettres entre Michel-Ange et son père, dans lesquelles il demande “ce marbre Nostra Donna, je voudrais que tu l’amènes là, dans la maison, et que personne ne la voie”, puis, plus tard, du transfert de l’œuvre en Flandre, qui s’est également déroulé dans le plus grand secret depuis le port de Livourne ou de Viareggio. Les raisons du silence autour de l’œuvre et de ses vicissitudes peuvent être attribuées au fait que l’artiste ne s’était pas encore désengagé de l’autel Piccolomini, dont les commanditaires attendaient ses services depuis un certain temps.
Malgré la prudence dont l’œuvre a fait l’objet, on a remarqué que la Madone du Chardonneret de Raphaël semble trahir, dans certaines solutions formelles, une connaissance directe de l’œuvre de Michel-Ange. Mais il est certain que les Mouscron ont payé une somme considérable pour l’œuvre, celle de 100 ducats, soit à peu près l’équivalent d’un an et demi de salaire d’un bon artisan de l’époque. En 1514, Jan Mouscron et son épouse firent don de l’œuvre à l’église de Bruges, pour laquelle le nouvel autel avait été réalisé, à condition qu’il y reste à jamais. Malheureusement, ce souhait n’a pas été respecté et l’œuvre a d’abord été volée sur ordre de Napoléon et emmenée à Paris, d’où elle est revenue à la chute de l’empereur français, puis pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu’elle a été réquisitionnée en septembre 1944 par des soldats allemands pour le musée tant convoité d’Hitler. Elle a été retrouvée l’année suivante par les Monuments Men, le service du patrimoine culturel de l’armée américaine, qui l’ont repérée dans une mine de sel à Altaussee, en Autriche. La Madone de Bruges est aujourd’hui le joyau de la couronne d’un musée d’une qualité extraordinaire, même s’il est de petite taille.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.


























