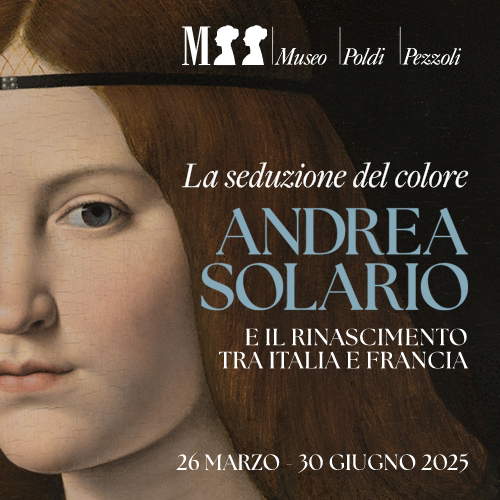L'image du pouvoir. Le portrait d'Aliénor de Tolède à Pise
L’image la plus célèbre d’Éléonore de Tolède, née Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, épouse de Cosimo I de’ Medici et duchesse consort de Toscane, est certainement celle peinte par Bronzino et aujourd’hui conservée aux Offices : le Portrait d’Eleonora di Toledo avec son fils Giovanni de’ Medici est , en outre, l’un des chefs-d’œuvre de l’art du portrait du XVIe siècle, l’un des portraits les plus célèbres de l’histoire, une image éloquente du pouvoir des Médicis et un témoignage de l’élégance de la cour florentine. Ce n’est cependant pas le seul portrait de la duchesse : à Pise, le Museo Nazionale di Palazzo Reale conserve un autre portrait célèbre d’Eleonora, qui est représentée avec son fils Francesco, héritier du duché de Toscane, toujours par Bronzino, ici assisté de son atelier. Quelle était la signification de ces images ? Il s’agit essentiellement de portraits d’État, de portraits officiels qui ont joué un rôle politique important dans la Florence ducale au lendemain de la chute de la République florentine, le 12 août 1530. Dans ce contexte historique, explique le chercheur Philippe Costamagna, la fonction même de l’œuvre publique, et en particulier du portrait, est “bouleversée : les représentations allégoriques du nouveau chef de la nation sont censées légitimer sa prise de pouvoir”. C’est dans ce sens qu’il faut lire les portraits du premier duc, Alessandro de Médicis, comme celui peint par Giorgio Vasari en 1534, où le jeune souverain est représenté en armure pour souligner son rôle de défenseur de la patrie, et accompagné de nombreux éléments qui symboliseront ses qualités et la domination des Médicis sur la Toscane. Du portrait allégorique, lié au besoin de légitimation du nouveau pouvoir des Médicis, on passe en quelques années à un portrait d’État plus “ institutionnel ”, si l’on peut dire : il ne s’agit plus de “légitimer l’accession au pouvoir du duc par un portrait allégorique”, explique Costamagna, “mais de transmettre l’image d’un prince régnant”. C’est dans cette seconde sphère que se situent les portraits d’Eleonora.
Le tournant se situe au début des années 1540, lorsque Bronzino travaille sur le premier portrait d’Aliénor de Tolède, destiné à la résidence de Poggio a Caiano, et aujourd’hui identifié comme le tableau de la Národní Galerie de Prague, datant de 1543. Il ne s’agissait cependant pas d’un portrait officiel, mais d’une image destinée à une visibilité privée, pour la résidence du duc. Néanmoins, ce portrait, considérablement plus petit que les portraits plus connus tels que le portrait des Offices ou le portrait de Pise, a été le premier modèle pour l’image de la duchesse. Peu après, Bronzino peaufinera l’iconographie officielle du couple régnant en présentant au duc les deux “prototypes” du portrait de Cosimo et Eleonora, à savoir le Portrait de Cosimo I en armure , aujourd’hui conservé à la National Gallery of South Wales de Sydney, et le célèbre portrait d’Eleonora avec son fils Giovanni, aujourd’hui conservé aux Offices. Une fois l’iconographie officielle établie, les répliques (autographes, exécutées par l’atelier ou par d’autres artistes) devaient décorer les résidences ducales, les bureaux du gouvernement toscan ou être envoyées en Europe comme cadeaux diplomatiques. Ainsi, les répliques du duc sont nombreuses, alors que celles du portrait d’Aliénor le sont moins.

En janvier 1550, Bronzino travaille sur le prototype d’un nouveau portrait officiel, dans lequel la duchesse sera représentée avec son fils François, fils aîné du couple et donc héritier du trône ducal (sur lequel il montera à l’âge de vingt-trois ans, en 1564). Le portrait est destiné à l’évêque d’Arras, Antoine Perrenot de Granvelle, personnage important de la cour impériale : il est en effet l’un des conseillers les plus écoutés de l’empereur Charles Quint. On sait que le 21 décembre 1549, le secrétaire de la cour florentine, Lorenzo Pagni, écrit de Pise au majordome de Cosimo, Pierfrancesco Riccio, pour l’informer que “pour la commodité de Bronzino et pour accélérer la livraison des portraits [...], la robe de la duchesse ne doit pas être faite de brocart bouclé mais d’une autre draperie ornée qui ferait un bel effet”. L’œuvre était donc encore en cours d’achèvement à l’époque (Bronzino, comme l’indique également cette lettre, était si méticuleux qu’il était... lent aux yeux de ses commanditaires). Le choix du fils avec lequel Eleonora devait être accompagnée dans les portraits dépendait essentiellement de l’objectif politique de l’icône. En choisissant le second fils, Giovanni, qui apparaît dans le portrait des Offices, les Médicis voulaient souligner un aspect fondamental de leur politique, à savoir la continuité dynastique, puisque le second fils était considéré, selon la mentalité de l’époque, comme une sorte d’assurance pour l’aîné. Et une dynastie dont la continuité est assurée est aussi un signe de stabilité politique : telle est l’idée que le portrait devait véhiculer. Le choix du fils aîné François, tel qu’il apparaît dans le portrait de Pise, vise en revanche à souligner la figure même de l’héritier du trône. En outre, les gestes mêmes de François, qui se montre du doigt mais tourne aussi la main vers le ventre de sa mère, visent à souligner non seulement son rôle d’héritier du trône et donc de futur duc, mais aussi le rôle d’Eleonora en tant que parent attentif et garant de la continuité dynastique : en effet, nous la voyons probablement enceinte de son septième fils, Ferdinand.
Aujourd’hui, nous ne savons pas si le tableau de Pise doit être considéré comme le portrait exécuté pour l’évêque d’Arras ou, ce qui est plus probable, comme une réplique autographe exécutée pour une résidence ducale. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit de l’un des portraits les plus exquis de Bronzino, même s’il a été réalisé avec l’aide d’un atelier pour des raisons d’urgence de livraison. Dans l’élaboration de l’image, les vêtements portés ont joué un rôle non négligeable. Les vêtements devaient communiquer le luxe, l’élégance et le pouvoir. Pour le portrait des Offices, le choix s’est porté sur la célèbre robe de brocart bouclé, le tissu le plus luxueux, mais aussi le plus difficile à peindre. Pour le tableau de Pise, comme nous l’apprend la lettre du secrétaire ducal, il fallait un costume qui permette à Bronzino d’exécuter le tableau plus rapidement. Les vêtements de Francesco furent choisis directement par Eleonora de Tolède, qui choisit un habit de velours rouge pour le petit héritier, alors âgé de neuf ans, recouvert d’un manteau de satin, éventuellement bordé d’hermine ou de martre (un choix qui ne fut pas respecté par la suite, comme on peut le voir sur l’image, car le manteau n’a pas de bordure de fourrure). Il s’agit du même vêtement que François portait probablement l’année précédente à Gênes lors d’une réception en l’honneur du prince espagnol Philippe II, à qui le petit a été présenté : c’était sa première mission officielle. L’idée était donc de commander à Bronzino un portrait qui refléterait, écrit l’historien de l’art Bruce Edelstein, “le nouveau rôle public du prince de presque neuf ans et une nouvelle phase dans la carrière de la duchesse”, c’est-à-dire une éducatrice attentive et inébranlable (une qualité également soulignée par sa pose bien droite), dont le rôle au sein du gouvernement était indispensable pour préparer son fils à assumer la fonction de duc à l’avenir.



Pour elle-même, Eleonora choisit plutôt une zimarra, une robe longue, sans coupe à la taille, caractérisée par des manches larges avec des bourrelets à la hauteur des épaules, d’origine orientale (elle a probablement été introduite en Europe depuis l’Espagne) et à l’époque pas encore répandue en Toscane, où elle est arrivée avec Eleonora, qui, comme nous le savons, a également lancé des tendances dans l’habillement. Sous la zimarra, Eleonora porte une sottana, qu’il ne faut toutefois pas entendre au sens contemporain du terme : à l’époque, la sottana était une luxueuse robe de velours avec des applications de satin portée sous le pardessus (c’est-à-dire sous la zimarra, dans ce cas). Au-dessus de la sottana se trouvait une collerette faite de filet d’or et de perles cousues sur un tissu de lin blanc, idéale pour couvrir la peau.
Le Museo Nazionale di Palazzo Reale de Pise possède une “sottana con la coda” datant d’environ 1560 qui aurait appartenu à Eleonora di Toledo et qui est similaire à celle que porte la duchesse dans le tableau. Œuvre de l’atelier d’Agostino da Gubbio, l’un des principaux tailleurs de l’époque et tailleur d’Eleonora (son activité est documentée de 1533 à 1566), la robe, en velours rouge cramoisi, faisait partie de l’habillement d’une statue en bois de la Vierge Annunciata dans l’église de San Matteo à Pise. La famille entretenait une relation étroite avec le couvent de San Matteo, près duquel elle résidait. Eleonora avait donc un rapport très étroit avec Pise : c’est là que se trouvait la résidence d’hiver de la famille Médicis (choisie par Cosimo en raison du climat plus doux à la mauvaise saison qu’à Pise), dans l’actuel Palais de la Préfetture, et c’est également à Pise que fut organisé le premier cortège nuptial du couple lorsqu’Eleonora débarqua en 1539 pour la première fois en Toscane.
Restaurée en 2000, lorsqu’elle a retrouvé sa forme originale, la robe fait probablement partie des nombreux jupons que possédait Eleonora (les rouges, couleur typique d’une souveraine, étaient particulièrement fréquents, même si les satins étaient plus nombreux que les velours), mais nous ne sommes pas certains qu’elle ait réellement appartenu à la duchesse : peut-être, comme l’a supposé l’érudite Roberta Orsi Landini, bien qu’elle soit similaire aux vêtements ayant appartenu à Eleonora de Tolède (la jupe du Palais royal diffère en effet par certains détails des jupes que nous savons avoir appartenu à la duchesse), on remarque par exemple qu’elle est plus légère que les jupes de la duchesse : par exemple, on remarque une moindre utilisation de l’or), elle a pu être portée à l’époque par quelqu’un de la “ famille ” ducale, donc une des filles, une demoiselle ou une femme des serviteurs d’Éléonore de Tolède : Agostino da Gubbio, en effet, confectionnait des vêtements non seulement pour la duchesse, mais aussi pour toute la cour. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une robe luxueuse, réalisée à partir de modèles en tissu ou en papier, qui s’est retrouvée dans l’église de San Matteo en tant qu’ex voto probable. Il s’agit en outre d’un témoignage très important de la mode féminine à la cour de Cosimo I, que l’on peut encore voir au Museo di Palazzo Reale à côté du portrait d’Eleonora dans la salle des tapisseries.


Dans le portrait de Pise, note Orsi Landini, Eleonora et son fils partagent le même schéma vestimentaire: “velours pour son habit et son jupon, satin pour sa robe et sa zimarra, respectivement en cramoisi et en ’pagonazzo’. Pour les deux, les décorations sont en or : chevrons pour le garçon, broderie en applique vergola ou en tresse d’or pour Eleonora, identiques ou très similaires pour les deux vêtements distincts qui composent l’habillement des hommes et des femmes, selon le goût consolidé à la cour dans ces années-là”. Le choix de la couleur “pagonazzo”, un rouge cramoisi, répond plus à une nécessité artistique qu’à une exigence de réalisme, puisque le rouge des vêtements réels était légèrement différent de celui que nous observons dans le tableau, la duchesse préférant d’autres teintes à l’époque. Il est donc naturel de penser que le rouge du tableau, plus vif que celui des vêtements réels, devait avoir des fonctions représentatives et symboliques.
Enfin, comment la duchesse a-t-elle fait pour ne pas heurter la sensibilité des Florentins en exhibant toujours des robes somptueuses, des bijoux coûteux et de riches ornements ? Si, en effet, les Florentins se sont d’abord méfiés de la duchesse venue d’Espagne, ils ont rapidement commencé à apprécier Eleonora, et les relations entre la duchesse et ses sujets ont toujours été bonnes. Le fait est que, malgré les apparences et malgré l’image d’Eléonore de Tolède qui s’est fixée dans nos mémoires, la duchesse menait une vie relativement modeste dans son quotidien aussi pour ne pas ternir sa propre image, pour ne pas nuire à l’idée de vertu qu’elle voulait transmettre à ses sujets. Hier comme aujourd’hui, la construction de l’image d’un homme politique n’omet aucun élément, du comportement dans la vie publique et privée aux portraits officiels.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.