Nouvelles perspectives pour l'étude des relations entre l'art et la politique au 20e siècle. Entretien avec Michele Dantini
Nouvelles perspectives pour l’étude des relations entre l’art et la politique au 20e siècle. Entretien avec Michele Dantini
Art et politique en Italie entre le fascisme et la République (Donzelli, 2018) est le dernier livre de Michele Dantini, historien de l’art contemporain, maître de conférences à l’Université pour étrangers de Pérouse et professeur invité à l’école Imt Alti Studi de Lucques. Selon la quatrième de couverture, le livre se propose d’examiner “les continuités sociales et culturelles en Italie dans la transition entre le fascisme et la République, à une époque de profonde discontinuité politico-institutionnelle”, ainsi que la manière dont les deux moitiés du XXe siècle séparées par la Seconde Guerre mondiale sont reliées ou disjointes, et les “déménagements” de l’historiographie de l’après-guerre et de l’après-guerre. Tout cela à travers trois essais (dédiés à Edoardo Persico, Giuseppe Bottai et Renzo De Felice) d’où émergent d’importantes considérations sur les “liturgies politiques” de l’époque, analysées à travers l’histoire de l’art de l’époque. Ce volume introduit de nouvelles perspectives pour l’étude des relations entre art et politique au XXe siècle, en offrant une analyse nouvelle et d’un intérêt certain, en particulier pour ceux qui étudient ou approchent l’art du XXe siècle. Nous avons approfondi les thèmes du livre en nous entretenant avec Michele Dantini. L’entretien est édité par Federico Giannini.
 |
| Michele Dantini. © Livia Cavallari, Florence |
FG. Arte e politica in Italia tra fascismo e Repubblica (Art et politique en Italie entre fascisme et République ) est un livre qui se propose d’aborder les thèmes de la “liturgie politique”, sous des profils éminemment historico-artistiques, considérés dans leur développement entre les deux moitiés du XXe siècle séparées par la Seconde Guerre mondiale, en offrant des outils pour une analyse qui peut nous amener à reconsidérer les développements de l’art lui-même dans la période de l’après-guerre et qui peut également se rattacher à des thèmes qui sont plus que jamais d’actualité. Mais je voudrais commencer cet entretien en essayant de cadrer cette contribution, puisqu’elle se situe dans la sphère de la recherche qui n’a pas été abordée jusqu’à présent: sur quelle base se greffe Art et Politique en Italie?
MD. Le livre part d’un constat historiographique. Nous disposons d’excellents récits sur la manière dont certains répertoires ou ateliers artistiques, architecturaux, musicaux et littéraires de l’entre-deux-guerres se sont attachés à faire mûrir cette “nationalisation des masses” dont parle Mosse, c’est-à-dire à diffuser et enraciner un sentiment d’appartenance, si possible (mais pas toujours) dans une tonalité héroïque. Ici, il manque le récit de la contribution des arts figuratifs. Et ce, pour une raison simple: l’historiographie artistique de l’après-guerre, même lorsqu’elle a tenté de récupérer des moments importants du Ventennio ou même antérieurs, comme le futurisme, inextricablement lié au fascisme, l’a fait dans une tonalité apologétique. En d’autres termes, il s’agissait de démontrer que tel ou tel n’était pas tellement fasciste, de défendre Marinetti, Prampolini, Fontana, et d’exclure tout compromis. Je n’étais guère intéressé par ce qui relevait de l’apologie, en ce sens que nous devrions maintenant avoir pris suffisamment de distance pour considérer la chose elle-même sans avoir besoin de prendre parti pour la défense de tel ou tel. Avant tout, certaines choses m’ont semblé claires: premièrement, la “politisation” de l’image italienne entre les deux guerres est beaucoup plus répandue qu’on ne le pense ; deuxièmement, cette politisation n’est pas nécessairement synonyme de fascisme ; troisièmement, il faut toujours se demander ce qu’est le fascisme et, le cas échéant, ce qu’il signifie ; quatrièmement, et c’est le plus important: le fascisme dans les images n’est pas simplement à chercher dans les photos avec Mussolini à cheval. C’est trop simple: ce n’est pas parce qu’un tableau représente Mussolini à cheval qu’il est fasciste, qu’il prend position, qu’il s’écarte, qu’il se range ou qu’il sympathise. Non: il faut chercher dans les plis de l’image des récits identitaires (qui peuvent être fascistes, mais aussi non fascistes ou même antifascistes) et des implications politiques, aussi bien lorsque le thème apparaît idéologiquement explicite que lorsqu’il ne l’est pas. Prenons un exemple: à première vue, la nature morte semble être l’un des genres dans lesquels le discours politique nationaliste ou patriotique, voire le militantisme fasciste, ne devrait jamais apparaître. C’est profondément faux, car la nature morte met en scène une image de l’Italie qui a des implications politiques qu’il faut reconstruire de temps en temps mais qui sont souvent très précises (l’Italie comme “patrie de la beauté”, l’Italie comme “troisième voie” entre les deux systèmes productivistes des États-Unis ou de l’Angleterre d’une part et de l’Union soviétique d’autre part, l’Italie comme lieu supratemporel où les dieux continuent d’habiter). Même la nature morte a des implications géopolitiques et culturelles dont il faut ensuite comprendre où elles mènent: une nature morte contribue donc souvent à la “liturgie politique” sans qu’il soit nécessaire d’avoir un Mussolini à cheval.
Le thème de la liturgie politique émerge également de manière substantielle de la première figure abordée par le livre, celle d’Edoardo Persico: Art and Politics in Italy between Fascism and the Republic est en fait un livre “tripartite”, pour ainsi dire, puisqu’il est divisé en trois essais, consacrés à Persico, Giuseppe Bottai et Renzo De Felice, visant à détecter une éventuelle continuité entre la première et la seconde moitié du 20e siècle. Une première continuité pourrait être tracée en sondant les intentions de renouvellement de Persico sur le thème de l’art sacré: en partant de ses installations (le livre parle de la Sala delle Medaglie d’Oro de Persico et Nizzoli à l’Exposition aéronautique de 1934, ou du Salone d’onore à la Triennale de Milan de 1936, des salons que le livre définit comme “liturgiques”), on pourrait ensuite atteindre les salles de Lucio Fontana...
C’est en fait ce que je me propose de faire: une perception plus complexe et plus mûre de la manière dont les images, à quelque titre et sous quelque bannière que ce soit, participent à un processus que nous appellerions aujourd’hui nation building, c’est-à-dire la construction d’un sentiment d’appartenance, nous permet de retracer et de reconstruire certaines continuités qui, autrement, seraient perdues. En l’occurrence, celles entre Persico et Fontana, et surtout celles entre le premier et le second Fontana, qui autrement restent complètement oubliées ou passées sous silence. Même si nous ignorons la position politique de Fontana entre les deux guerres et les études récentes sur son appartenance à un parti politique pendant les années où il se trouvait en Argentine, son rapport avec Persico, si formateur pour lui, si important pour sa première affirmation en tant qu’artiste sur la scène milanaise, va jusqu’à une collaboration d’environnements et à la récupération d’une tradition baroque d’images qui s’ouvrent à la lumière: Persico est une figure extrêmement importante, c’est un antifasciste catholique, même si son antifascisme n’est pas bien décrit par les catégories de l’antifascisme républicain à venir, comme nous l’avons fait pendant de nombreuses années dans le sillage interprétatif de Giulia Veronesi. L’antifascisme de Persico est l’antifascisme d’un catholique fondamentaliste qui croit en la primauté du Vatican, qui croit en l’existence d’une nation italienne comprise avant tout comme une nation catholique, donc à la fois fortement localisée et cosmopolite. Il est clair que Persico renouvelle les démonstrations défascisantes d’exemples éminents de la liturgie politique fasciste, et je me réfère au Sanctuaire des Martyrs de l’Exposition du Dixième Anniversaire de la Révolution Fasciste, qui affecte fortement Persico, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur parce qu’il s’agit sans aucun doute d’une démonstration puissante, pour le pire parce que ce qu’il appelle lui-même la “violence publicitaire” le dérange, et parce que cette attribution de dimensions religieuses à un mouvement politique perturbe sa conscience de catholique non expéditif. Ici, la Sala della Vittoria de la Triennale est une sorte de sanctuaire des martyrs complètement défascisé: la puissance religieuse, la référence à la basilique paléochrétienne et à ses différentes composantes, principalement la luminosité et l’autel, nous parlent du propre dialogue de Persico avec le type d’“environnement” sacré que les Italiens connaissent et expérimentent (à savoir l’église). Il y a là un rationalisme recruté par ceux qui ne sont pas du tout des rationalistes, mais qui veulent utiliser le rationalisme pour construire des environnements dans lesquels l’expérience du sacré est renouvelée et, en se renouvelant, est préservée. Il me semble que nous sommes très proches, bien que pas exactement au même point, de ce que Fontana, avec une sensibilité différente, proposera de faire avec les environnements. Je rappelle que même dans l’Autoportrait de Carla Lonzi de 1967, Fontana ne fait que formuler des instances de renouvellement de l’art sacré: il ne s’agit pas de soumettre, mais de renouveler. Et il le fait d’un point de vue clairement identitaire: l’identité de l’artiste italien (ou plutôt latin) consiste à être un artiste sacré, un artiste métaphysique, un artiste enraciné non pas dans l’actualité politique, non pas dans la dénonciation, non pas dans la protestation, mais dans l’adoration d’images numineuses. Et cela me semble toujours être Persico.
 |
| Marcello Nizzoli et Edoardo Persico, la Sala delle Medaglie d’Oro au Salon de l’aéronautique de 1934 photographiée par News Blitz (1934 ; Milan, Milan Triennale Photographic Archive Fund) |
L’essai sur Persico fait également une large place à son idée de la modernité. Dans sa Lettre à Sir J. Bickerstaff, Persico écrit que “la crise de l’art moderne consiste en son abstention de la vie: l’artiste qui ne sent pas son public autour de lui est amené à créer des œuvres sans destination”. Appelant donc à un art qui puisse “parler la langue de tous” pour “comprendre certains problèmes et se préoccuper de leurs solutions”, Persico souligne que la circulation des connaissances, lit-on dans le livre, ne peut que conduire à une conversation et même à un style européens, car, cite encore Persico, “rien n’empêche les mots, les couleurs, les volumes et les sons de franchir les frontières”. Ici, il serait intéressant d’explorer les termes de l’européanisme de Persico...
C’est une bonne question, dans le sens où il s’agit d’une question cruciale qui s’est prêtée aux interprétations erronées les plus confortables, toujours dans cette clé apologétique et absolutiste, un peu superficielle et un peu instrumentale, de l’historiographie de l’art italien après la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où il a été facile de prendre les termes et de les manier un peu comme des gourdins, sans penser que les mots sont toujours fondamentalement ambigus, et sans penser que Persico est rompu aux techniques d’appropriation culturelle de la tradition ecclésiastique, et donc parfaitement capable de recruter un dictionnaire adverse et de le remplir ensuite de son propre contenu, parfois même divergent. Il est clair que lorsque Persico parle d’européanisme, il s’adresse aux lecteurs de Il Baretti, car il en parle pour la première fois dans Il Baretti (la troisième revue fondée par Piero Gobetti), et donc à un public idéologiquement très éloigné, laïc, libéral, nord-italien. Lui, en revanche, est un fondamentaliste catholique, “clérical” comme il se définit lui-même, méridional, bourboniste et anti-unitaire: on ne peut donc imaginer une plus grande distance, dans l’Italie de l’époque, entre le public de Il Baretti et Persico, qui, à cette occasion aussi, est un multiple outsider, la bonne personne au mauvais endroit, comme il le sera pratiquement toujours. C’est ce qui fait son charme et la difficulté de déchiffrer ses mimiques et ses dissimulations: quand il parle d’européanisme dans Il Baretti, il veut dire quelque chose de complètement différent de ce que Sapegno ou Gobetti lui-même parleraient, parce que son européanisme coïncide en fait avec un régionalisme entendu dans le bon sens (il y a l’anthropologie du lieu, il y a les sous-cultures populaires qui pour lui signifient avant tout les cultures dévotionnelles des lieux, pour constituer le patrimoine profond, et à restaurer de temps en temps avec les dictionnaires de l’actualité internationale la plus récente, mais à des fins de conservation). Ce Persico est proche de l’anti-gentil Montale qui écrit dans Il Baretti au nom de la “splendeur” des croyances traditionnelles. Et il est plus proche de Malaparte que des Barettiens: c’est un moment où, dans la culture italienne, une étrange coïncidence se dessine non pas entre “nation” et monde, mais entre région (ou “province”) et monde, et nous devons en tenir compte.
Le deuxième essai est consacré, comme nous l’avons dit, à la figure de Giuseppe Bottai. Le rapport entre art et politique, dans le livre, sous-tend une interprétation originale du corporatisme fasciste, puisque, je cite l’introduction du livre, “toute la conception de l’État corporatif, ou plutôt ses présupposés prétechniques, ne sont pas pleinement compréhensibles sans la référence à l’art et à la littérature nationaux compris comme une nourriture mythique”. Le projet de Bottai a pris forme très tôt, puisque dès 1919, il écrivait que “seul l’art est la chance de sauver l’Italie”, et que “les artistes en sont les enfants les plus passionnés”, et qu’en conséquence, pour lui, l’État lui-même aurait dû être considéré comme une œuvre d’art, au point que les artistes auraient dû en assumer le gouvernement. Quelles sont les implications historiographiques de cette lecture du corporatisme fasciste?
Nous avons reçu aujourd’hui une interprétation de Bottai d’origine De Felice (partagée également par de nombreux élèves de De Felice), qui divise la carrière politique ou politico-culturelle de Bottai en trois volets qui ne communiquent pas: le Bottai futuriste, artiste, écrivain et interventionniste, le Bottai sous-secrétaire puis ministre des corporations, et enfin le Bottai tardif du ministère de l’éducation et des lois sur le paysage et le patrimoine. Ces trois volets ne communiquent pas dans l’interprétation reçue, dans le discours courant: on dit que Bottai est né vocaliste et qu’à ce titre il a participé à la guerre, qu’il en est revenu chargé de fureur patriotique, qu’il était très proche des futuristes et qu’il a fait partie du mouvement futuriste, qu’il a codirigé Roma Futurista, après quoi il a conçu l’idée (marinettienne à l’origine) que les artistes devaient entrer dans le gouvernement. La révolution nationale (ne l’appelons pas encore “révolution fasciste”, car cela veut dire beaucoup de choses, même si, aux yeux de Bottai, il deviendra de plus en plus clair que la révolution nationale sera une révolution fasciste), celle qui changera l’élite, réunira les gouvernés et les gouvernants, et écartera définitivement les classes dirigeantes libérales d’avant-guerre, classistes, conservatrices, incapables, profondément corrompues et ainsi de suite (c’est clairement l’opinion de Bottai), sera futur-fasciste et installera des artistes au gouvernement: non pas à cause d’un simple coup d’État d’artistes, mais parce que, à ses yeux, les artistes ont ces qualités de désintéressement, d’abnégation, de forte motivation et de foi qui doivent connoter les classes dirigeantes, quelle que soit l’origine des individus (au sens de Marinetti, les génies peuvent aussi être des prolétaires, mais ils doivent être caractérisés par l’imagination, la probité, la véhémence, la détermination, le projet, la vision, etc.) Lorsque ce projet échoua (et il échoua grâce à l’initiative de Mussolini qui fit basculer le fascisme à droite et condamna les futuristes à l’insignifiance en passant à des positions pro-monarchistes), Bottai (et c’est ici que commence le Bottai purement tactique, le Bottai qui cherche en quelque sorte le pouvoir) suivit Mussolini, quitta le futurisme, rejeta ces ambitions devenues vaines et commença une carrière au ministère des Corporations: fin du rapport avec l’art, fin du rapport avec les artistes. À la fin du régime, lorsque Bottai sera à nouveau écarté par Mussolini, dans le cadre de la réforme corporative de l’État fasciste, il reviendra de manière presque résignée, crépusculaire et marginale, à ses anciens intérêts humanistes. Cette reconstruction rend en fait un trop mauvais service aux motivations de Bottai et à l’importance que le débat sur les arts figuratifs a eu dans le projet fasciste et même dans le discours corporatiste. Le sens de mon discours est le suivant: l’histoire de l’art et les artistes ont offert à Bottai les matériaux pour composer son anthropologie politique dès le début. Ce “désintéressement” de l’artiste italien traditionnel, cette obstination quasi religieuse et ce désir de perfection, cette capacité à vivre dans la pauvreté payée par son art et sa foi: ce sont là certaines caractéristiques nationales que Bottai attribue aux maîtres anciens et qui composent en fait une anthropologie politique du “nouvel Italien”, régénéré par la “révolution corporative” (une sorte de Réforme, aux yeux de Bottai). La nation entière, pour Bottai, sera capable d’établir ses propres coutumes de frugalité et de s’opposer à la richesse des nations gouvernées par l’argent. Nourrie d’idéaux de foi et d’un sens profondément religieux de l’existence. Il ne s’agit pas ici d’établir à quel point ce point de vue de Bottai était vague (et il l’était certainement beaucoup). Ce qui nous intéresse avant tout, c’est de saisir certaines origines d’un “consensus” qui s’est développé surtout parmi les artistes, les écrivains, les intellectuels: les “génies” sont toujours, d’une certaine manière, au premier plan du discours de Bottai. Ce n’est pas qu’en fin de compte Bottai revienne aux artistes parce que Mussolini l’a privé de tout pouvoir réel: il revient aux artistes parce qu’il croit en eux, et il revient alors mener son combat qu’il avait mené dans le futurisme et dans lequel les artistes avaient le rôle d’une avant-garde éthico-politique, et non pas simplement culturelle.
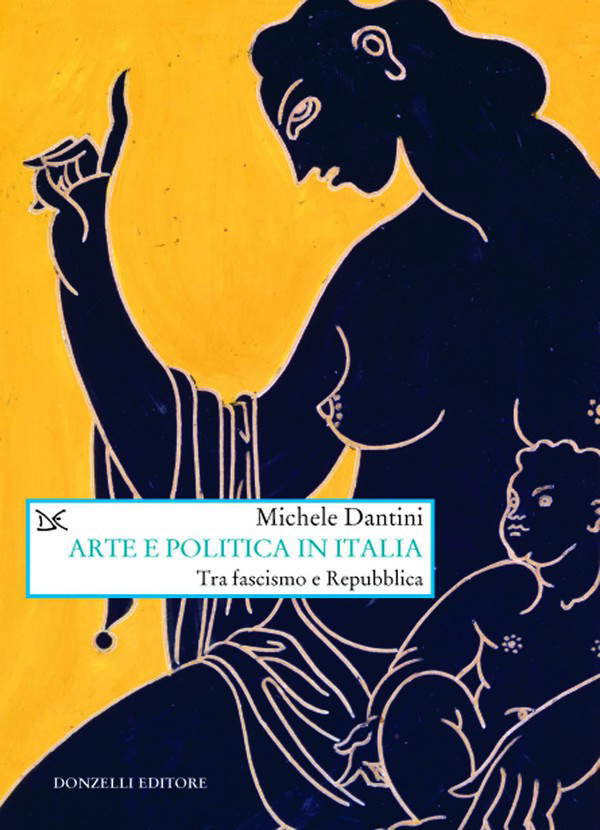 |
| La couverture du livre Art et politique en Italie entre le fascisme et la République de Michele Dantini |
Dans l’article intitulé Fronte dell’arte et publié en 1941, Bottai, se référant aux origines “révolutionnaires” du fascisme, lance un appel aux artistes pour qu’ils prennent parti, en particulier aux jeunes, en prenant soin de préciser, en citant le texte, que “le mirage d’un art étranger à l’histoire ne pourra séduire personne ayant le sens du temps”. Michela Morelli écrit dans son article du dernier numéro de la revue Piano B, consacré justement à la continuité et à la discontinuité dans l’art et la culture italienne entre les deux moitiés du XXe siècle, que Guttuso est la figure qui semble avoir été la plus consciente de cette hypothèse... mais concrètement, quelles conséquences ont eu ces intentions botaniennes de “recrutement” dans la période d’après-guerre?
Elles ont eu, à mon avis, des conséquences très étendues: ce leaderisme politique attribué aux artistes, surtout aux jeunes artistes, favorise, encourage, nourrit, à mon avis, une surestimation du rôle civil et social que les artistes peuvent jouer. Et c’est quelque chose qui n’arrive qu’en Italie. Je ne vois pas dans les autres nations européennes ce même malentendu, cette même surestimation, qui est une surestimation du moyen et du long terme, parce qu’en partant de Bottai (ou peut-être en partant de Marinetti pour être encore plus correct), donc en partant du premier appel ou du premier recrutement d’artistes d’avant-garde, de “jeunes artistes”, comme nouvelle classe dirigeante, nous arrivons aux Appunti per una guerriglia (Notes pour une guerre de guérilla ) de Germano Celant. Franchement, l’auto-positionnement et la conscience de soi ne m’intéressent pas: en faisant l’histoire, en allant au-delà de ce que les gens disent d’eux-mêmes et des témoignages individuels, il est clair qu’il existe une infrastructure mythographique et d’autopromotion qui dure au moins quatre ou cinq décennies. Du mythe de Rosai, créé dans les années 30 et auquel Persico a également contribué avec Berto Ricci (mythe qui est à l’origine de l’image de l’artiste leader, d’abord Gufino puis antifasciste, que Guttuso a déposé dans les pages de Primato), nous arrivons tranquillement, en passant par les artistes de Corrente, à l’Arte Povera, ou du moins à l’emballage curatorial de l’Arte Povera, mais aussi à la posture de certains artistes qui font partie du groupe. C’est une surestimation à l’origine d’investissements personnels discutables ; et de réputations à revoir.
A propos de l’Arte Povera, le texte mentionne un passage de Luciano Fabro qui affirme en quelque sorte que les critiques et les historiens évoluent dans l’ignorance des motivations les plus intimes du processus créatif. Il faudra donc revenir en arrière et étudier une grande partie de l’art d’après-guerre à la lumière de ces considérations, également parce qu’une grande partie de la critique s’est concentrée sur l’étude des références croisées entre l’art italien et d’autres expériences, probablement surtout l’art américain, sans toutefois s’attarder sur les poussées internes qui existent et qui sont fortes parce que, et je cite votre livre, dans l’art d’après-guerre persistent “des instances d’animation interne, de numinosité, ou de transcendance de l’image”. Vous donnez l’exemple de la propension extatique et de la disponibilité quasi cultuelle à l’image de certains mouvements, du Spatialisme à l’Arte Povera. Tout cela procède d’une “mémoire” qui, je le cite encore, “attend d’être restituée en mots”... alors que faire pour restituer cette mémoire?
Faire de l’historiographie, c’est-à-dire écrire l’histoire, ce n’est pas paraphraser, avec génuflexion surtout, ce que les historiens appellent les ego-documents, c’est-à-dire les auto-témoignages, les mémoires actuels, les déclarations des protagonistes ou de leurs contemporains. Il s’agit là d’une mise en garde préliminaire sur la méthode. Faire de l’histoire, c’est passer au crible de la critique non seulement les documents primaires, mais aussi les documents secondaires, c’est-à-dire les mémoires et les auto-témoignages. Nous avons souvent tendance, en tant qu’historiens de l’art contemporain, à saisir le micro avec lequel l’artiste parle: ce n’est pas faire de l’histoire, mais contribuer plus ou moins consciemment à une mythographie. Ce n’est pas au niveau scientifique, ce n’est pas au niveau de la mémoire enfin acceptée et partagée. Le passage important pour moi sur certaines survivances qui relient le premier et le deuxième siècle est lié à une esthétique qui est en quelque sorte religieuse, sinon à une anthropologie catholique, chrétienne, consciente de l’artiste italien ou latin (comme Penone s’appelait lui-même il y a quelques années). L’image italienne (et les monochromes italiens sont là pour en témoigner, comme certaines œuvres de Paolini), suscite la vénération, l’adoration, on s’attend à une attitude que Longhi définirait comme “affectueuse” ou adoratrice. Les “vieux maîtres” sont ici Giotto, Piero della Francesca, le Raphaël de la Madone Sixtine. Les incunables d’une telle tradition sont cultuels, loin du journalisme. Si vous avez Hogarth à vos origines, il est clair que c’est différent. Et là-dessus, jusqu’aux années 1970, on a beaucoup réfléchi, au-delà d’antithèses tout à fait extemporanées comme celle entre fascisme et antifascisme, qui aide certainement à comprendre très peu l’histoire de l’art italien du XXe siècle, qui, dans la seconde moitié, surtout jusqu’à une certaine date (c’est-à-dire jusqu’au cheval suspendu au plafond de Cattelan qui rejette tout, et qui rejette toute tragédie inscrite dans les pratiques artistiques), est une histoire de résistance et de tentative de survie, très habile, dans le sens où il s’agit toujours d’inoculer des attitudes divergentes à l’intérieur d’un style international qui est mis à jour de temps en temps. C’est une opération qui n’a rien d’anodin et d’évident, dont on ne semble pas soupçonner le moins du monde l’ampleur ni la difficulté.
L’essai sur De Felice est également utile pour cadrer ce qu’a été la relation entre les artistes et les intellectuels et “l’idée de nation”, une relation qui a souffert depuis que l’Italie d’après-guerre s’est mesurée à la difficulté de trouver des éléments ou des traits pouvant donner lieu à un sentiment d’appartenance. Les conséquences de ces difficultés se font encore sentir aujourd’hui, tant il est vrai que ce processus d’unification, ou du moins de recherche de motivations communes, ne s’est pas toujours déroulé sans heurts. Cela me rappelle l’exposition du printemps dernier au Palazzo Strozzi, où Luca Massimo Barbero a défendu l’idée que le début des années 1960 était un “moment de renaissance pour l’Italie” et une époque où “la nation s’est reconnue dans les arts et leur contemporanéité”. Une thèse qui me semble quelque peu simpliste, car les divergences étaient nombreuses à l’époque: je voudrais citer ici Emilio Gentile qui, dans son récent Intervista sul Risorgimento, a au contraire souligné que, dès le début des années 1960, ce qu’il appelle “l’oubli du sens de l’unité nationale” était évident, une lacune qui, selon Gentile, allait s’accentuer au fil des ans. Pouvons-nous identifier dans ces difficultés et ces déficiences un ensemble de tensions qui ont conduit, entre autres conséquences, à une marginalité substantielle, pour ne pas dire une absence de pertinence, de l’art dans le débat politique actuel?
Il ne fait aucun doute que Gentile s’attaque à un problème réel. D’autre part, comment pourrait-il en être autrement pour une nation qui, considérée d’un point de vue artistique et culturel, a eu une histoire si illustre pendant deux mille ans, mais qui, considérée d’un point de vue géographique, et après avoir fait éclater la bulle (car c’était une bulle: au sens géopolitique, économique et militaire) de l’“Empire” fasciste, se retrouve marginale? Il n’est pas étonnant qu’une tension se crée entre deux “nations”, l’artistique-culturelle d’une part et la politique-institutionnelle d’autre part: une tension très forte qui n’existe dans aucune autre nation occidentale, pas même en Allemagne. L’idée qu’au tournant des années soixante et soixante-dix, une “nation” puisse renaître par le biais de l’art et s’ériger ainsi sur des bases solides est donc très improbable. Je trouve ici la queue plutôt épuisée de l’attitude apologétique (ou “militante”) mentionnée plus haut: une attitude qui prive l’histoire de l’art (ou la conservation) de toute agitation et de tout éclat critique. D’un autre côté, il est vrai qu’entre les années 1960 et 1970, comme j’espère le démontrer dans des essais qui seront publiés prochainement, est apparu et est devenu explicite, sinon un rejet de la République en tant que telle, certainement une contestation de l’antifascisme républicain. Sur la voie peut-être d’une extrême gauche anti-PCI et à la lumière d’un engagement pédagogique que les gouvernements de centre-gauche avaient pris après les événements de 1960 et le danger d’un tournant autoritaire vers la droite du gouvernement Tambroni. Ce n’est qu’au début des années 1960 que l’on prend conscience des limites d’un certain antifascisme, du modérantisme d’un certain antifascisme républicain qui, au nom d’un prétendu héritage de la Résistance, s’est bien gardé de se confronter au Ventennio.
 |
| Salle d’exposition Naissance d’une nation à Florence, Palais Strozzi, 16 mars - 22 juillet 2018. |
Une lecture plus profonde permettrait en outre d’aborder l’actualité de manière plus fine et plus réfléchie.
Elle nous permettrait de ne pas être surpris si nous constatons qu’aujourd’hui encore le danger d’un effondrement de l’État unitaire se fait jour, avec un gouvernement dans lequel les composantes méridionales et nordistes se côtoient de manière plutôt funambulesque sur la toile de fond d’une Italie qui a certainement deux vitesses, deux temps, deux anthropologies, deux systèmes de distribution des richesses et d’usages ou de cultures du pouvoir. D’autre part, les années 1920 et 1930 ont été des décennies où, contrairement à aujourd’hui, on discutait librement du problème de l’unification, de ce que l’on appelait à l’époque la “conquête royale”, qui a montré ses limites en tant qu’annexion dynastique et militaire substantielle qui n’avait en rien préparé, ni avant, ni immédiatement avant, ni dans les décennies qui ont suivi, une cohésion culturelle. Gian Enrico Rusconi, qui n’est certainement pas un fasciste mais un historien et un sociologue modéré, très compétent et préparé, parlait il y a quelques décennies des “motivations d’être ensemble”, c’est-à-dire d’être loyal, mutuellement correct, honnête, de payer des impôts, de se faire confiance: tout cela manque en Italie, et nous ne pouvons pas vraiment penser que le problème n’existe pas ou ne devrait pas exister, ou que l’art des années 1960-1970 l’a résolu. Il s’agit de fantasmes à mourir de rire, de bandes dessinées pour adolescents.
Enfin, l’essai sur De Felice soulève le problème de la survie de la “religion politique, patriotique ou civile” dans l’après-guerre, un problème de grande envergure qui, comme le souligne le livre, ne peut être abordé que de manière préliminaire en l’espace d’un court essai. S’agit-il donc d’un prélude à de nouveaux travaux et de nouvelles études sur ce thème, que nous devrions attendre à l’avenir?
Oui, c’est un prélude, et d’ailleurs, dans l’introduction, je présente ce livre comme les premiers jours d’une vaste fresque à venir. Ou même: les essais de ce livre sont trois incrustations, trois pièces d’une mosaïque qui se construit au fil du temps. Deux nouveaux essais sont en cours de publication dans deux revues académiques, mais seront bientôt rassemblés dans un livre sur le mythe du “jeune artiste”, un mythe trans-idéologique au tournant des années 1920 et 1930 (j’analyse surtout le consensus formé autour de Rosai d’une part, et le récit enfermé dans le texte de Persico Via Solferino: les idéologies en jeu sont différentes, mais en fait convergentes). D’autres suivront prochainement, dont une relecture dans une clé historico-politique par Carla Lonzi.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.



























