Luca Pancrazzi : "Une peinture ? C'est une fenêtre. Et c'est l'anneau principal de l'art
Une conversation pour en savoir plus sur l’art de Luca Pancrazzi (Figline Valdarno, 1961). Après ses études universitaires à Florence, Pancrazzi se rend aux États-Unis où il rencontre Jo Watanabe et travaille dans son studio sur des graphiques et des dessins muraux pour Sol Lewitt. Jusqu’en 1992, il travaille à Rome pour Alighiero Boetti. Depuis les années 1980, il est l’auteur de recherches basées sur l’analyse du médium artistique, de ses ramifications, des possibilités créatives de l’erreur et de l’utilisation composite des techniques et des matériaux. L’espace métropolitain et le paysage, dans leur continuité avec le regard anthropique qui les définit, sont les thèmes qu’il traite le plus assidûment. Il s’exprime à travers la peinture, le dessin, la photographie, la vidéo, l’installation environnementale, la sculpture, les actions partagées avec d’autres artistes et les projets éditoriaux. Il expose depuis le milieu des années 1980 et, depuis 1996, a été invité à participer à une série d’expositions internationales, dont la Biennale de Venise (1997), la Triennale de Vilnius (2000), le Whitney Museum of American Art at Champion (1998), la Biennale de Valence (2001), la Biennale de Moscou (2007) et la Quadriennale de Rome (2008). Quelques-uns des nombreux espaces publics qui ont présenté son travail : P.S.1 Contemporary Art Center (1999), Galleria Civica di Modena (1999), Museo Marino Marini (2000), Palazzo delle Papesse (2001), Museo Revoltella (2001), Galerie Lenbachhaus und Kunstbau (2001), GAMEC (2001), Museo Cantonale d’Arte di Lugano (2002), Centro per l’Art contemporain Luigi Pecci (2002), Zentrum Fur Kunst und Medientechnologie (2003), PAC (2004), MAN (2004), MART Trento et Rovereto (2005), MAMbo (2006), Macro (2007), Vietnam National Museum of Fine Arts (2007), Fondazione Pomodoro (2010), Museo per Bambini di Siena (2010), Palazzo Te (2016), Santa Maria della Scala (2023), Gallerie degli Uffizi (2024). Il vit et travaille à Milan.
GL. Luca, pour de nombreux artistes, l’enfance coïncide avec la première manifestation des symptômes d’appartenance au monde de l’art.
LP. Tous les artistes, et même les non-artistes que je connais et que j’ai connus, ont eu une enfance. En apprenant à les connaître et à me connaître moi-même, j’ai appris que tout le monde en avait eu une plus ou moins belle. Autant d’enfances créatives, artistiques, comme doivent l’être les enfances, débarrassées des schémas qui rempliront leur esprit plus tard. La condition de l’artiste est celle de la conscience et de la détermination à l’être, l’enfance par contre est la condition de la liberté par excellence, sans conscience et sans prise de conscience. Cette conscience ne peut appartenir qu’à une période ultérieure, une période d’apprentissage et de formation où la construction de l’être humain est dans cette phase de critique du monde et en même temps d’amour pour lui. Créer et détruire fait partie de l’adolescence et, dans cette phase, les angoisses peuvent se transformer en conditions de prise de conscience et de détermination. La sphère sexuelle et, comme nous le disons aujourd’hui, la sphère du genre connaissent à cette période de la vie une tempête continue de stimulations conscientes et inconscientes et, dans ce mouvement fluide et magmatique de la conscience, se forment les structures de l’être qui se construiront par la suite. Je me souviens du moment où j’ai abandonné mes premières aspirations à devenir documentariste sans avoir jamais essayé de l’être. Enfant, je photographiais déjà, d’abord en reproduisant les poses et les photos prises par mon père, puis en documentant les sorties familiales et, plus tard, en peignant et en dessinant sur les photos que j’avais prises. Mais la conscience d’appartenir au monde de l’art, comme vous le dites, ne pouvait pas être présente. Dans mes pensées, l’artiste était une personne solitaire et un franc-tireur capable de prolonger la liberté de l’enfance jusqu’à la puberté et l’adolescence, puis d’espérer le monde des adultes. Si j’ai commencé à avoir une once de conscience d’appartenir au monde de l’art, cela a probablement coïncidé avec la fin de toutes ces aspirations pures, et cela a donc dû être une période de déception réaliste. Cela s’est fait progressivement, pas soudainement, en me heurtant à la réalité année après année, en m’éloignant de l’enfance et en cherchant mon autonomie. Les difficultés de cette nouvelle condition sociale m’ont fait prendre conscience que j’étais en marge de la société et que je devais donc y trouver la force de continuer. Aujourd’hui encore, je me sens en marge de la société et du système artistique en même temps, je ne suis pas sûr d’avoir jamais pu appartenir à l’un ou à l’autre, au sens où vous l’idéalisez dans la question que vous avez posée.
Dans ce parcours que vous racontez, y a-t-il eu des rencontres importantes de bons ou de mauvais professeurs ?
Dès que j’ai pu choisir par moi-même, je me suis inscrite à l’école d’art, j’étais à Florence et c’était à la fin des années 1970. Dans ce lycée situé à la périphérie de la ville de Florence, j’ai rencontré des professeurs préparés et d’une certaine profondeur. Mon professeur de peinture a été un premier point de référence important pour la peinture dans ces années-là, avec lui j’ai appris à reconnaître l’art contemporain et les lieux où il était visible, nous allions voir des expositions et il nous emmenait dans son atelier, avec le recul je peux dire que c’était un maître en plus d’un bon professeur. Durant les années de l’académie florentine, hormis quelques professeurs remarquables, le cours de peinture est plombé par un personnage incapable de donner des enseignements et des références à ses élèves. Un postmodernisme baroque, alourdi par des parodies de citation, sévissait dans tous les domaines, du design à l’art, en passant par la littérature et le graphisme. Par choix, j’ai interrompu l’académie à cause de ces chers enseignements et de mon irrépressible besoin de comprendre. En dehors de l’académie, dans ces années et dans celles qui ont suivi, jusqu’au début des années 1990, j’ai eu la chance de rencontrer et de travailler pour deux artistes qui allaient marquer la nouvelle partie de ma vie. J’ai travaillé pour eux à New York et à Rome, entrecoupant des périodes pour l’un ou des projets pour l’autre, et j’ai quitté Florence. Deux maîtres très différents, opposés, si différents qu’ils finissent par se ressembler.
Comment ces deux rencontres se sont-elles produites ? Les avez-vous sollicités d’une manière ou d’une autre ou, le cas échéant, tout s’est-il produit par hasard ?
Pour reprendre les termes de A. & B., je pourrais répondre que “les choses arrivent par nécessité et par hasard”.
Il y a quelque temps, vous m’avez parlé d’une autre rencontre importante, celle de Maria Luisa Frisa. Quand et comment vous êtes-vous rencontrées et quelle importance Maria Luisa a-t-elle eue dans votre introduction au système artistique ?
J’ai rencontré Maria Luisa Frisa au début des années 1980, à Florence. Au cours de cette décennie, Florence était une ville très active et vivante, animée par des présences intéressantes et des galeries d’art comme on n’en avait jamais vu. La musique, le design, la mode, l’art et le théâtre expérimental étaient les protagonistes des places, des théâtres des centres, des caves, des nuits, des palais des discothèques et des salons. Les événements privés, clandestins et institutionnels se mêlaient aux fêtes, aux raves, aux concerts, aux expositions, aux performances, aux réceptions, aux présentations, et Maria Luisa Frisa était au centre de cette vie artistique et culturelle, elle avait lancé un périodique, et avait organisé des projets et des expositions qui ont été déterminants pour ma formation. Nous nous sommes beaucoup fréquentés pendant cette période et au-delà, puis nous nous sommes perdus de vue. En 1989, j’avais mon atelier dans la campagne florentine, dans une vieille villa sauvée de l’abandon et des ronces qui s’y étaient accrochées, nous avons organisé une résidence artistique en invitant des collègues artistes qui venaient principalement de Milan et de Florence. C’était pour moi une forme de prototype que j’ai continué à cultiver au fil des ans avec divers projets de collaboration. Castello in Bisticci a été une expérience de partage du temps et de l’espace, où des œuvres ont été réalisées au cours de cette pratique participative. L’exposition était un événement secondaire qui concluait la partie conviviale. Être ensemble sans projet curatorial était l’objectif, s’impliquer sans protection et sans filtre était la pratique. Lors de la fête finale, je me souviens que Maria Luisa Frisa était avec nous pour partager ce moment, et ensemble nous avons imaginé la possibilité de documenter ce qui s’était passé à travers l’œil d’un photographe qui était avec nous à ce moment-là et à partir de sa plume, qui a laissé un témoignage sur un livret improvisé qui a été imprimé plus tard.






Vous êtes également à l’origine de votre première exposition à la galerie Vivita, n’est-ce pas ?
Deux amis avec lesquels je partagerai plus tard un bout de chemin avaient été invités à un concours dans le cadre d’événements sociaux à la discothèque Manila de Campi Bisenzio. La soirée s’intitulait “First Graffiti Competition” et j’y ai participé en enfilant les chaussures du graffeur. Résultat : je me suis beaucoup amusé et notre graffiti plutôt performatif et radical a été récompensé par la création d’un autre graffiti à l’intérieur de la galerie Vivita. Maria Luisa Frisa faisait également partie du jury pour le prix, elle a donc indirectement participé à la prise de conscience du maintien de notre groupe, qui fonctionnera les années suivantes sous le nom d’Importè d’Italie. Avec Pedro Riz’ A Porta et Andrea Marescalchi, nous avons ensuite continué à travailler dans des contextes mixtes, consacrant une décennie d’activité artistique et de performance sous ce nom collectif.
À Florence et plus généralement en Toscane, comme vous l’avez mentionné plus tôt, il y avait une grande effervescence dans ces années-là : qui étaient les artistes que vous fréquentiez, y avait-il un débat entre vous, sur quels sujets ?
L’effervescence était le résultat de la sortie d’une période d’“austérité” et des “années de plomb” des années 1970. Les années 1980 ont été une période de renaissance du point de vue de la créativité et au-delà. C’était la dernière période heureuse avant la réalisation du contrôle numérique privé et institutionnel total que nous vivons actuellement et que nous verrons s’implanter dans nos vies au cours de la décennie suivante. Le monde était analogique, mécanique et magnétique, les artisans remplissaient les villes italiennes et, dans les banlieues, on innovait dans les technologies de production tout en maintenant un produit de haute qualité et artisanal. À cette époque, je vivais à Florence, j’avais un atelier dans la campagne florentine et je voyageais souvent aux États-Unis où je passais également de longues périodes. À Florence, je fréquentais les artistes de ma génération et de la précédente qui se mêlait de manière un peu suspecte à la nouvelle. Je travaillais à Rome dans l’atelier de A. et B. où passaient galeristes et marchands et nous allions ensemble aux expositions des artistes de sa génération ; je rencontrais ensuite les plus jeunes lors des vernissages. De Florence, je voyageais souvent, visitant les expositions d’amis artistes à Bologne et à Milan, surtout lors des vernissages. À New York, en travaillant pendant un certain temps avec l’atelier qui a produit les œuvres de Sol Lewitt, j’ai rencontré quelques artistes proches de ce monde.
quelques artistes proches de ce monde qui tournait autour de l’imprimerie de Watanabe où étaient conçues les formules de couleurs des dessins muraux. Le débat entre les artistes les plus proches de nous était le ciment de ce temps passé à percer les secrets de l’art contemporain tout en profitant du spectacle de la fin des avant-gardes et des mouvements avec un sentiment de liberté enivrant et souvent dispersif. Les artistes étaient peu nombreux, nous les comptions sur les doigts de la main, nous prenions en compte les œuvres des maîtres et des artistes des générations qui nous précédaient et nous essayions de les surpasser en habileté, en perspicacité et en inventivité.
Votre génération a été la première à se libérer du poids des oppositions et de la politisation de la culture, ce qui lui a permis de passer plus librement d’une langue à l’autre. Parmi les premiers destinataires de ces nouvelles instances se trouvaient certainement Marsilio Margiacchi et Luciano Pistoi : comment les avez-vous rencontrés et quelle relation s’est créée avec eux ?
Soustraits ou non, nous étions et avons toujours été soumis à d’énormes pressions individuelles, malgré les alignements des galeries et les écuries des critiques de ces années-là, nous avons essayé d’avancer de manière indépendante, comme des éclats impatients qui trouvaient des moyens possibles et impossibles de mettre nos œuvres en exposition. C’est Antonio Catelani qui, un jour, m’a indiqué un curieux galeriste moustachu d’Arezzo qui serait prêt à s’intéresser aux jeunes artistes, que l’on qualifiait à l’époque d’émergents. Arezzo a toujours été une ville endormie, nichée dans la campagne, en marge des caravanes touristiques qui sillonnaient la Toscane et l’Italie, et n’a connu son premier développement industriel qu’après la Première Guerre mondiale, mais celle-ci a permis aux métayers et aux paysans de devenir des citoyens et des artisans, élevant ainsi le niveau économique de la communauté. Avec un petit groupe d’artistes, dont Gianluca Sgherri avec qui j’avais partagé mes études secondaires florentines, nous avons commencé à fréquenter Marsilio Margiacchi qui nous a d’abord laissé nettoyer la galerie de son mobilier et a ensuite participé avec enthousiasme à la planification des expositions, ouvrant des collaborations avec tous les nouveaux artistes disponibles en Italie. Pendant cette période intermédiaire, avant de déménager à Milan, je m’étais installé dans la campagne d’Arezzo, dans un bâtiment industriel rural inhabituel, et je pouvais suivre les projets directement avec Marsilio sur une base presque quotidienne. C’est d’ailleurs avec lui que nous avons atterri à Volpaia, au cœur du Chianti, où une communauté turinoise s’était installée et avait créé un centre d’art. À Volpaia, Luciano Pistoi a préparé un événement annuel qui ouvrait la saison des expositions, l’un des premiers événements artistiques périodiques qui utilisait tout le contexte du village et impliquait ensuite la communauté dans la célébration finale et l’inauguration. Des gens du monde de l’art venaient de partout, des critiques, des artistes collectionneurs, des amateurs d’art, des journalistes, des galeristes et des étudiants. J’ai participé à une édition en 1992 avec des artistes intergénérationnels venus de toute l’Italie et nous avons passé de belles journées à discuter avec Pistoi et Margiacchi, à parler d’art et d’autres choses, à évaluer des artistes, à planifier des expositions, et Luciano visitait souvent la galerie d’Arezzo.




La première exposition chez Margiacchi présentée par Maria Luisa Frisa était une exposition de groupe au titre symbolique de “Change”, un titre tiré de l’une de vos œuvres publiée sur la couverture du catalogue. Outre Gianluca Sgherri, Andrea Santarlasci a participé à l’exposition avec vous : quels ont été les épisodes suivants de l’aventure d’Arezzo ?
L’exposition Cambio in pratica était une exposition sans titre qui portait le nom de l’œuvre de la couverture choisie avec les autres artistes. Cette exposition a marqué un tournant pour la galerie Marsilio qui, à partir de ce moment, a consacré plus de temps aux jeunes artistes : ce changement a nécessairement impliqué une redéfinition de l’espace d’exposition pour l’adapter aux nouvelles exigences de propreté formelle et d’absence d’ameublement. Seule la moquette brune a survécu pendant un certain temps, et ce n’est que quelques années plus tard que j’en ai fait une œuvre lors d’une exposition avec Marco Cingolani, une double exposition solo dans laquelle j’ai idéalement retourné le sol jusqu’au plafond et y ai accroché des peintures. Des peintures qui représentaient les personnes de l’exposition précédente vues d’en haut, du plafond. Maria Luisa était très présente à l’époque en Toscane et suivait particulièrement le groupe d’artistes proches de la galerie Margiacchi. En 1991, nous avons exposé non seulement à Arezzo, mais aussi à Florence au Palazzo della Provincia, à Rome à la galerie Sala 1 et à Milan au Corrado Levi Studio, puis elle a organisé un de mes projets d’exposition au Museo Marino Marini en 2000. En 1993, j’ai entamé une collaboration avec la Galleria Mazzoli à Modène, qui a duré plusieurs années, et en même temps avec la Galleria Continua. L’année suivante, j’ai déménagé mon atelier à Milan et beaucoup d’autres choses ont changé.
Sur quoi se concentre votre travail en ce moment ?
Ces derniers temps, j’ai beaucoup travaillé sur la peinture et le dessin, car je fais toujours des cycles d’œuvres qui proviennent souvent d’autres cycles éloignés dans le temps, etc. Je suis un fil logique, que je perds ensuite ponctuellement, j’essaie d’être cohérent et je me trahis ponctuellement, j’essaie de garder à l’esprit les choses importantes et je me distrais ponctuellement avec des choses futiles et inutiles, j’essaie de comprendre ce que mon travail a produit et je me distrais ponctuellement dans l’interprétation en me concentrant sur le détail, j’essaie d’avoir un parcours cohérent et je trahis ponctuellement les attentes. C’est la leçon que j’ai reçue et c’est ce que je mets en pratique.
L’archive est-elle pour vous un moyen de faire revivre le mécanisme de trahison que vous décrivez plus haut ?
L’archive est une méthode, la trahison est une défense, si vous voulez introduire le sujet de l’archive, je peux vous dire comment certaines obsessions avec diverses méthodes d’appropriation ont été transformées en collection et ensuite archivées. Les images sont un patrimoine de l’humanité même si elles sont protégées par le droit d’auteur. Je les collectionne et les catalogue. Je collectionne de multiples sujets, je les sélectionne et j’en rejette beaucoup, j’en écarte certains, je les liquide, je les peins ou je les imprime de toutes les manières possibles, je les imprime dans mon esprit. Je collectionne, par exemple, les étoiles des années 1980, les images imprimées avec des étoiles, les détails des drapeaux, des médailles sur les vestes des généraux et des militaires, des décorations sur les chapeaux et dans les drapeaux, dans les bannières et imprimées sur les T-shirts des passants capturés dans les images que je découpe, que j’arrache, dans n’importe quelle revue ou n’importe quel journal. Au fil des années, la collection s’est agrandie, elle est devenue un véritable Star System, une œuvre indépendante. Les stars ne manquent jamais dans les images publiées, elles sont un véritable continuum dans le standard photographique, elles sont très à la mode à n’importe quelle époque, militaires, terroristes, sportifs, starlettes de cinéma, ils les montrent tous avec fierté et les apportent dans mes archives à travers leurs images imprimées Comme pour les images des stars, j’ai dans mes archives beaucoup d’autres sujets divisés en catégories et en thèmes, tous classés par ordre alphabétique. Avec le temps, l’archive devient une méthode, elle est alimentée automatiquement, elle devient un mode de vie qui conduit ponctuellement à sa trahison, elle est reniée si elle est cultivée, elle est évitée si elle est présente, elle est exclue si elle est indispensable.
En plus de cataloguer et de collecter les images qui vous intéressent, archivez-vous également votre travail ?
L’archive en tant que forme d’art est une chose et l’archive en tant qu’organisation d’œuvres et de matériaux en est une autre. Il y a quelques années, j’ai fondé A.L.P., Archivio Luca Pancrazzi, qui est un lieu physique où sont rassemblées toutes les œuvres, la documentation photographique, les documents biographiques et bibliographiques, les catalogues et tout ce qui entoure les œuvres. C’est un espace de photographie, de catalogage, de conditionnement et d’archivage.
Alors, en revenant aux épisodes initiaux et en profitant de l’archive, je voulais vous demander de vous concentrer sur quelques œuvres des débuts en racontant leur genèse et leur développement dans les travaux ultérieurs. La première est le volume pneumatique transparent Collecting Space présenté à Volpaia, la seconde est l’installation réalisée sur le plafond de la Galleria Margiacchi à l’occasion de l’exposition avec Marco Cingolani.
Collecting Space, dans le sens d’espace vide, tel était le titre original et la signification de l’œuvre que j’ai construite pour l’exposition Spendente, à Volpaia, en Toscane, en 1992.
Je voulais mettre en évidence la contradiction du sens de collection en parlant d’un objet impossible à posséder tel que l’espace vide. L’œuvre prenait en considération une portion de l’espace réel à l’intérieur du village, en la découpant, en la révélant simplement et en l’exposant à travers un gonflable en pvc transparent construit en traçant exactement l’architecture du volume interne d’un métro piétonnier qui reliait deux petites places à l’intérieur du développement urbain spontané du petit village. Je m’intéressais à cette portion de vide entre les deux bâtiments qui la délimitaient. Cette sculpture n’était rien d’autre que la révélation du vide qui nous entoure. Pour le mettre en valeur, j’avais besoin d’une coquille qui le contienne et le délimite. Ce projet était le premier d’une série réalisée grâce à la technique du gonflable, qui tentait de mettre en avant la relation entre la nature du monde révélée par un scan qui, inversé, prendrait en compte les parties vides plutôt que les volumes pleins classiques que nous avons l’habitude d’évaluer. La lecture en négatif scanne le monde pour révéler ce qui est caché, mais les vides nous parlent des solides, les révélant comme si nous les voyions pour la première fois. L’œuvre de Volpaia était un grand tube de pvc transparent soudé dans la forme du métro entre deux petits carrés. Fabriqué sur mesure, parfaitement collé, dès que nous l’avons gonflé, j’ai apprécié l’effet inattendu du soleil qui l’a touché à une extrémité, ce qui a fait courir la lumière sur l’épaisseur du pvc et a éclairé tout le tube d’une lumière réfléchie qui l’a transformé en un volume de glace. À cette époque, je développais la construction de formes et d’images à partir de volumes et d’espaces vides de différentes manières, de sorte que même les sculptures en cire de l’exposition de Volpaia n’étaient rien d’autre que des moulages de formes vides dupliquées pour former de nouveaux volumes. Au cours de la même période, dans la galerie Margiacchi, j’ai pu mettre en lumière, dans une double exposition personnelle, un autre aspect de l’espace qui nous entoure et que nous habitons. L’exposition était partagée avec Marco Cingolani qui a utilisé l’un de ses thèmes du moment pour créer une sorte de sculpture picturale, celle d’un astronaute blessé. Dans son travail, le sujet était le cosmos, l’espace exploré par les astronautes, et il était particulièrement utile pour moi de jouer avec l’idée d’espace, même si dans mon cas il s’agissait de l’espace de la galerie elle-même. Un espace terrestre en relation avec un espace cosmique. La conception de cette installation est née de l’exposition précédente de Federico Fusi dans la galerie, où j’avais pu installer un appareil photo au plafond, contrôlé à distance par une télécommande avec laquelle je photographiais toutes les personnes d’un point de vue zénithal. Certaines personnes ayant remarqué l’engin ont levé les yeux et j’ai pu les photographier dans cette pose inhabituelle, le visage tourné vers l’observateur. À partir de ces photos, j’ai réalisé 11 tableaux que j’ai accrochés au plafond, non sans avoir tendu une toile brune comme la moquette au sol. Un espace symétrique et renversé a été créé où les nouveaux visiteurs de la galerie pendant mon exposition pouvaient observer ce renversement et en faire partie. Souvent, un sujet s’observait lui-même renversé au plafond. L’espace et le temps étaient la colle intermédiaire, le sujet principal de l’exposition, et en même temps l’espace devenait cosmique et la scène du drame de l’astronaute.




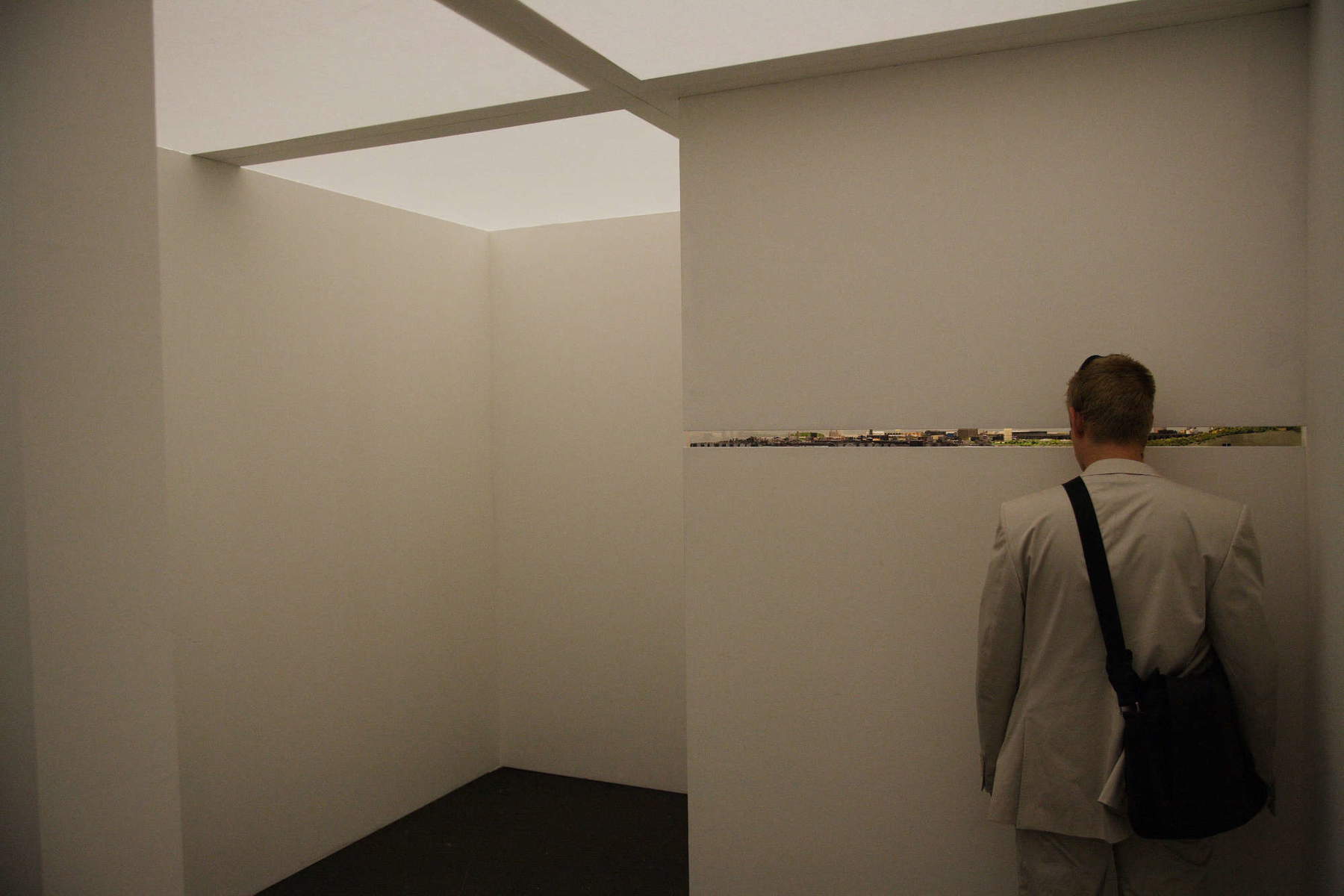

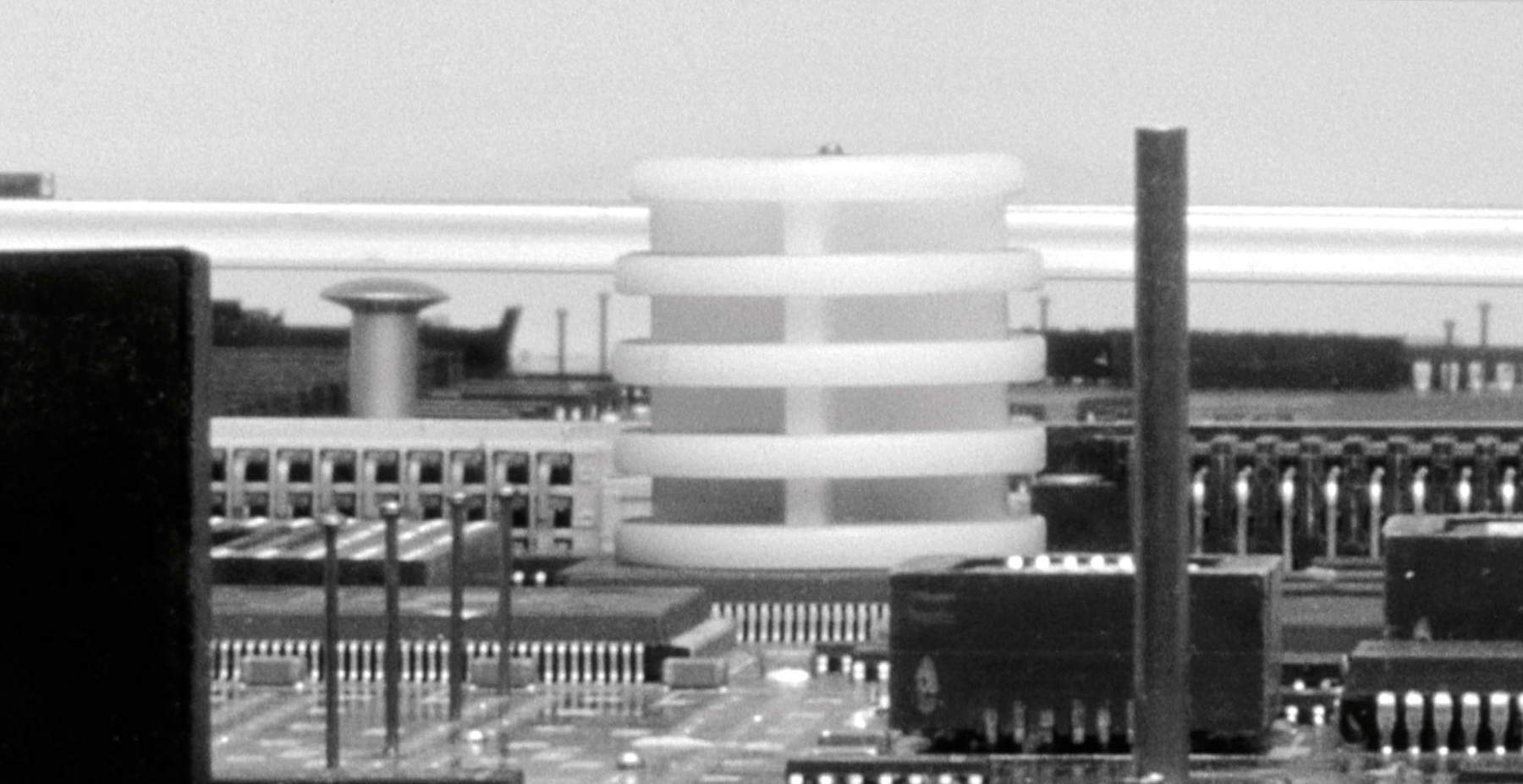
L’espace et le temps sont deux éléments qui occupent une place centrale dans votre travail et que vous avez interrogés de diverses manières au fil du temps. Un autre élément qui me semble avoir son propre caractère poignant est l’aspect ludique qui provient peut-être du contact étroit avec A. et B. : pouvez-vous en parler ?
Le vingtième siècle a commencé avec la théorie de la relativité d’Einstein et a marqué tout le siècle, je suis né en 1961, au plus fort du boom économique et positiviste, la remise en question des certitudes de notre époque était une mission linguistique et une pratique quotidienne d’opposition à tout ce qui venait et était déjà le résultat des pires prémonitions lucides et cyniques. Le pop art, l’art conceptuel, le situationnisme nous appartenaient comme la pire peinture post-transavant-garde appartient aux jeunes artistes d’aujourd’hui. Nous étions les derniers habitants de cette planète à vivre pour le jour, mettant des bâtons dans les roues de la naissance des contrôles sociaux depuis l’aube de l’électronique, notre exercice était d’esquiver la frontalité de l’immense futur qui rendait le ciel à l’horizon noir et lugubre, mais vivre pour le jour était à la fois la défense naturelle pour maintenir notre liberté et l’instrument de l’opposition. Le temps et l’espace étaient les linéaires d’Einstein. L’espace était infini mais pas encore courbé, et la mécanique quantique, bien que née dans le même siècle, un peu plus tard que la relativité, avait été contestée par Einstein lui-même et attendrait le nouveau siècle pour être mieux acceptée, testée et popularisée. Le jeu, avec ses règles, était pour moi un exercice d’intelligence, je construisais de nouveaux jeux dès mon plus jeune âge, avec mon frère, en partie en utilisant d’autres choses et la construction des règles était la partie la plus complexe et la plus intéressante, le jeu servait ensuite à sa mise au point et à sa vérification. Nous jouions beaucoup, nous vivions dans le jeu dans notre petite chambre, dans cette même chambre qui plus tard, dès qu’il a emménagé dans sa nouvelle chambre, est devenue mon premier studio, où j’ai continué à inventer et à vivre dans le jeu. Ensuite, les calembourmes linguistiques, les anagrammes, les énigmes, faisaient partie du langage et de la manière de continuer à jouer avec l’art. Ils sont toujours entrés plus ou moins par la fenêtre et par la porte d’entrée dans mon travail et dans celui des artistes avec lesquels j’ai souvent collaboré. La collaboration avec Boetti dans son travail a certainement renforcé cet aspect et m’a donné la sécurité nécessaire pour pouvoir continuer à laisser une place privilégiée à cette pratique.
Tout à l’heure, lorsque vous parliez de “Collecting Space”, vous vous êtes attardé sur la description de la lumière se reflétant sur la matière transparente du volume en PVC, ce qui renvoie inexorablement à la peinture, un autre des points cardinaux de votre travail. Je vous invite à approfondir cet aspect, par exemple en nous expliquant comment sont créées les peintures blanc sur blanc et comment cet aspect de votre travail s’est développé au fil du temps...
Comme je semble l’avoir toujours dit, je suis artiste et peintre, l’approche rétinienne prévaut dans l’art que je fais, même lorsque j’aborde la sculpture, la tridimensionnalité, mais dans ce cas, je reconnais que le contrôle se soustrait de temps en temps. La peinture reste une sorte de fenêtre, et même si la fenêtre était cassée, brisée, sans verre, ou avec du verre brisé, ou fermée et les stores vénitiens baissés, cette fenêtre est le confort formel et conceptuel de la peinture et est le principal objet incontournable auquel les peintres se réfèrent, la peinture a toujours été le principal anneau de l’art. Ce monde dans l’espace de la galerie, dans l’espace de la ville, dans l’espace du monde, déclenche une relation inéluctablement fractale en devenant le sujet même de tous les tableaux, dans un jeu infini de reflets et de renvois tout en restant dans un espace qui a des limites. Pour le peintre, cet espace est la possibilité et l’ambition du contrôle, ou tout ce qui produit le cadre d’une tentative de contrôle à travers le chaos de la matière. L’artiste peintre présume être le créateur de ce chaos, responsable de son échec ou de sa réussite. Mais de plus en plus fréquents et bienvenus sont tous ces exercices de sortie de l’espace du tableau qui provoquent progressivement la tendance à déplacer l’attention vers les bords, de la feuille de papier comme de la toile, vers l’épaisseur, vers l’arrière... puis le tableau repose sur le sol, la feuille de papier est jetée en l’air, la toile est trouée, les surfaces sont déchirées, la toile est retirée du châssis et mal remontée, avec des plis et des abondances jetables, la peinture ne s’arrête pas au bord du tableau, elle continue sur le mur, sur le sol, elle sort par la porte et déambule sur les trottoirs, elle se dilate sur les façades et devient gazeuse, colorant l’air, et disparaît à l’infini pour aller se perdre dans la nature....et disparaît sans cesse pour se figer avec les basses températures émotionnelles et se figer à nouveau dans des formes tridimensionnelles, pétrifiées ou de mémoire résineuse liquide, rentrant de la rue par la porte d’entrée ou même par la fenêtre et ensuite dans la chambre. Le contrôle est perdu au profit de la super-catastrophe de tout ce qui ne peut être contrôlé. Ce monde en mouvement borde le tableau, le convainc d’être inclus, aspiré, tous ces éléments extérieurs font partie du volume total de ce qui est devenu une installation. C’est ainsi que les peintres ont acquis, par une prise de conscience généralisée, cette ambition moderne de vouloir contrôler l’espace d’installation de l’exposition, le rythme et les accessoires d’ameublement qui entourent le tableau, la plinthe, le sol, la lumière, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que la peinture est peinte dans un autre lieu où cette neutralité n’est pas là, la peinture, si elle n’a pas d’espace, n’a pas d’espace. la peinture, si elle n’est pas in situ, naît dans le chaos de l’atelier, un chaos organique que l’artisteécartelé répand chaque jour par ses entrailles sur les toiles plus ou moins préparées et désinfectées. Je me sens donc moi aussi un peintre militarisé par la réalité du monde, mais je laisse surtout mon ambition de maîtrise totale de l’espace qui m’entoure à des cycles d’œuvres autres que la peinture. J’ai toujours privilégié la lumière naturelle pour le fait qu’elle n’est jamais la même, qu’elle progresse au cours de la journée, qu’elle se réchauffe ou se refroidit au cours de l’évolution entre le lever et le coucher du soleil, qu’elle s’assombrit soudainement au passage d’un nuage, et qu’elle véhicule l’idée du temps et de la précarité avec ces changements cycliques. J’aime tellement la modulation de la lumière naturelle que, pour l’apprécier pleinement, j’ai passé de nombreuses années de ma vie à travailler la nuit, en utilisant des projecteurs pour agrandir mes images, afin de pouvoir garder les fenêtres ouvertes et apprécier l’arrivée de l’aube avec laquelle je terminais ma journée de travail. Dans l’obscurité, les yeux s’habituent au peu de lumière et le cerveau achève de reconstruire le monde à partir de ces quelques flashs. Du noir, les formes émergent et se révèlent à la lumière. J’ai donc commencé à peindre des tableaux en partant du minimum, du nécessaire, en limitant la construction des formes par la couleur blanche, celle avec laquelle on peint les lumières. Le même blanc qui est mélangé à la craie utilisée pour donner un fond à la toile à peindre. Dans cet espace de préparation, j’ai commencé et terminé la peinture, ce qui laisse alors apparaître les parties plus sombres par manque de peinture. La toile naturelle est alors le ton du fond, et en diluant le pigment à doses homéopathiques, j’ai réalisé des paysages et des natures mortes. Ma dernière exposition à New York, dont le catalogue sort maintenant, après plus d’un an, a pour sujet la lumière, le titre Flash Light force l’aspect lié à cette représentation, l’amenant vers l’éblouissement, la réflexion, le contraste, que la lumière provoque dans certains cas.
L’idée de l’éblouissement rappelle une autre de vos œuvres, celle de la Maserati recouverte de fragments de verre transparent, une pratique que vous avez également exercée sur d’autres objets (montres, chaises, etc.) qui font partie de votre iconographie. Ces œuvres interrogent-elles aussi la lumière ?
Tout explore la lumière, même l’obscurité. Le cycle d’œuvres qui se termine par “rundum” fait référence au matériau carborundum, d’où le titre (car)borundum, et il était inévitable que la première œuvre de ce cycle soit une voiture. Je voulais qu’elle soit itinérante et la première Carborundum a voyagé dans Pescara en 1996 lors d’un “Fuori Uso”, elle a voyagé à l’intérieur de l’exposition et à l’extérieur dans le quartier d’en face. Avec cette première œuvre, j’ai appliqué la technique qui a servi plus tard pour les œuvres de ce cycle. J’ai pensé à recouvrir la voiture de fragments de verre incassable provenant des voitures elles-mêmes. Je voulais une perle de verre qui simule à une macro-échelle la fonction d’un matériau abrasif et en même temps lumineux. L’œuvre devait être aussi abrasive que l’est le carborundum utilisé pour fabriquer des feuilles et des matériaux abrasifs, et elle devait réfléchir la lumière comme peut le faire le verre afin de briser la forme compacte de l’objet et de la fragmenter par des reflets, de la même manière que ma peinture blanche produisait les formes qu’elle représentait. Éclats de lumière abrasive. De même que la couverture abrasive de certaines publications situationnistes guydebrandiennes produisait l’effet de consumer les livres voisins chaque fois qu’on les sortait et les remettait dans la bibliothèque, de même ma voiture carborundomisée, en passant dans la ville, lissait, usait tous les coins et toutes les aspérités en rendant les choses et les maisons lisses. Ces jours-là, à Pescara, une tempête de pluie et de vent a ravagé les entrepôts en plein air des grandes entreprises de verre de la région. J’ai ainsi pu disposer gratuitement d’une quantité inimaginable de verre, mais surtout j’ai pu choisir parmi les différents lots brisés. Je me suis donc écarté du projet initial d’utiliser du verre incassable pour me tourner vers les éclats de verre clair, beaucoup plus menaçants. J’ai opté pour du verre de forte épaisseur et du verre super-clair, collé à la voiture de manière beaucoup plus étanche que le verre placé sur le haut des murs pour les rendre infranchissables. Ma Regata turbodiesel était magnifique, la meilleure personnalisation que j’aie jamais vue, ai-je dit à Lapo Elkan un soir dans un bar de Florence.
C’est lui qui vous a fourni la Maserati ?
Non, elle m’a été aimablement fournie par Jean Todt, qui, alors qu’il demandait une Ferrari, ne serait-ce que sa carrosserie, peinte en rouge, avec des roues, a détourné sa demande vers une Maserati 4 portes neuve et voyageuse. J’ai ensuite changé le design de la Biennale de Moscou en remplaçant le verre rouge de Murano par un verre américain épais et super clair.




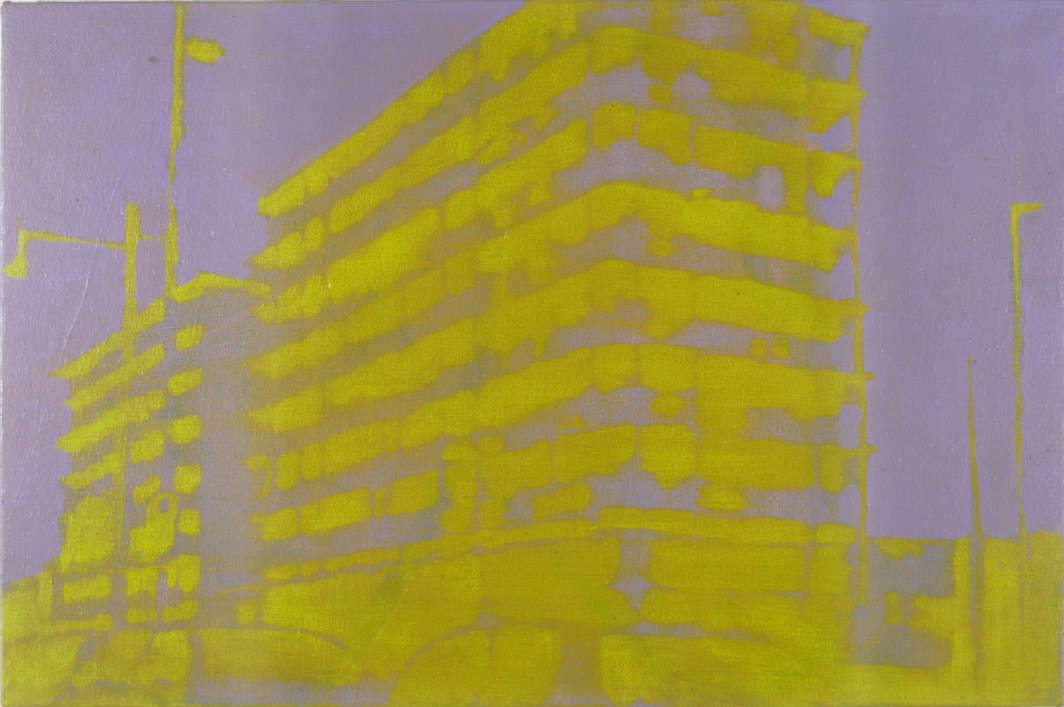






Ici, je voulais vous interroger sur l’importance dans votre travail de l’idée de jouer avec les échelles de reproduction, en passant du 1/1 au micro-paysage par exemple.
Juste pour passer d’une chose à l’autre... Je pense que vous mentionnez 1:1, mon exposition à la Biennale de Moscou en 2007, et dans la même question vous mentionnez le cycle de sculptures dédiées à l’horizon, qui dans certains cas ont pris la forme d’une colonne architecturale avec un paysage inséré au niveau des yeux... Que puis-je dire à ce sujet ? Le jeu est une belle chose à mettre en œuvre, c’est le moteur du faire et du défaire. En juxtaposant différentes échelles qui coexistent au sein d’une même œuvre, je provoque un vertige en rendant l’œuvre impossible à voir, en la camouflant avec l’échelle architecturale réelle et en imposant en même temps une observation si proche que le contexte disparaît. L’observateur doit se placer activement par rapport à l’œuvre et par rapport à l’espace. L’espace semble vide, il y a des murs, un sol et des colonnes. L’une des colonnes semble étrangement coupée et l’on s’en approche pour mieux comprendre, la coupe est juste à la hauteur des yeux, mais comment une colonne a-t-elle pu être coupée ? Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette entaille ? Il faut s’approcher au point d’attacher ses yeux à cette découpe et finalement on regarde un paysage, un horizon qui évoque un paysage, donc on regarde à travers la colonne elle-même et on voit l’espace au-delà de la découpe, au-delà de la colonne. L’utilisation de l’espace est celle d’un déplacement dans un lieu architectural vide, alors qu’en même temps l’image d’un paysage à l’horizon s’est formée dans notre esprit. L’œuvre Landscape observes us est faite de ce déséquilibre et de ce vertige. En y regardant de plus près, on s’aperçoit que le paysage est constitué de petits fragments, d’objets posés sur un plan, sur le plan d’observation. Un clou, un boulon, une boîte d’épingles, un taille-crayon, un clavier de calculatrice deviennent des bâtiments, des châteaux d’eau, des cheminées, des usines, construisant un paysage qui appartient à une vision commune évoquée avec quelques objets trouvés. Rien n’est construit, les objets sont collés dans la fente et le paysage tridimensionnel est visible de tous les côtés de la colonne en marchant autour. Quel est ce paysage ? De quoi est-il fait ? L’observateur modifie-t-il le paysage lui-même ? Deux personnes différentes regardant le même paysage voient-elles les mêmes choses ? Regarder loin dans l’horizon a toujours été un bon exercice pour les yeux et l’esprit.
Très souvent, le paysage urbain est le protagoniste de vos œuvres. Qu’est-ce qui vous attire dans ces non-lieux ?
Paysage urbain ne signifie pas non-lieu. Depuis que Marc Augé a analysé la présence dans le paysage d’espaces aux relations réduites, appelés non-lieux, dans son essai Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992), nous avons pris conscience que l’anthropisation diffuse est le propre de notre planète. Le paysage urbain est un paysage que je fréquente quotidiennement, j’ai appris à lire les transformations et les nuances de la ville que je traverse, en allant d’un centre à l’autre le long de canaux infrastructurels privilégiés qui relient tous les centres sans discontinuité. Je pense que les non-lieux que vous identifiez dans mon travail sont les peintures qui représentent les couloirs et les espaces de communication entre les lieux. J’ai commencé à peindre les couloirs parce qu’ils n’avaient pas leur propre artiste pour les représenter et les mettre en valeur. J’ai été le premier peintre à essayer de représenter des espaces avec une raréfaction relationnelle, c’est-à-dire tous ces lieux anti-picturaux que nous utilisons tous les jours sans leur donner une représentation. Beaucoup de ces peintures n’étaient en fait pas des non-lieux, mais simplement des lieux de passage, d’échange, d’interchange. Ces peintures portent le titre général d’“Intérieur”, elles sont donc pour moi un hommage à la peinture à l’huile sur bois, une œuvre dans la peinture, une peinture qui représente des intérieurs architecturaux. Au fil du temps, ce choix iconographique a glissé vers ces espaces décrits ci-dessus, qui provenaient initialement d’images volées, de catalogues de panneaux et de modules pour bureaux, d’éléments de construction préfabriqués et stratifiés, de verre et de cloisons intérieures d’un certain modernisme international. Les peintures dites “Interni” ont pu, pendant une brève période, être identifiées au terme inventé par Augé, mais avant et après cette transition, elles ont été et sont devenues tout autre chose, voire pour certains cycles des natures mortes peintes en direct dans l’atelier. Cette poétique de certains espaces raréfiés se poursuit dans la représentation picturale des routes et autoroutes représentées par une vue centrale et symétrique, puis par la série des tunnels et des ponts. Le paysage urbain, quant à lui, est tout sauf un non-lieu, tout au plus en ce qui concerne les banlieues, on pourrait parler de lieux tendant vers l’anonymat, vers une certaine uniformité, mais ce sont tout sauf des non-lieux, je dirais que ce sont des lieux par excellence, des espaces de tragédie humaine qui peuvent évoquer tout ce dont nous avons besoin lorsque nous nous projetons dans la vision d’un paysage. Cela pourrait être le sens, il y a quelque chose de sacré dans tout ce que nous observons, cela dépend de l’œil et de la volonté avec lesquels on observe.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.


























