Loredana Longo (Catania, 1967) est une artiste et sculptrice italienne qui a construit sa recherche autour de l’esthétique de la destruction, un thème qui marque son travail depuis plus de vingt ans. Sa pratique, qui va de la sculpture à l’installation, à la performance et à la conception d’espaces spécifiques, explore la relation entre la matière, le corps et la transformation. Ses œuvres se caractérisent souvent par l’utilisation de matériaux non conventionnels tels que le béton, le plastique, le plâtre et la terre, et par l’implication directe du spectateur, qui devient un élément actif du processus artistique. Longo réalise la plupart de ses œuvres dans les espaces où elle travaille, en s’inspirant de son environnement. Dans sa maison-atelier de Milan, par exemple, il vit en contact étroit avec certaines de ses œuvres les plus connues. L’expression “esthétique de la destruction” est apparue comme un concept clé lors de son exposition personnelle à Catane en 2005, et reste au cœur de ses recherches, soulignant la fragilité et le potentiel de renaissance qui accompagnent tout processus de déconstruction.
Ses performances, souvent dérangeantes, offrent une réflexion sur la dichotomie entre la vigueur et la délicatesse, la force physique et la matière sensible. Longo est capable d’adapter son art aux contextes dans lesquels elle travaille, créant des interventions qui évoluent continuellement. L’œuvre de Loredana Longo se distingue par sa transformation continue, qui implique non seulement le matériau, mais aussi le public, dans un processus dynamique qui questionne et reflète la condition humaine et les contradictions de notre époque. Son art est une réflexion sur les tensions du présent, une invitation à regarder au-delà des apparences et à affronter la vulnérabilité et la force inhérentes au processus de changement. Loredana Longo parle de son art dans cette conversation avec Gabriele Landi.

GL. Souvent, pour les artistes, l’enfance est l’âge d’or où ils font leurs premières découvertes de fantasmes qui reviennent plus tard avec le temps et l’évolution de leur travail : est-ce que c’était comme ça pour vous aussi ?
LL. Je suis né à Catane, une ville située sur les pentes de l’Etna. À l’école primaire, on nous a demandé de dessiner le parc de l’Etna, le WWF avait impliqué toutes les écoles primaires de la ville dans ce grand projet. Je me souviens qu’en classe, il y avait un enfant qui dessinait merveilleusement bien, alors que je n’étais pas, ne suis pas et ne serai jamais capable de le faire. Je l’observais et j’admirais son habileté technique. J’ai fait un dessin très simple et naïf, une montagne avec son sommet enneigé, quelques animaux disproportionnés, mais ils avaient tous une tâche à accomplir : d’une manière ou d’une autre, ils avaient des sacs dans lesquels ils pouvaient ramasser leurs déchets. Lors de la cérémonie de remise des prix, j’ai remporté le premier prix, la valeur conceptuelle ayant dépassé toute technicité. Pour la première fois, je me suis rendu compte que j’avais un petit don, mais certains dons doivent être entretenus, s’ils sont étouffés ou mal compris, ils peuvent devenir des poisons. Peut-être que la récupération des matériaux m’a toujours appartenu, elle fait partie d’un héritage familial, d’une éducation et d’un respect de la nature, grâce à la patience de ma mère.
Quel a été votre premier amour artistique ?
Je cherche dans ma mémoire mon premier grand amour et je crois que c’était Kandinsky. Avec le recul, il n’y a pas d’artiste plus éloigné de ma vision poétique et formelle. À l’époque, j’étais fasciné par son histoire, son utilisation des couleurs et des formes, et je pense que c’est pour cela que je suis allé dans l’atelier d’un peintre à Catane, où je vivais à l’époque. Il avait une approche graphique, utilisant de préférence des acryliques et des aquarelles. Au début, j’ai essayé de suivre un peu ses traces. Je peignais presque transporté par l’amour de la couleur et des formes, mais le poids des choses me manquait. Je suis toujours restée à la surface, tout était graphiquement beau, cela fonctionnait comme du papier d’emballage recouvrant une boîte vide. Pendant longtemps, je suis restée dans ce vide, plus proche d’une sorte de décoration élégante que de l’art. J’étais agité, j’ai pensé pendant des années que j’étais presque stupide, trop superficiel, je cherchais la profondeur mais je n’y arrivais pas parce que je n’avais pas les bases pour la trouver. Je ne pense pas avoir eu de maîtres, je suis convaincu qu’il vaut toujours mieux ne pas avoir de maîtres que d’en avoir de mauvais. Je me suis construit par petits bouts, par petites briques qui se sont parfois effondrées et s’effondrent encore, mais une personne qui a fait de la destruction son mantra ne peut pas espérer mieux.
Quelles études avez-vous faites ? Y a-t-il eu des rencontres importantes au cours de votre formation ?
Ma vie a été une succession de mauvais choix dus à des accidents assez graves. Je n’ai pas pu choisir mes études de formation, j’ai donc souffert de déformation pendant de nombreuses années. Un grave accident de voiture m’a obligé à marcher avec des béquilles pendant plusieurs mois, j’ai deux frères et une sœur et pour mes parents conduire tout le monde à l’école devenait difficile. Le choix s’est porté sur une école de langues, près de chez moi. Partons du principe que chacun a certainement des talents par rapport aux autres, je n’ai pas de facilité à apprendre les langues. Cependant, j’ai d’autres talents, et avec d’autres camarades de classe, nous avons créé une compagnie de théâtre, j’écrivais, je faisais les décors, les costumes et j’étais aussi actrice. Je pense que c’était l’une des périodes les plus heureuses de ma vie. Tout était déjà en moi, mais je n’en étais pas consciente. Cela est venu plus tard. Après d’autres mauvais choix, dont je ne ferai pas la chronique, j’ai finalement atterri à l’Académie des beaux-arts de Catane, en peinture. Je n’ai pas vraiment fait de peinture, je n’ai jamais aimé l’huile, trop lente, pâteuse, collante et qui ne s’arrête jamais. Mon père avait une petite usine de meubles modulaires où je construisais mes cadres, de grands cadres, j’investissais beaucoup de temps dans la préparation : j’étalais la toile de jute, je la tirais avec un châssis et j’appliquais une base. Je peignais dessus avec de la terre et de la colle vinylique. Parfois je peignais sur des planches de bois, après une préparation sérieuse du support je construisais mes figures, comme des formes ancestrales, rigides, presque matérielles, des couleurs naturelles, ocre, terre brûlée, noir. Pour que les choses soient claires, je peux vous dire que j’ai terminé mes études à l’Académie avec un phénoménal 110 cum laude pour les mérites en peinture. Dès le lendemain, je n’ai plus jamais peint. N’en voulez pas à tous mes amis peintres, mais je trouve d’un ennui inconsolable et je déteste m’ennuyer, cette répétition des gestes, la préparation de la toile, le mélange des couleurs, le léchage de ces nuances ou l’échantillonnage de grands ou de petits espaces, le nettoyage des pinceaux. Il y a un monde d’autres matériaux en dehors de l’atelier.









Qu’est-ce que l’esthétique de la destruction et comment surgit-elle ?
L’accident, le énième accident. Je perds un rein. L’hospitalisation, cette longue période d’hospitalisation, d’attente, de patience où mon esprit a imaginé comment sortir de ce lit à barreaux, les cathéters, les examens, les jours d’abstinence vertueuse de nourriture et d’alcool, ont caché et nourri une implosion. La frustration de l’inactivité a fait naître des pensées de grande opération. Je regardais beaucoup la télévision et les nouvelles de voitures explosées, de meurtres de la mafia, se mêlaient aux nouvelles de la guerre dans le monde. Ma montagne, le volcan Etna, était en train d’exploser et d’entrer en éruption. J’étais le seul à devoir rester immobile. Mais j’avais juré que depuis ma guérison, je ne penserais qu’à moi. Comment renaît-on de la destruction ? La renaissance est déjà un choix esthétique, vous ne serez jamais le même qu’avant, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c’est que vous porterez cette blessure avec fierté et qu’elle sera le point à partir duquel vous vous relèverez, avec force. Mon animal préféré, même s’il n’existe que dans le monde mythologique, est le phénix. Cet été, invitée à un festival sur l’art et la science intitulé Volcanic Attitude, j’ai eu l’idée d’utiliser des cendres volcaniques. Dans la performance Black Phoenix, qui a eu lieu en juin aux Hot Waters sur l’île de Vulcano, quatre filles sortent de l’eau, s’allongent sur le sol en suivant un dessin en croix, puis je les asperge de cendres et place des feuilles de palmier sur leurs côtés, qui ont également la signification de la renaissance. Les artistes se lèvent et la forme de leur corps laisse un dessin de phénix sur le sol. Ils renaissent de leurs cendres. De manière inattendue, cet été, la ville de Catane a été ensevelie quatre fois par des cendres volcaniques, suite à l’activité éruptive de l’Etna, du sable sur nous. C’est une histoire qui se répète au fil des siècles, sur l’une des portes d’entrée de la ville figure l’inscription “Melior de cinere surgo”, Catane a été détruite environ neuf fois par la lave et les tremblements de terre, mais elle s’est toujours et obstinément relevée de ses cendres. Je suis un enfant de mes lieux. Je me suis toujours demandé pourquoi reconstruire dans un endroit où l’on est certain qu’un jour, tôt ou tard, les forces de la nature nous submergeront à nouveau, et j’ai compris que la réponse se trouvait dans la beauté. Cet endroit magique situé entre un cratère et la mer, la roche noire et les agrumes ne sont pas des catégories évidentes, ce sont des cadeaux de la nature, qui prend et qui donne.
Dans vos œuvres, on trouve souvent des éléments tirés de la vie quotidienne : des reconstitutions d’intérieurs, des tapis, des vases, des bouteilles en verre que vous détruisez puis reconstruisez.
Les objets les plus simples et les plus communs sont à la portée de tous et sont souvent les plus utiles, tout le monde sait s’en servir et ils ne sont pas chargés de sens, mais on peut les remplir de souvenirs, de moments où on les associe à quelque chose. Ils nous paraissent parfois insignifiants, mais c’est parce que nous les avons à notre disposition tous les jours. Tout peut devenir quelque chose d’autre et quelque chose d’autre en nous. Je trouve intéressant d’utiliser des objets présents dans notre vie quotidienne, d’interrompre leur fonctionnement et de les faire devenir autre chose. Je pense à ma série Carpet, des tapis orientaux qui revivent une seconde vie au moment où je brûle quelques phrases simples, quelques mots prononcés par un politicien occidental. Cela crée ce choc/rencontre entre deux cultures différentes, mais surtout ils utilisent le même objet d’une manière différente. Ma gravure au feu attaque violemment la surface du tapis et l’éloigne de la convivialité religieuse, elle le transforme en tabloïd avec des slogans politiques.
Quelle valeur la matière et son devenir ont-ils pour vous ?
La matière, c’est ce dont les choses sont faites, c’est fondamental, parce qu’elle a une structure qui peut vous attirer ou vous repousser. Je n’aime pas le papier et les crayons, les feutres, je n’aime pas leur sensation, ni le bruit que je fais en les utilisant. Je ne dessine jamais, si ce n’est avec un stylo-bille. Parfois, on me demande de soumettre des projets, des croquis. Je fais le travail directement et j’envoie la photo. Tout matériau peut devenir le sujet et l’objet de ma démarche artistique, une sorte de brocanteur du présent. Je prends les choses et je les transforme, mais pas de manière duchampienne, je n’élève rien au rang d’œuvre d’art. J’effectue un processus presque maniaque, je le détruis, je le reconstruis et ensuite, s’il y a lieu, je l’élève au rang d’œuvre d’art.





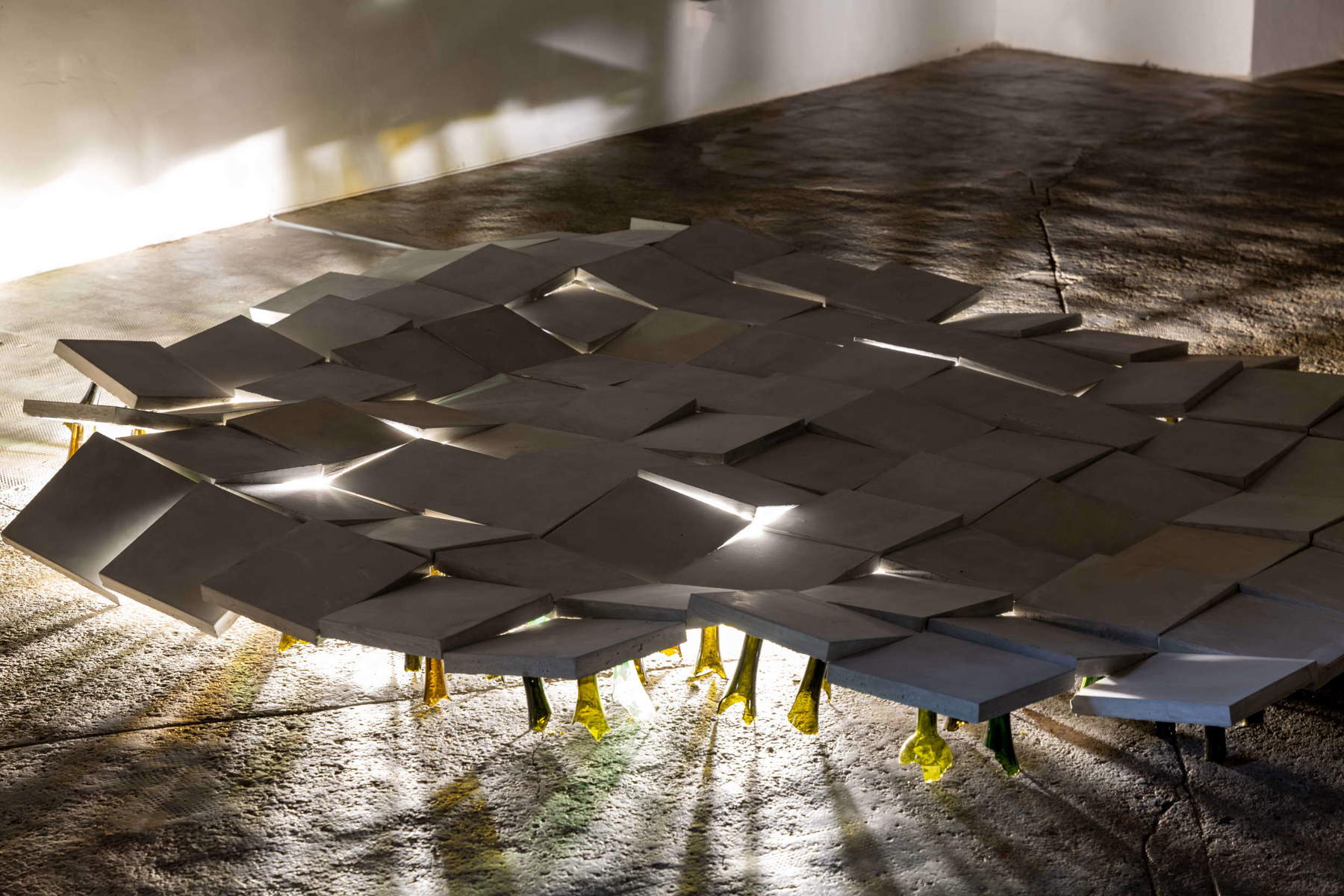

Êtes-vous intéressé par l’idée de mettre en scène des œuvres ?
C’est une composante presque essentielle, surtout pour ceux qui font des sculptures, des installations et des performances. Le risque est de devenir théâtral, de charger les œuvres de trop de drame, mais j’aime le côté sombre des choses. Dans ma série Explosion, je construis de véritables décors de théâtre, je ne laisse rien au hasard, ce sont des reconstitutions d’environnements bourgeois des années 1970, qui rappellent les anciennes maisons bourgeoises traditionnelles dont les murs étaient recouverts de papier peint damassé. Je décris des moments familiaux de pure convivialité : déjeuners de famille, repas de Noël, tea time ou plutôt chambres vides. Ces chambres sont toujours vides, comme si elles attendaient l’arrivée de quelqu’un, il n’y a jamais de présence humaine. Soudain, il se passe quelque chose, une explosion et des objets explosent, quelque chose brûle, il y a de la fumée partout. Je ramasse les débris et les range, j’essaie de les remettre en place, de recoller les morceaux, de ranger. Toute la scène sent le brûlé, la dénonciation de ce qui s’est passé, mais pour l’œil superficiel, il semble qu’il ne se soit rien passé. Il n’y a pas de repentir, je ne remets pas les choses en place parce que ce qui s’est passé provoque en moi un besoin d’ordre, mais cela déclenche plutôt quelque chose de mécanique qui s’apparente à la répétition maniaque d’un tueur en série. Il n’y a pas de possibilité de guérir complètement certaines blessures, alors j’essaie de les atténuer parce que je ne veux pas qu’elles disparaissent. Pourquoi effacer la marque ?
Lorsque vous travaillez sur une exposition dans laquelle vous présentez plusieurs œuvres, comment avez-vous tendance à y réfléchir ?
Lorsque je travaille sur une exposition, je développe toujours un projet, il n’est pas important que les œuvres soient formellement reconnaissables aux précédentes ou entre elles, mais plutôt qu’elles suivent la pensée de ce projet. J’utilise toutes les techniques et tous les matériaux, et même simultanément, ce qui crée parfois une certaine confusion chez le spectateur qui n’est pas familier avec mon travail, mais il y a toujours une pensée qui les lie. La composante performance est toujours présente, soit sous la forme d’une vidéo documentant quelque chose, soit en présence, mais elles sont toujours liées. Dans ma dernière œuvre de la série Victory, j’ai fait une intervention sur un terrain de rugby, un énorme panneau “VICTOIRE” de près de 50 mètres de long, fait de la même herbe que j’ai fait pousser pendant environ un mois. L’équipe de jeunes de l’équipe de rugby de Benetton a joué un match amical, je voulais que cette “VICTOIRE” soit piétinée, qu’il n’y ait pas de vainqueur, et finalement, à la moitié de la vidéo, tout devient sombre, la couleur cède la place au noir et blanc, et leurs mouvements ressemblent plus à une marche de guerre qu’à un match. La vidéo est projetée sur un mur de l’espace de la Villa Rospigliosi et, dans la pièce voisine, un grand panneau “VICTOIRE” est posé sur le sol en herbe. Pendant le vernissage, j’ai porté des semelles en fer avec des crampons en fer de 12 centimètres de haut, une variante de la chaussure de rugby originale, et j’ai marché sur l’écriture. La performance s’intitulait : How to make my Victory (Comment faire ma victoire). Mon idée de la victoire coïncide avec une demi-défaite.
Quelle idée avez-vous du corps et quel rôle joue-t-il dans ce que vous faites ?
On peut parler de choses que l’on ne connaît pas simplement parce qu’on peut les imaginer. Les artistes parlent d’eux-mêmes et imaginent quelque chose qui n’existe pas, mais ils partent toujours d’eux-mêmes. Mon corps est le siège de mes mouvements, de mes événements et de mes pensées. Mon corps est fondamental dans mon travail, il est la mesure de tout, ce qui ne veut pas dire qu’il doit être présent, mais qu’il détermine la structure de l’œuvre, la dimension. Immédiatement après mes études académiques, j’ai commencé un chemin qui est toujours en cours, je n’ai jamais cessé de faire des performances, et je crois que c’est en relation avec la vérité d’être là, comme si je témoignais que j’existe vraiment et que je ne peux m’éprouver que tant que mon corps est capable de le faire. Il n’y a jamais de préparation, je ne répète jamais la performance à l’avance, disons que c’est impossible, c’est juste une épreuve de force avec moi-même, une démonstration que tant que mon corps est là, je suis vivant et je peux me passer du travail, en fait je m’en rends souvent compte pendant que je suis en train de jouer. Dans Capitonné Skin Wall, entièrement peint en noir, je me jette contre un mur recouvert de papier, laissant des empreintes de pas. Les feuilles de papier deviennent les motifs utilisés pour tailler de longues entailles sur de grandes peaux de la couleur de mon teint. Chacune de mes marques sur le mur devient un panneau capitonné dans lequel un corps semble vouloir s’échapper. Capitonné est une technique de suture d’organes et je n’ai pas trouvé de titre plus approprié. Pourquoi est-ce que je mets mon corps à l’épreuve de cette manière ? Je ne sais pas, mais je pense que cela a à voir avec ce rapport à la réalité et à la fiction. L’œuvre est-elle toujours et uniquement une fiction ? Je veux qu’il y ait une relation avec la réalité et qu’elle soit réelle. Pendant les représentations, je me blesse pour deux raisons. La première est que j’exécute souvent des actions violentes ou fortes, mais la seconde est plus importante : je veux que ce soit réel, et non que cela ait l’air réel. Si je me jette contre un mur, je me fais mal, si je tombe, je me fais mal quelque part dans mon corps. Je ne peux pas prétendre que cela me fait mal, car je n’aurais pas l’impression que c’est réel. Pourquoi faire ce genre d’actions et les faire en prétendant faire quelque chose ? Les explosions ? Je ne sais jamais ce qui va se passer en détail, mais je sais qu’il va exploser et je sais comment il va le faire, et il est certain que quelque chose va se briser. Si le matériau est soumis à de rudes épreuves, quelque chose se produit.
Y a-t-il des lieux de prédilection pour vos performances ?
Les endroits où je suis invité sont des lieux de représentation. Un ami très proche, un très bon critique, m’a dit il y a quelque temps : la performance n’est pas du théâtre, ce n’est pas jouer. Je m’adapte à l’endroit où je me trouve, sans musique. La performance doit fonctionner dans son exécution, en se privant des effets associés au cinéma ou au théâtre. La musique a souvent tendance à devenir une sorte de bande sonore dans certaines performances, provoquant un effet d’édulcoration qui nuit à l’action elle-même. Dans les Exécutions créatives, une série d’actions dans lesquelles je fais exploser des pots d’argile fraîche, le seul son, la seule action est l’explosion figée au moment de l’éclatement, puis la fumée et ce qui reste, de simples cylindres d’argile à cuire. Les sculptures en terre cuite témoignent fidèlement de ce qui s’est passé, dans la surface lisse des pots s’ouvrent des brèches, le matériau est effiloché, poussé à l’extrême de sa résistance, il semble que l’action de l’explosion se soit fixée dans ces formes.
L’idée de précarité vous intéresse-t-elle ?
La précarité est mon mantra, si le sol ne s’effondre pas sous mes pieds, je déménage dans un lieu sismique. L’endroit où vous êtes né et où vous avez passé une partie de votre vie marque la façon dont vous percevez les choses. Je suis né à Catane, j’ai vécu la plus grande partie de ma vie au pied d’un volcan actif, l’Etna, et en été, depuis l’âge d’un an, je passe quelques mois à Vulcano, dans les îles Éoliennes, où j’ai une petite maison. Entouré de soufre, de chutes de sable pérennes liées aux explosions du volcan, j’ai l’impression que le monde d’en bas est en perpétuel changement, comme si rien n’était jamais défini dans sa forme. Comprenez-vous comment la conformation géologique peut nourrir mes processus créatifs ? Dans la récente exposition Crossing the line, à la Villa Rospigliosi de Prato, j’ai réalisé un sol en carreaux de ciment reposant sur des goulots de bouteilles cassées de différentes hauteurs, de sorte que chaque pièce a sa propre inclinaison et sa propre hauteur ; lorsqu’on les assemble, la surface est irrégulière, on a l’impression que quelque chose s’est produit en dessous, comme un mouvement sismique ou l’explosion de quelque chose. J’ai également placé des projecteurs sous le sol, j’aimais penser que la surface de cette œuvre semblait suspendue, comme si une vie se cachait, jaillissant de cette destruction. Je ne pense pas qu’aucune de mes œuvres soit en très bonne santé statique, elles ont toutes été soumises, comme moi, à de rudes épreuves de survie. Elles sont pourtant fortes, elles expriment cette vulnérabilité mais aussi la fierté d’être debout.
Votre travail semble souvent reposer sur la logique du contraste : attraction, répulsion - sensuelle, tranchante, fragile... Est-ce une dimension dans laquelle vous vous reconnaissez ?
J’ai intitulé mon dernier catalogue/monographie Strong and Fragile. Dans cette édition, je n’ai publié que mes dernières œuvres, en les subdivisant par matériau. Je crois que l’utilisation d’un matériau plutôt qu’un autre dépend, personnellement, de sa capacité à représenter quelque chose et à être quelque chose d’autre. Le verre est fragile, mais si vous cassez une bouteille, le goulot peut se transformer en arme, impropre, dangereuse, transparente, tranchante. J’ai empilé des milliers de goulots de bouteilles dans mes œuvres. Au Brussels Central, j’ai exposé une œuvre, Glass Gate, dans laquelle des milliers de goulots de bouteilles créent un mur de verre infranchissable, interrompu seulement par un panneau de signalisation qui le traverse. Les lumières font rayonner les formes sur les murs environnants, créant un motif semblable à une forêt/prison complexe. C’est la preuve que la beauté peut être dans tout, même dans un goulot d’étranglement banal. La poterie est très fragile et je la pousse à l’extrême de sa résistance plastique lors des explosions, mais il est également vrai que les artefacts historiques les plus anciens des civilisations qui nous ont précédés sont faits de poterie, ils sont là depuis des siècles et sont irréductibles, ils résisteront à tout.
Vous utilisez souvent la vidéo dans votre travail, soit pour documenter vos performances, soit comme un médium autonome. Vous intéressez-vous à la dimension narrative de votre travail ?
La narration n’est pas fondamentale dans mon travail. J’utilise la vidéo pour documenter une action. Ce qui m’intéresse, c’est d’arrêter le processus de transformation du sujet de ma performance. Par exemple, dans “Explosion”, je construis des scènes de vie familiale, j’explose des objets et je les reconstruis par la suite. Il ne s’agit pas vraiment d’une narration, mais d’un flux vital. Dans une galerie ou un musée, l’œuvre est exposée de telle sorte qu’à côté de la reconstruction du décor, il y a la projection de la vidéo montrant la scène avant et après l’explosion, dans une répétition obsessionnelle de la construction et de la destruction. En gros, la genèse de l’être humain.
Quelle importance revêt pour vous la dimension spatio-temporelle ?
Je ne saurais pas répondre à cette question, je veux dire qu’elle n’est pas si importante que ça, donc je passe mon tour.










Vous intéressez-vous à la dimension fétichiste des objets que vous utilisez ?
Le fétichisme, dans son sens le plus obscur, est lié à la composante sexuelle, qui est inexistante dans mon travail, donc je dirais non. Si l’on veut ensuite voir l’aspect religieux du fétichisme, je réponds encore non, je ne suis pas religieux. Je ne charge pas l’objet d’une importance personnelle particulière mais de valeurs plus universelles qui appartiennent à tout le monde. J’ai souvent utilisé le moulage de mes mains, mais je crois qu’il représente la partie la plus mobile et la plus gestuelle de notre corps, je le vois comme quelque chose qui fait partie du monde de la fabrication et je l’interprète donc d’une manière irrévérencieuse et souvent provocante comme dans Nice to meet you, une élégante sculpture de cheminée.
D’où est venue l’idée de Victory, une œuvre que vous réalisez depuis plusieurs années avec différentes déclinaisons et comment s’est-elle développée au fil du temps ?
Victory est née en 2015, j’ai vu une scène à la télévision : un djihadiste se tenait sur une colonne brisée dans le temple de Palmyre et levait une main en signe de victoire. Ce mot est devenu iconique pour moi, je l’ai décliné sous forme sculpturale avec différents matériaux et je l’ai même imprimé sur des velours représentant des scènes de victoire douteuse réalisées en brûlant les panneaux avec une soudeuse électrique. Depuis les premières sculptures en marbre où j’ai brisé les lettres à coups de marteau puis les ai réarrangées, jusqu’à la grande inscription en béton dans un parc privé, en passant par la sculpture murale où le mot victoire est écrit à l’envers avec des goulots de bouteille.
Depuis quelque temps, vous utilisez souvent des goulots de bouteille cassés : d’où viennent ces objets dans votre travail ?
Une bouteille n’est qu’un récipient en verre, mais si vous essayez de la casser, il ne vous restera jamais que le goulot, ce qui vous ramène immédiatement à la guérilla urbaine, à l’arme de défense et d’attaque. Puis on regarde les cols brisés et on voit la beauté donnée par la transparence et la coloration du verre, les différentes facettes, les pointes acérées. Même cet objet très pauvre, lorsqu’il est empilé en longues colonnes, devient menaçant et attrayant. J’utilise des goulots de bouteille depuis plusieurs années, plus récemment j’ai réalisé un long escalier de six mètres de long, Stairway to heaven, une ascension infranchissable.
Vous avez souvent utilisé la céramique : qu’est-ce qui vous attire dans ce matériau ?
Je pense que c’est sa plasticité lorsqu’elle est encore brute. Je n’ai jamais modelé l’argile, j’utilise souvent ce matériau en moulage, comme dans FIST, où plusieurs exemplaires de mon poing explosent, là encore chaque main s’ouvre ou se détruit de manière différente, pour devenir une arme à son tour. J’ai placé mes poings explosés sur de longs bâtons utilisés pour l’agriculture et j’ai brûlé leur surface pour les rendre plus résistants. Dans Gold Heel, les empreintes de mes coups de poing et de pied sont fixées sur la surface froide et douce d’un sac de frappe, avec lequel je me bats au cours d’une performance dans laquelle je porte des talons hauts dorés. La performance s’achève au moment où j’enlève l’une de mes chaussures et la glisse dans le sac.
Pensez-vous que l’art a encore un caractère sacré ?
C’est la relation que l’artiste entretient avec ses créations qui a son propre caractère sacré, l’euphorie de la pensée dès que la vision se produit, l’obstination de l’artiste à lui donner forme, la tension entre la pensée et ce que l’œuvre devient, ce qu’elle devient et ce qu’elle pourrait encore devenir, la naissance d’autres œuvres qui lui succèdent. C’est du sacré. Lorsqu’elle sort de l’atelier, elle prend d’autres aspects, comme si elle s’éloignait du regard des autres, elle perd ce contact privé qu’il y a entre le créateur et l’enfant, elle devient autre chose et suit son propre chemin. Je regarde mes œuvres avec détachement, je ne peux pas les aimer comme au moment de la naissance, je dois les laisser indépendantes pour entrer en contact avec quelque chose d’autre qui sera.
Quand il n’y a personne pour l’observer, l’œuvre d’art existe-t-elle selon vous ?
Pour moi, elle existe toujours, elle est en moi.
Où vous situez-vous par rapport à votre travail ?
Je ne pense pas pouvoir me situer au-dessus ou en dessous, loin ou près, peut-être à l’intérieur.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.