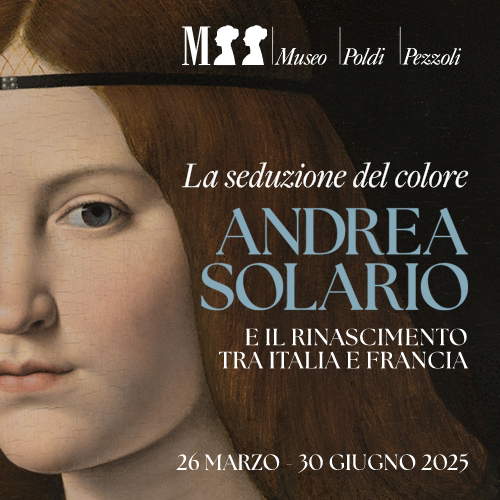Le Qatar et au-delà. Comment obtenir un pavillon à la Biennale de Venise ?
Le Qatar aura son propre pavillon permanent dans les Giardini de la Biennale de Venise : il sera très central, à cheval sur le pavillon de la Finlande, le pavillon du Danemark et le pavillon du livre de Stirling. Il l’a annoncé le 12 février, dans une déclaration qui a suscité une certaine perplexité dans les rangs de l’opposition vénitienne, puisqu’il n’y a pas encore eu de permis de construire ni de concession de terrain de l’État. Le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, a quant à lui commenté la nouvelle en ces termes : “Dans l’esprit de curiosité, d’exploration et d’échanges sincères entre les peuples qui caractérise Venise et sa Biennale, je voudrais souhaiter la bienvenue au Qatar dans nos Giardini, en tant que puissante source mondiale de créativité et de compréhension entre les différentes cultures”. Mais, la rhétorique de célébration mise à part, comment se fait-il que le Qatar, qui n’a jusqu’à présent jamais participé à une biennale vénitienne, ait été autorisé (ou plutôt sera autorisé, c’est maintenant une formalité) à construire un pavillon permanent dans les Giardini, alors que tant d’autres pays n’y ont pas accès ?
Un bref résumé du contexte pour ceux qui connaissent peu les Giardini de la Biennale, à Castello, le lieu où la foire est née en 1895. Un nouveau pavillon permanent à cet endroit est un fait très, très exceptionnel. Au cours des 50 dernières années, seuls l’Australie (1987) et la Corée du Sud (1995) ont été autorisés à construire dans les Giardini. Pour une raison d’espace, aujourd’hui définitivement limité, mais aussi d’environnement historicisé : les pavillons nationaux, qui se sont développés l’un après l’autre surtout dans la première moitié du XXe siècle, à la stabilisation de ce qui était initialement une foire d’art internationale normale, représentent les États qui, dans un laps de temps remontant au début des années 1960 et à la période d’indépendance des anciennes colonies, ont eu suffisamment de poids pour obtenir une concession d’État à long terme de la part de la municipalité de Venise elle-même, parfois propriétaire du terrain, parfois aussi propriétaire du pavillon lui-même. France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Russie, Etats-Unis, puis Brésil, Yougoslavie, Pologne... Le seul État africain représenté aux Giardini est l’Égypte, accueillie depuis 1952 dans un bâtiment construit en 1932. Pour pouvoir exposer aux Giardini avec un pavillon permanent, il faut disposer d’une concession d’État spécifique : en règle générale, elles sont de très longue durée (pour le nouveau pavillon du Qatar, on parle de 90 ans) et pour des coûts symboliques, à tel point qu’en 2023, le maire Luigi Brugnaro avait manifesté la nécessité de les revoir à la hausse, notamment parce que beaucoup d’entre elles étaient et sont arrivées à échéance.



Pour faire de la place à tous les États qui n’ont pas leur place dans les Giardini, la Biennale convertit depuis 1980 la zone de l’Arsenale, où des dizaines d’autres nations exposent. Dans ce cas, pour y avoir un pavillon, il faut passer un accord avec la Biennale (qui gère la zone au nom de la municipalité), à un prix à convenir. Sinon, vous pouvez exposer où vous voulez dans la ville : des palais, d’anciens entrepôts, des églises déconsacrées peuvent exiger des loyers importants pour faire de la place à des pavillons nationaux temporaires. En résumé, si la participation des Etats-nations à la Biennale de Venise (si ces Etats sont reconnus par le gouvernement italien) est totalement gratuite, le problème est le coût d’obtention d’un espace d’exposition, d’autant plus si l’on veut qu’il ne soit pas marginal.
Disposer d’un pavillon permanent fait donc une énorme différence, économiquement mais aussi symboliquement. C’est pourquoi, à grand renfort de bruit, la Bolivie a pu participer en 2024 parce qu’elle a été accueillie gratuitement dans le pavillon (permanent) de la Russie aux Giardini, qui est très central et très spacieux : tout est légal, l’État qui détient la concession (la Russie) peut en faire ce qu’il veut, y compris ne pas participer et en accueillir d’autres. Ainsi, qu’on le veuille ou non, les jardins de la Biennale sont devenus, ou ont toujours été, un espace de géographie politique, au moins artistique : les forces émergentes, comme l’Arabie Saoudite (présente à l’Arsenale), le Nigeria, la Côte d’Ivoire (ces deux derniers avec des pavillons temporaires dans des espaces de la ville), n’y sont pas. Les puissances du vingtième siècle sont toutes présentes, même celles qui ont entre-temps été... quelque peu dépourvues de pouvoir.
Le Qatar, dans ce nouveau pavillon (hauteur maximale de 8 mètres, selon les projets de concession) pourra donc non seulement exposer la nouvelle scène artistique qatarie, mais aussi exercer un soft-power sur tous les pays et artistes arabes et non-arabes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un pavillon à la Biennale, et qui pourront être accueillis. Mais en bref, pour revenir à la question initiale, comment est-il parvenu à obtenir une concession de construction qui n’avait pas été accordée depuis 30 ans, dans un espace où littéralement cinq ont été accordées depuis les années 1970 ? Il n’y a pas de réponse officielle, mais nous savons qu’il a choisi de resserrer les liens avec toutes les institutions vénitiennes.
En signant un protocole, en apportant de nouveaux investissements à l’aéroport, et un vol Doha-Venise, mais surtout en donnant 50 millions d’euros à la mairie de Venise en 2024 : il n’y a pas de lien officiel et déclaré entre la “donation” et le pavillon (dans l’acte, il est cependant précisé que pour les 50 millions, le Qatar devra être défini comme “bienfaiteur” pendant 30 ans et que la ministre Sheikha Al Thani recevra la citoyenneté d’honneur de Venise), mais il semble avoir été décisif, puisque le pavillon est proposé au moment même de la donation.
La géographie de l’art contemporain change et changera également la géographie physique de la Biennale de Venise. Comment et à quelle vitesse, c’est difficile à dire, puisque les règles, comme nous l’avons vu, sont presque toutes basées sur des conventions et des accords passés au cas par cas.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.