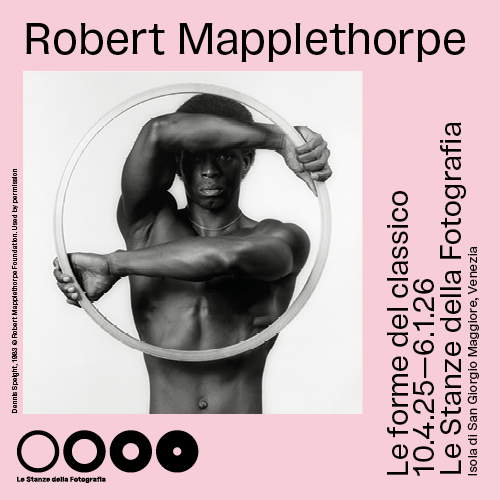Le pape François est mort : voici ce qu'il a fait pour l'art pendant son pontificat.
Ce matin, 21 avril 2025, à 7h35, le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, est décédé : le premier pape du continent américain de l’histoire a laissé derrière lui un riche héritage non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les domaines culturel et artistique. Son pontificat a marqué un point important dans la relation entre l’Église et l’art: En effet, surtout après la nomination en 2022 du cardinal portugais José Tolentino de Mendonça comme préfet du dicastère pour la culture et l’éducation, un homme de lettres et un intellectuel qui a repositionné l’Église notamment dans la sphère de l’art contemporain, le Vatican a en effet redécouvert et renforcé l’art dans une dimension de dialogue, d’inclusion et de restitution qui s’était estompée au fil du temps. Loin de tout esthétisme, François a conçu l’art comme un instrument de rencontre, de témoignage et d’ouverture, comme un langage universel capable d’incarner les valeurs évangéliques sans jamais perdre son lien avec le présent.
Un moment emblématique de cette vision a été l’arrivée inattendue et historique du pape François à la Biennale d’art de Venise en 2024. Aucun pontife avant lui n’avait mis les pieds à la plus importante manifestation internationale d’art contemporain. Le pavillon du Saint-Siège, situé à l’intérieur de la prison pour femmes de la Giudecca, était au cœur de la visite du pontife. Le pavillon, intitulé Con i miei occhi (Avec mes yeux), présentait des œuvres de huit artistes internationaux (dont Maurizio Cattelan, Sonia Gomes, Simone Fattal et Claire Tabouret) et abordait le thème des droits de l’homme et de la dignité du dernier, pierre angulaire de la pensée de François. Lors de la rencontre avec les femmes détenues, le Pape a rappelé que la prison peut devenir un lieu de renaissance et pas seulement un lieu de punition, appelant à ne jamais ôter la dignité des personnes. Il a ensuite déclaré que sa visite ne devait pas être considérée comme une “visite officielle”, mais comme une authentique rencontre humaine, faite d’écoute, d’affection et de prière mutuelle. Dans son discours aux artistes, François a souligné que l’art est une “ville de refuge”, un espace qui s’oppose à la violence et à la discrimination, et qui a le pouvoir de construire l’appartenance et l’accueil. Il a ajouté qu’il se sentait “chez lui” aux côtés des artistes, réaffirmant que l’art doit se concentrer sur les plus pauvres et aider à construire des réseaux de solidarité et de dialogue humain, pour devenir un témoignage puissant de la façon dont la beauté peut être un instrument de justice et d’humanité.

C’est cette même conviction qui l’a guidé dans sa décision, annoncée en 2023, de restituer à la Grèce trois fragments des marbres du Parthénon longtemps conservés dans les musées du Vatican. Par un geste hautement symbolique et à valeur diplomatique, François a voulu panser une blessure historique. La décision du pape a été formalisée sous la forme d’un “cadeau” à l’archevêque orthodoxe d’Athènes et de toute la Grèce, Ieronymos II, soulignant ainsi l’intention œcuménique du geste et la volonté de promouvoir l’unité entre les Églises chrétiennes. La cérémonie de remise a eu lieu au musée de l’Acropole à Athènes le 24 mars 2023, en présence des autorités religieuses et culturelles grecques.
Cet acte a également eu un impact significatif sur le débat international concernant la restitution des biens culturels, en augmentant la pression sur des institutions telles que le British Museum, qui détient une importante collection de marbres du Parthénon et fait l’objet de demandes de restitution de la part de la Grèce depuis des années. La restitution des fragments par le Vatican est un exemple concret de la manière dont les institutions peuvent traiter les questions de patrimoine culturel de manière responsable et sensible, en encourageant le dialogue et la coopération entre les peuples.
Dans ce cadre d’une relation renouvelée entre l’art et la responsabilité, son engagement en faveur des musées d’église s’inscrit également. Lors de sa rencontre en 2019 avec les représentants de l’Association des musées ecclésiastiques italiens (AMEI), il a souligné l’importance d’ouvrir les portes des musées de l’Église au public le plus large possible, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux familles, aux migrants et aux pauvres. François a invité les musées à ne pas être des lieux statiques ou autoréférentiels, mais de véritables espaces de dialogue entre la foi, l’histoire et le présent. Le pape François a exprimé une vision claire du rôle des musées au sein de l’Église et de la société : selon lui, les musées ne doivent pas être considérés comme des lieux statiques, autoréférentiels ou destinés à une élite cultivée. Au contraire, ils doivent être transformés en espaces vivants, accessibles, ouverts aux rencontres, capables de parler à tous, en particulier aux pauvres, aux oubliés, aux derniers de la société.



Dans son livre La mia idea di arte, écrit avec Tiziana Lupi, François affirme que l’art doit pouvoir atteindre tout le monde. Pour lui, l’art est un instrument d’évangélisation et de consolation, un vecteur d’espoir et un pont entre les peuples et les cultures. Les musées, en ce sens, doivent accompagner cet esprit : être des lieux d’accueil, d’écoute et de dialogue, où la beauté n’est pas exposée pour elle-même, mais devient un don pour tous. L’épisode de la visite guidée organisée pour un groupe de sans-abri aux Musées du Vatican et à la Chapelle Sixtine, en 2015, est emblématique, selon l’idée que l’expérience de l’art doit être inclusive, capable d’impliquer ceux qui sont normalement exclus, en brisant les barrières économiques, culturelles et sociales. “Les musées du Vatican doivent toujours être le lieu de la beauté et de l’accueil”, a écrit le pape François dans Mon idée de l’art.“Ils doivent accueillir de nouvelles formes d’art. Ils doivent ouvrir grand leurs portes aux personnes du monde entier. Ils doivent être un instrument de dialogue entre les cultures et les religions, un instrument de paix. Être vivants ! Non pas des collections poussiéreuses du passé réservées aux ”élus“ et aux ”sages“, mais une réalité vitale qui sait préserver ce passé pour le raconter aux gens d’aujourd’hui, à commencer par les plus humbles, et se préparer ainsi, tous ensemble, avec confiance pour le présent et aussi pour l’avenir”.
François a également invité les musées d’Église à se tourner vers le présent, en s’ouvrant à de nouvelles formes artistiques et à un langage contemporain, sans pour autant renier leur propre identité spirituelle. La fonction éducative et testimoniale du musée, selon lui, doit aller au-delà de la conservation : elle doit inspirer, questionner, ouvrir des horizons. En bref, pour le pape François, les musées doivent être un instrument d’humanisation et de spiritualité : des lieux où la beauté devient un langage universel et accessible, capable de raconter des histoires d’espoir et d’éveiller chez les visiteurs un sentiment de fraternité et d’accueil. Le monument inauguré sur la place Saint-Pierre en 2019, Angels Unaware (Anges inconscients), du sculpteur canadien Timothy Schmalz, est pertinent à cet égard. La sculpture, qui représente un bateau chargé de 140 migrants d’âges et d’horizons divers, s’inspire d’un passage de la lettre de saint Paul aux Hébreux : “N’oubliez pas l’hospitalité ; certains, en la pratiquant, ont accueilli des anges sans le savoir”.
La mise en valeur du patrimoine artistique passe également par de nouvelles ouvertures au public. En 2021, à la demande du pape, le palais du Latran, résidence historique des papes, jusqu’alors fermé à la visite, a été inauguré. Situé à côté de la basilique Saint-Jean-de-Latran, le palais abrite des fresques, du mobilier et des témoignages qui racontent des siècles d’histoire ecclésiastique. L’initiative a été conçue comme une forme de transparence, mais aussi comme une offre culturelle : rendre accessible un lieu sacré et historique, c’est partager sa valeur avec l’ensemble de la communauté.


Parallèlement, François a encouragé l’ouverture de la bibliothèque vaticane au monde contemporain. En 2021, les espaces du XVIIe siècle de la Bibliothèque ont accueilli l’exposition Tutti. Umanità in cammino, inspirée de l’encyclique Fratelli tutti. L’artiste a construit un parcours parmi des cartes, des symboles et des visages, donnant une forme visuelle à l’utopie de la fraternité universelle. Le projet rompt avec l’idée de la bibliothèque comme espace immobile : là aussi, l’art et la pensée doivent marcher ensemble, à l’écoute du présent.
Enfin, un regard sur la grande peinture italienne de la Renaissance. En 2023, les Musées du Vatican présenteront une exposition entièrement consacrée à la Résurrection du Pérugin, considérée comme l’œuvre préférée du pape François. Une exposition événement également destinée à célébrer le 500e anniversaire de la mort de l’artiste. Le choix du sujet - la Résurrection - n’a pas été fait au hasard : François a toujours valorisé l’art comme un signe d’espérance chrétienne, comme un moyen de redonner du sens et de la beauté dans les moments difficiles. Une fois l’exposition terminée, l’œuvre est retournée dans la bibliothèque privée du pape, où elle est habituellement conservée.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.