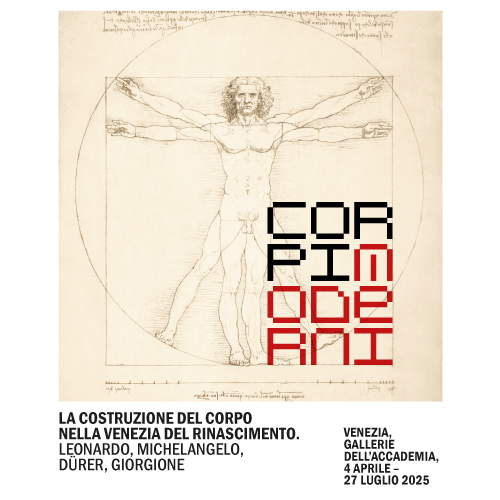Les traumatismes d'Urbania et de son palais ducal
Urbania, l'ancienne Casteldurante qui fut l'un des centres les plus importants du duché d'Urbino, a connu plusieurs traumatismes au cours de son histoire, inscrits dans les murs de son palais ducal, où l'on peut admirer la Madonna delle Nuvole baroque, une splendide œuvre du XVIe siècle.
Par Federico Giannini | 06/04/2025 15:48
Urbania conserve dans les murs de son palais ducal la poésie de Federico Barocci. La plupart des visiteurs y entrent pour voir de près la Madone des nuages, le magnifique tableau qui lui est attribué et qui se dévoile au terme d'un parcours sinueux à travers les salles de ce palais de la Renaissance qui domine le fleuve Metauro, frère cadet de celui qui se dresse quelques kilomètres plus loin, en bord de mer, à Urbino. Le musée aménagé dans les salles du palais ducal d'Urbania trouve son apogée dans la dernière salle, la plus cachée, un joyau au cœur de l'édifice, que l'on atteint après un itinéraire à travers l'histoire de la céramique, les photographies de l'ancien plan du musée civique, les gravures de Leonardo Castellani représentant les paysages de la vallée du Metauro, les peintures du territoire, les salles consacrées au potier Cipriano Piccolpasso, qui s'avère être l'une des divinités tutélaires de ces lieux. une des divinités tutélaires de ces terres, auteur d'un traité, nous disent les panneaux, "fondamental pour la connaissance de l'art céramique du Metauro pendant la Renaissance". La Madone des Nuages est la destination que l'on peut voir à la fin du voyage, c'est le prix pour ceux qui n'ont pas eu peur d'affronter le froid glacial des salles où, en hiver, les températures défient la résistance du visiteur le plus endurci, pour ceux qui ont marché dans les salles de la ville. Visiteur endurci, pour ceux qui ont marché sur tous les tapis qui recouvrent une partie des sols en terre cuite des salles, pour ceux qui se sont attardés sur tous les extraits de l'histoire d'Urbania que le Musée Civique installé dans les salles du Palais Ducal raconte à ses visiteurs. Des fragments, car il en reste peu. Mais ces salles renferment une histoire triste, une histoire de traumatismes qui se cachent derrière les murs ternes des salles, à l'intérieur des niches, sous les nuages de la douce Madone baroque. Des traumatismes de l'histoire qui se sont éloignés, le long du fleuve Metauro qui coule sous les tours du palais, dans l'air pur des montagnes qui entourent sa vallée, vers le Montefeltro, vers l'Alpe della Luna. Des traumatismes qui marquent encore le palais et la ville.
Lorsque la Madone des Nuages est sortie de l'atelier de Federico Barocci, Urbania ne s'appelait pas encore Urbania : elle s'appelait Casteldurante et était l'un des centres les plus vivants du duché d'Urbino, le point d'appui d'une production de céramique qui, avec quarante fours en activité, alimentait toute l'Europe. Toutes les cours européennes de la Renaissance voulaient des céramiques de Casteldurante. Même si, vers la fin du XVIe siècle, l'art des potiers, jusqu'alors riche et prospère, commençait à subir quelques revers. Le dernier duc d'Urbino, Francesco Maria II Della Rovere, avait travaillé dur et longtemps pour maintenir un niveau de production élevé, et sous son duché, les ateliers de potiers de Casteldurante étaient toujours en activité. Mais au XVIIe siècle, la poterie de Casteldurante est en passe de devenir une activité moins florissante qu'au siècle précédent. Au XVIIIe siècle, elle entre définitivement en crise. Aujourd'hui, la tradition est toujours maintenue par les ateliers qui travaillent sous la protection de l'association qui regroupe les villes italiennes de la céramique, mais en se promenant dans les rues du village, il est difficile de croire que cette activité a longtemps soutenu l'économie d'un des centres les plus importants du duché d'Urbino, un lieu où Francesco Maria II lui-même aimait séjourner pendant d'assez longues périodes. Il le préférait même à Urbino et y installa sa cour et son énorme bibliothèque. Les ducs, en revanche, tenaient à Casteldurante. Ceux qui se rendent au palais ducal d'Urbino remarquent la grande inscription par laquelle, dans la cour d'honneur, Federico da Montefeltro se présente à son hôte : "Federicus, Urbini Dux, Montisferetri ac Durantis comes". Federico, duc d'Urbino, comte de Montefeltro et Casteldurante.
Lorsque Michel de Montaigne passe par ces lieux lors de son voyage en Italie, le 29 avril 1581, les habitants de Casteldurante fêtent la naissance du fils aîné d'Isabella della Rovere, sœur de François-Marie II. Cette ville ne l'avait guère impressionné, à tel point qu'il ne lui consacre que quelques lignes dans son journal de voyage. Et il ne mentionne Francesco Maria que dans les pages consacrées à Urbino. Le duc, en revanche, avait de grands projets pour le palais de Casteldurante. Il préférait Casteldurante, de l'autre côté des collines. Et il voulait que son énorme collection de livres soit rassemblée ici : quinze mille volumes, une masse de matériel qui ferait sourire aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était une immense bibliothèque. L'une des plus grandes, des plus originales, des plus modernes d'Europe, une bibliothèque qui rassemblait toutes les connaissances de l'époque, dans tous les domaines. En 1607, François-Marie II fit également construire un bâtiment, la Libraria Nuova, à côté du palais ducal, pour abriter sa collection de livres. On peut imaginer qu'il en était particulièrement fier.



La légende veut que le duc ait conservé la Vierge des Nuages dans sa chambre, au-dessus de la tête de lit. C'est ce qu'a affirmé au XIXe siècle un érudit local, Giuseppe Raffaelli. En dehors de cette légende, évidemment infondée, on sait en revanche que le duc procura de nombreux travaux à Barocci, qui ne quitta d'ailleurs pratiquement jamais Urbino tout au long de sa carrière. Barocci a également réalisé le portrait du duc, celui qui se trouve aujourd'hui aux Offices. De la Vierge aux nuages, en revanche, on ne connaît pas la genèse et, à vrai dire, on ne sait même pas qui en est l'auteur. On pense qu'elle est liée à une commande venue de Madrid : la famille Della Rovere appréciait ses relations avec l'Espagne, et François Marie II n'avait pas dérogé à une coutume familiale. En effet, la famille Della Rovere appréciait ses relations avec l'Espagne et Francesco Maria II ne s'était pas soustrait à une coutume familiale : entretenir de bonnes relations diplomatiques avec les rois espagnols. La salle où se trouve la Vierge aux nuages contient également une réplique du crucifix, avec une image du palais ducal d'Urbino au pied du Christ, que le duc offrit à Philippe III en 1604 et qui se trouve aujourd'hui au Prado. En revanche, entre 1588 et 1592, quatre versements sont attestés pour un paiement important destiné à régler une peinture de Madone, que l'on croit aujourd'hui perdue : on pense que la Madone aux nuages pourrait être une reprise de l'invention que Barocci avait mise au point pour cette commande destinée à l'Espagne. D'autres pensent que la Vierge aux nuages d'Urbania n'est pas l'œuvre du maître, mais celle d'un collaborateur non spécifié de son atelier. Si c'est le cas, il faut imaginer un élève extrêmement sensible, aussi habile que Barocci pour traduire une idée du maître dans la délicatesse, la douceur et la suavité d'une Madone émouvante et touchante, qui, gracieusement appuyée sur son trône de nuages, montre d'un geste doux et maternel l'Enfant, veillant à ce qu'il ne tombe pas, le tenant de ses mains, laissant élégamment entrevoir un sourire alors qu'elle tourne les yeux vers le sujet. Un élève si talentueux qu'il n'a pas encore trouvé de nom, qu'il n'a pas encore trouvé de correspondance précise parmi les artistes que nous connaissons. Un artiste baroque anonyme capable de peindre l'une des plus belles madones du XVIe siècle. Ou, à tout le moins, capable de reproduire de manière presque totalement fidèle un original du maître que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui. Il existe en effet des dessins qui attestent sans l'ombre d'un doute que l'invention est due à Federico Barocci. Déjà au début du siècle dernier, Lionello Venturi disait que quelqu'un, en voyant le tableau de la Madone des Nuages reproduit sur une photographie, pourrait refuser d'en accepter l'attribution, car l'œuvre s'éloigne des "formes habituelles" de Federico Barocci. Pourtant, Venturi a déclaré que "devant l'original, ils reviendraient sur leur décision, car les couleurs sont typiques de Barocci et les formes s'expliquent par une influence de Raphaël plus intense que sur n'importe quelle autre œuvre de Barocci". Il ajoute que la beauté qui "transparaît à travers les repeints et les rides de la toile" ne permet pas d'attribuer le tableau à un écolier : "plus que tout autre, il nous montre Barocci en conversation avec Raphaël". Andrea Emiliani, en accord avec Venturi sur l'attribution à Barocci, a pris la Madone aux nuages comme modèle de "légèreté chromatique sévère", comme exemple d'une "construction de la grâce populaire qui revient [...] à l'immédiateté de la communication, certainement épaissie dans le regard doucement mélancolique et presque prémonitoire". Récemment, John Spike s'est exposé pour réaffirmer l'autographie baroque. En revanche, dès 1955, Harald Olsen s'est prononcé contre Barocci : "La composition est de Barocci, mais la peinture ne l'est certainement pas". À l'instar d'Olsen, Massimo Moretti a récemment réaffirmé les arguments classiques contre la paternité de l'œuvre : "les tons chair du visage et de la main de la Vierge et la facture picturale n'ont pas les transitions de couleurs saturées et habiles du maître". Qui est donc l'auteur ? Qui a pu traduire une idée de Federico Barocci si proche de l'original ? La Madone des nuages est-elle de Federico Barocci ? Est-elle au contraire entièrement l'œuvre d'un de ses collaborateurs ? Ou bien le maître a-t-il participé à l'exécution ? Le temps a-t-il occulté une éventuelle intervention directe de sa part ? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse certaine. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette œuvre n'aurait pas vu le jour sans l'idée primordiale du maître.
L'œuvre était autrefois conservée dans l'église des Chierici Minori, l'église de l'Ospedale di Urbania, où se trouve également le tombeau du dernier duc d'Urbino, et il est probable qu'elle était destinée à cette église, puisque cette même église fut construite sur ordre de François Marie II (en admettant toutefois l'œuvre baroque autographe, il y a incompatibilité de dates : le maître ayant disparu cinq ans avant la construction de l'église, il faut imaginer, dans ce cas, que l'œuvre a été réalisée antérieurement, puis donnée à l'église). Et c'est là que la Madone des nuages est restée jusqu'à récemment, jusqu'en février 2012, lorsque le plafond de l'église s'est effondré à cause d'une chute de neige, d'une ampleur hors du commun. Heureusement, trois mois plus tôt, l'œuvre avait été déplacée dans les réserves du Museo Civico, en vue d'une exposition. Curieusement, le nom de Madone des nuages est moderne, attesté pour la première fois en 1975. Auparavant, l'œuvre avait toujours été appelée Madone de la neige, du nom par lequel les habitants de Duranza appelaient leur église. Et la neige a réglé le sort de l'œuvre.




Nous pouvons être raisonnablement certains qu'aucune Vierge aux nuages ne veillait sur François Marie II lorsque le dernier duc d'Urbino mourut ici, dans sa chambre du palais ducal d'Urbania, le 28 avril 1631. Sans héritiers, l'ensemble du duché passa automatiquement à l'État pontifical. Cinq ans plus tard, le village changeait déjà de nom en l'honneur de son nouveau maître : cinq ans après la dévolution du duché à l'État pontifical, le pape Urbain VIII élevait Casteldurante au rang de ville et en faisait un siège épiscopal. Et en son honneur, Casteldurante, c'était en 1636, devint Urbania. Le souvenir de ce prélat provençal, Guglielmo Durante, nom italianisé de Guillaume Durand, qui l'avait fondé en 1284 pour héberger les survivants du sac de Castel delle Ripe, village situé un peu plus en amont et détruit en 1277 par les Gibelins d'Urbino, s'était effacé. C'est pour cette raison que le tissu urbain du village apparaît si régulier : il s'agit d'une ville de fondation, et Guglielmo Durante l'avait planifiée sur un bureau, au milieu du plateau qui accompagne le cours du Metauro vers la mer, avant qu'il n'atteigne les collines qui le séparent d'Urbino. Trois siècles et demi plus tard, Casteldurante, qui avait été presque une capitale dans les dernières années du duché d'Urbino, est morte. Urbania est née, destinée à devenir l'une des nombreuses provinces anonymes des États pontificaux.
Cette rétrogradation, ce déclassement à la périphérie lointaine "a dû être pour Casteldurante", écrit l'érudit Valerio Mezzolani, "un événement traumatisant comme peut-être pour aucun autre des centres de la région d'Urbino". En l'espace de moins de cent cinquante ans, presque toutes les résidences ducales du territoire étaient tombées en ruine. L'affront le plus grave remonte toutefois à 1667. François Marie II avait rédigé un legs en faveur des Pères Caracciolini de Casteldurante, afin qu'ils prennent soin de ses livres, mais cette année-là, le pape Alexandre VII voulut que presque tous les volumes de la Libraria Nuova soient transférés à Rome, afin d'alimenter les rayons de la bibliothèque du Studium Urbis, l'Université de Rome. La Biblioteca Alessandrina, comme on l'appelle encore aujourd'hui (et qui conserve sa vocation de bibliothèque universitaire), avait été fondée le 20 avril de cette année-là et avait besoin de livres. Le pape Chigi a donc considéré que la consultation de l'ensemble de la bibliothèque durantine était utile à cette fin. Le délégué du pape, Marco Antonio Buratti, avait permis que cinq cents livres, sur les quinze mille originaux, restent à Urbania "pour le bénéfice de la ville" (quelle bonté !). Le pape avait effectivement ouvert au public une collection pour laquelle le legs de Francesco Maria II n'avait pas prévu de forme de partage avec la communauté. Mais il avait arraché à Urbania son patrimoine le plus précieux. Aujourd'hui, il ne reste que quelques livres dans le Palais Ducal et les deux grands et rares globes de Gerardo Mercatore, offerts par Francesco Maria II et sauvés de la spoliation : ils font partie des objets les plus précieux du musée.
Le traumatisme le plus récent a une date et une heure précises : 23 janvier 1944, 12h42. Journée claire et ensoleillée. Les B17 de l'aviation américaine bombardent le centre d'Urbania et le dévastent. Les victimes sont au nombre de 250, les blessés 515, sur une population de six mille habitants : un habitant sur sept en subit les conséquences sur sa peau, littéralement. Le centre historique a été presque rasé, l'aile du XVIe siècle du Palais Ducal réduite à l'état de ruines, l'église du Saint-Esprit anéantie, et les dégâts aux bâtiments publics et privés sont énormes. Un bombardement insensé, car Urbania était loin du front, elle n'abritait aucune garnison militaire, il n'y avait pas de soldats, elle n'était pas un nœud logistique, aucune voie de communication importante ne passait par là. Aujourd'hui encore, ce massacre reste inexpliqué. Il est probable qu'il s'agisse d'une erreur, que les avions américains aient voulu frapper Poggibonsi, en Toscane, où se trouvaient des soldats allemands. Nous n'en savons rien. Et peut-être ne saurons-nous jamais pourquoi Urbania a dû payer un si lourd tribut ce jour-là.




Le Palais Ducal, quant à lui, avait cessé depuis longtemps d'être une résidence noble, un siège institutionnel, un centre politique. Avec la dévolution, le bâtiment avait été intégré à l'administration de la Camera Apostolica, et le mobilier et les collections, autre traumatisme, avaient suivi le destin des collections ducales, qui s'étaient en grande partie retrouvées à Florence, suite au mariage entre Vittoria della Rovere, nièce de François-Marie II et dernière descendante de la famille, et Ferdinand II de Médicis. Elle était restée, pour l'essentiel, un vase vide. Puis, au XVIIIe siècle, la Chambre apostolique concéda l'usage du palais à la noble famille Albani, qui y installa une fabrique de céramique qui resta active jusqu'en 1892. L'activité ne s'est pas arrêtée pour autant, car même dans les décennies suivantes, le palais ducal a continué à accueillir de petits ateliers de céramique, au moins jusqu'aux années 1950, lorsque le musée civique d'Urbania a commencé à s'installer dans les salles du palais. En 1980, le palais ducal est devenu la propriété de la municipalité d'Urbania.
Les traumatismes d'Urbania, oui, sont inscrits sur le plâtre du Palais Ducal, à l'intérieur de ses salles, dans le tissu urbain de la ville, où la nouvelle église du Spirito Santo, construite après la guerre, est aujourd'hui un temple votif, un sanctuaire dédié aux victimes des bombardements. Et son Palais Ducal a repris vie, car ce n'est pas seulement un musée. Il abrite la bibliothèque municipale, qui compte 60 000 volumes et une importante collection d'antiquités. Il y a des archives historiques. Il y a un centre culturel polyvalent, une salle de conférence, quelques salles abritent une école de musique, il y a aussi des services culturels que la municipalité offre à ses citoyens. Des ateliers de céramique sont toujours organisés. Un petit musée consacré à la civilisation rurale de ces terres a également été aménagé dans les caves. Urbania, comme toutes les villes industrieuses, regarde vers l'avenir.