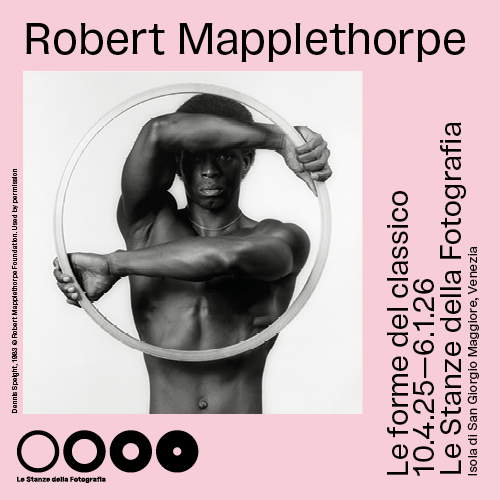Le Museo delle Sinopie de Pise : un voyage à travers un patrimoine unique
Le Museo delle Sinopie de Pise possède un patrimoine unique, l'une des collections les plus rares au monde : les sinopies, dessins préparatoires des fresques du Cimetière Monumental. Un voyage à l'intérieur du musée.
Par Noemi Capoccia | 23/04/2025 18:57
Il y a des histoires qui émergent à travers la tragédie et des images qui n'apparaissent que lorsque le matériau qui les recouvre est arraché avec force. C'est le cas des sinopies du cimetière monumental de Pise: des œuvres qui n'étaient pas destinées à apparaître et qui constituent aujourd'hui l'une des collections les plus rares et les plus fascinantes au monde. L'actuel musée des sinopies de Pise est situé dans un bâtiment de grande valeur historique : l'ancienne église de la Miséricorde, construite dans la seconde moitié du XIIIe siècle sur un projet de l'architecte Giovanni di Simone. L'édifice lui-même est un témoignage du passé, un exemple d'architecture gothique pisane, avec ses arcs en plein cintre et ses lignes sobres. Restauré après les dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été choisi pour accueillir les sinopites du Camposanto Monumentale : un acte symbolique de renaissance culturelle et artistique après les dévastations du conflit.
Mais qu'est-ce qui fait l'importance de ce musée ? Son objet d'étude et d'exposition : les sinopites. Le terme désigne les dessins préparatoires réalisés par les artistes directement sur l'enduit brut du mur (appelé "arriccio") avant de passer à la fresque proprement dite. Le pigment utilisé était généralement la terre de Sinope, une argile rouge provenant de la colonie grecque du même nom sur la mer Noire.
Les sinopites représentent l'"envers" de la fresque, la genèse silencieuse de certaines des peintures murales les plus célèbres de l'histoire de l'art italien. Le musée qui les conserve raconte, outre la naissance de l'image picturale, une histoire de perte et de récupération. Les sinopites représentent la première phase créative du processus pictural : c'est le moment où l'artiste donne forme à sa vision, esquisse des figures, expérimente les proportions, décide des compositions. Elles sont la pensée qui devient signe. Au Moyen Âge, les peintres réalisent rarement des dessins sur papier ou sur parchemin : les matériaux sont chers et la pratique du dessin sur support mobile est encore limitée. C'est pourquoi les sinopites sont aujourd'hui inestimables et donnent un aperçu direct de la main de l'artiste, de ses incertitudes, de ses intuitions. Normalement, les traces étaient recouvertes de l'enduit le plus fin, l'intonachino, sur lequel étaient peintes des fresques.



Une fois l'œuvre achevée, les sinopia sont restées à jamais cachées sous les couleurs. C'est précisément pour cette raison que leur survie représente un événement sans précédent : une fenêtre ouverte sur l'esprit de l'artiste, sur la genèse de l'œuvre. C'est par ce geste que des artistes comme Bonamico Buffalmacco, auteur du Triomphe de la mort, ou Taddeo Gaddi et Pietro di Puccio da Orvieto, ont commencé à raconter les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament sur les murs du Camposanto pisan. C'est précisément Pietro di Puccio qui s'est attaqué le premier au cycle des Histoires de l'Ancien Testament, qui sera complété plus tard par Benozzo Gozzoli, un maître de la Renaissance connu pour sa vivacité narrative. Ce cycle représente aujourd'hui l'exemple le plus complet de graphisme du XIVe-XVe siècle connu dans le monde. Le Museo delle Sinopie abrite ainsi la plus grande collection existante de dessins muraux médiévaux, témoignages directs de l'acte créatif des artistes. Les traits préparatoires, souvent réalisés sous l'effet d'une impulsion immédiate, nous permettent de saisir la main de l'auteur dans toute sa spontanéité. Dans de nombreux cas, il est possible de reconnaître des styles différents au sein d'un même cycle de peintures, même si l'œuvre achevée semble stylistiquement homogène. C'est le cas, par exemple, de la Crucifixion attribuée à Francesco Traini. Le musée conserve également des sinopites de cycles plus tardifs, datant de la fin du XIVe et du XVe siècle, comme les Histoires de Job de Taddeo Gaddi, les Histoires de saint Ranieri peintes par Andrea Bonaiuti et les récits de l'Ancien Testament peints à fresque par Benozzo Gozzoli.
Mais si les sinopites devaient à l'origine rester cachées sous les couches picturales, qu'est-ce qui les a mises en lumière ? C'est un événement dramatique qui les a rendues visibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du bombardement de Pise, un incendie ravagea une grande partie du Camposanto. Les flammes, alimentées par la chaleur de l'explosion, ont également touché les fresques historiques. La seule intervention possible pour préserver les parties les moins compromises a été le détachement selon la technique de l'arrachage, une méthode qui permet de ne retirer que la couche la plus superficielle de la fresque, d'une épaisseur de deux ou trois millimètres seulement. L'opération s'est avérée fructueuse : dès 1948, l'architecte Paolo Sanpaolesi pouvait confirmer le succès des premières interventions sur les fresques du Triomphe de la Mort, de la Thébaïde et de cinq scènes particulièrement endommagées du cycle de Benozzo Gozzoli. Malgré les difficultés saisonnières et les conditions différentes des fresques, écrit Sanpaolesi, "elles sont parfaitement réussies. La nature même de la technique, moins invasive que d'autres méthodes plus anciennes telles que le décapage de grandes parties du mur, a permis la découverte des sinopites sous les fresques du Camposanto.
Cette découverte inattendue a ouvert aux chercheurs l'accès à un patrimoine artistique caché, présentant ainsi de nouvelles interprétations sur les processus créatifs des artistes entre le Moyen Âge et la Renaissance. Jusqu'au milieu du XVe siècle, en effet, la sinopia était la principale méthode de conception picturale, avant d'être progressivement supplantée par la technique du spolvero, plus rapide et plus fonctionnelle. Grâce à la même technique d'arrachage, les sinopites ont également été détachées des murs et sauvées de la destruction. En 1979, elles ont enfin trouvé leur place dans le musée qui leur est consacré, un lieu qui permet de lire les pensées de l'artiste avant qu'elles ne se transforment en images définitives.
La collection est abritée dans un bâtiment historique, qui raconte à son tour une histoire longue et complexe. Probablement construite sur le site d'un hôpital médiéval préexistant, la structure est connue sous le nom de Spedale della Misericordia ou, plus tard, de Santa Chiara. Il a été conçu par Giovanni di Simone, l'architecte qui a commencé à travailler sur le cimetière lui-même. Construit en briques entre 1257 et 1286, il abritait à l'origine le Pellegrinaio degli Infermi, une vaste salle rectangulaire destinée à l'accueil des pauvres, des pèlerins et des malades. Ce dernier accueillait les malades, les pauvres et les pèlerins en transit vers Pise, apportant son aide à tous ceux qui en avaient besoin. Dans les années 1970, l'édifice a cessé sa fonction hospitalière et a retrouvé une nouvelle vie grâce à un projet de restauration visant à le transformer en musée. Les travaux de restauration, menés entre 1975 et 1979 sur un projet des architectes Gaetano Nencini et Giovanna Piancastelli, ont abouti à l'inauguration du Museo delle Sinopie di Pisa en 1979.



La structure du musée se distingue par son toit à fermes en bois et sa décoration intérieure en faux marbre bichrome, témoignage de l'élégance sobre de l'architecture pisane médiévale. En 2005, un nouvel aménagement du musée et un nouvel éclairage conçu par la société Targetti ont redéfini ses fonctions : aujourd'hui, le musée des sinopias intègre les exigences de l'exposition aux espaces dédiés à l'information et à la communication, en maintenant le lien entre la mémoire historique et l'utilisation contemporaine. Après leur découverte, les sinopites ont été délicatement détachées des murs endommagés et transférées sur de nouveaux supports, dans le but d'assurer leur conservation dans le temps. Le site, comme l'a souligné l'historien de l'art Luca Ciancabilla, représente "une page d'une importance considérable dans l'histoire de la restauration et de la conservation de l'ancien patrimoine pictural italien. En effet, il s'agit d'un véritable atelier expérimental, qui marque un tournant dans la pratique de l'extraction : pour la première fois, l'intervention ne concerne pas seulement le détachement des fresques, qui sont transférées sur des supports en éternit, jugés plus sûrs que les toiles périmées, mais s'étend également aux sinopites sous-jacentes. Celles-ci ont fait l'objet des mêmes soins de conservation et d'analyse, au point d'être valorisées sur le plan muséographique et de l'exposition. Une approche entièrement nouvelle "Jamais, au cours des trois siècles qui ont marqué l'évolution technique et historique de la pratique de l'extraction, écrit encore Ciancabilla, on n'avait essayé de mettre également en lumière le dessin sous la peinture murale. À Pise, le bombardement n'avait pas seulement provoqué un désastre auquel il avait été remédié par le détachement généralisé des peintures concernées, mais il avait également favorisé la découverte et le transport consécutif des sinopites, permettant à ces témoignages particuliers de l'art antique de faire l'objet d'études artistiques nouvelles et inédites dans d'autres villes italiennes également. Les dessins préparatoires, témoins de la phase créative de l'artiste, ont ainsi commencé à susciter un intérêt sans précédent, déclenchant de nouvelles études dans d'autres réalités italiennes également. "Ce chantier, poursuit M. Ciancabilla, marquera à jamais les décennies suivantes en ouvrant la campagne d'enlèvement de fresques et de sinopiae la plus importante et la plus généralisée que notre pays ait connue dans son histoire récente ; une phase qui a représenté le point culminant de la confiance dans cette technique de conservation particulière.
À l'intérieur du musée, chaque sinopia est accompagnée de panneaux explicatifs qui illustrent le contexte historique et artistique, permettant au visiteur de comprendre l'importance de ces dessins dans la création des fresques. Les sinopites, en effet, révèlent aussi leurs choix, leurs arrière-pensées et leur vision de la conception. Des témoignages précieux, qui restituent le geste créatif dans sa forme la plus immédiate.