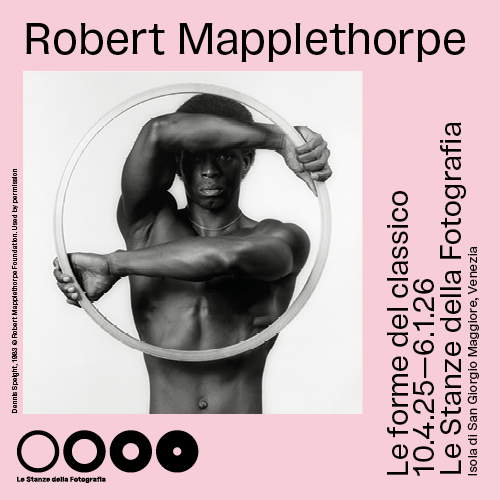La cathédrale Saint-Rombald de Malines, chef-d'œuvre du gothique brabançon
La ville de Malines, en Flandre, possède un édifice dans son centre historique, la cathédrale Saint-Rombald, qui peut être considérée comme un monument central de la culture locale, ainsi qu'un chef-d'œuvre du gothique brabançon.
Par Redazione | 23/04/2025 14:50
La ville de Malines, en Flandre, possède dans son centre historique un édifice, la cathédrale Saint-Rombald, qui peut être considéré comme un monument central de la culture locale : cette église n'est pas seulement le cœur spirituel de la ville, elle est aussi le témoin silencieux de ses hauts et de ses bas dans l'histoire. Sa célèbre tour, bien qu'inachevée, se dresse depuis des siècles, du haut de ses 97 mètres, comme un point de repère physique et symbolique dans le paysage urbain, un point de repère capable de raconter une histoire de foi, d'art, de destruction et de renaissance.
La construction de l'église a commencé peu après 1200, sur une aire de culte préexistante, avec l'ambition de créer une structure capable de surpasser toutes les paroisses environnantes en termes d'impression. En fait, dès ses origines, San Rombaldo a été conçue comme une église destinée à devenir la plus grande de la ville. L'édifice a été consacré en 1312, lorsque le chœur, le transept et les trois premières travées de la nef ont été achevés : l'église pouvait ainsi être dédiée au missionnaire irlandais Rumoldus, dit Rombald de Malines, qui vécut au VIIIe siècle et évangélisa le Brabant, terre où se trouve la ville (Rombald, selon la tradition, mourut à Malines en 775). Mais sa transformation en cathédrale n'est intervenue qu'en 1559, avec la création du diocèse de Malines.


Évolution architecturale : un bâtiment emblématique du gothique brabançon
Au cours du XIVe siècle, l'église subit une profonde rénovation stylistique qui la transforme en premier exemple majeur du gothique brabançon. Ce style, qui marquera de manière indélébile l'architecture sacrée des Flandres, trouve en Jean d'Oisy l'un de ses principaux interprètes. C'est lui qui dirige la rénovation de l'église après l'incendie qui a frappé la ville en 1342, et c'est lui qui surélève la nef et le chœur, et conçoit le déambulatoire orné de sept chapelles radiales, donnant à l'ensemble un tracé grandiose et cohérent.
Après la mort de l'architecte en 1375, les travaux se sont poursuivis pendant des décennies : les voûtes de la nef ont été achevées en 1437, celles du chœur en 1451. Les solutions stylistiques adoptées pour l'église Saint-Rombald ont ensuite été imitées dans d'autres édifices de culte, signe de l'importance du projet pour l'ensemble du Brabant. L'ensemble devint rapidement un modèle architectural.


La tour inachevée, un rêve de grandeur interrompu
C'est la tour qui rend la cathédrale Saint-Rombald unique. Son projet, confié à Jan II Keldermans, prévoyait une hauteur de 600 pieds, soit environ 167 mètres (le plan est conservé). Le début des travaux est daté du 22 mai 1452, avec la pose de la première pierre. Les fondations, solides et monumentales, témoignent de l'ambition de l'ouvrage, mais avec l'avancée des guerres de religion et la raréfaction progressive des moyens, les travaux se ralentissent jusqu'à s'arrêter complètement en 1520.
En 1546, un événement dramatique met définitivement un terme au projet : l'explosion de la poudrière de la ville détruit un tiers de Malines, fait environ 200 victimes et décrète l'abandon du projet. La tour est restée à 97,28 mètres de hauteur, mais elle est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de la ville et de toute la Belgique. Au fil des siècles, sa fonction est allée bien au-delà de celle d'un simple clocher : elle est devenue un beffroi (c'est-à-dire une tour civique), une tour de guet et la gardienne des documents les plus importants de la ville. Aujourd'hui, la tour est ouverte au public: on peut gravir ses 538 marches pour atteindre la plate-forme au sommet, d'où l'on peut admirer la vue sur la ville.
La tour abrite également les 49 cloches , dont la Salvator, une cloche monumentale pesant près de neuf tonnes, la Jehsus, coulée en 1460, et la Liberation, ajoutée après la Seconde Guerre mondiale. Au total, il s'agit d'un carillon de plus de 80 tonnes, qui fonctionne toujours (bien que seules les plus grosses cloches se balancent encore). En montant les marches jusqu'au sommet de la tour, on traverse des salles qui racontent le passé de la ville et du carillon lui-même. La dernière passerelle offre une vue panoramique exceptionnelle : par temps clair, on peut même apercevoir les sphères de l'Atomium de Bruxelles.


La destruction et la renaissance d'un édifice
Au cours des siècles, la cathédrale Saint-Rombald a subi de nombreuses destructions. Les guerres de religion du XVIe siècle comptent parmi les plus dévastatrices : en 1580, lors du massacre de Malines, un événement dévastateur au cours duquel les calvinistes de Bruxelles, aidés par des mercenaires anglais, ont violemment conquis la ville, la soumettant à des raids et à des pillages, l'intérieur de la cathédrale a également été pillé par les troupes mercenaires. Le mobilier gothique, qui comprenait une quarantaine d'autels finement décorés, fut en grande partie détruit. Les reliques furent dispersées, mais retrouvées plus tard grâce à l'intervention des fidèles.
De 1580 à 1585, sous la domination calviniste, la cathédrale fut transformée en église protestante. Le mobilier liturgique catholique fut retiré et l'édifice changea radicalement de fonction. Le retour au catholicisme a eu lieu le 4 août 1585, mais les blessures de cette période sont restées évidentes. D'autres déprédations ont eu lieu lors des invasions napoléoniennes, en 1792 et 1794. Le XXe siècle a apporté de nouveaux désastres : la Première Guerre mondiale et un grave incendie en 1972 ont causé d'importants dégâts, mais même dans ces cas, la cathédrale a été restaurée avec soin et dans le respect de son identité historique.

Art flamand et chefs-d'œuvre immortels
L'intérieur de la cathédrale est aujourd'hui un voyage à travers l' histoire de l'art flamand. Parmi les œuvres les plus célèbres figure le Christ en croix d'Antoon van Dyck. Cette peinture, inspirée du maître Rubens, représente un moment de la plus haute expression artistique par son intensité émotionnelle et compositionnelle. Placé à l'origine dans l'église franciscaine de la ville, le tableau a été emporté en France pendant la Révolution. De retour en Belgique, il fut offert par Guillaume Ier à la cathédrale en 1816, où il est encore conservé aujourd'hui comme un véritable chef-d'œuvre.
Outre Van Dyck, la cathédrale abrite des œuvres de Michel Coxcie, Gaspard de Crayer et Abraham Janssens. Le sculpteur Lucas Faydherbe, élève de Rubens, joue également un rôle central en réalisant en 1665 le majestueux maître-autel baroque en marbre, orné de 25 panneaux narratifs et des tombeaux des archevêques.
Un espace sacré pour la ville et la mémoire collective

Au XVIIe siècle, lors de la Contre-Réforme, la cathédrale subit une profonde rénovation de sa décoration. Des statues monumentales des apôtres et des évangélistes sont ajoutées le long des piliers, tandis que de nouveaux vitraux contribuent à créer une atmosphère d'intense spiritualité et de théâtralité liturgique. Parmi les éléments les plus curieux qui subsistent, citons les armoiries héraldiques en bois des trente chevaliers de la Toison d'or, rassemblés dans la cathédrale sous la direction du jeune Philippe le Bel.
Aujourd'hui, la cathédrale de Saint-Rombaldo représente un patrimoine unique, où l'histoire civile et l'histoire religieuse s'entremêlent dans une étreinte continue. Son rôle n'est pas seulement celui de siège archiépiscopal du diocèse de Malines-Bruxelles, mais aussi celui de gardien d'une mémoire collective qui traverse les siècles et se renouvelle chaque jour. Monter dans la tour, écouter ses cloches, admirer les œuvres d'art, c'est faire un voyage dans l'histoire et l'âme de la Flandre.