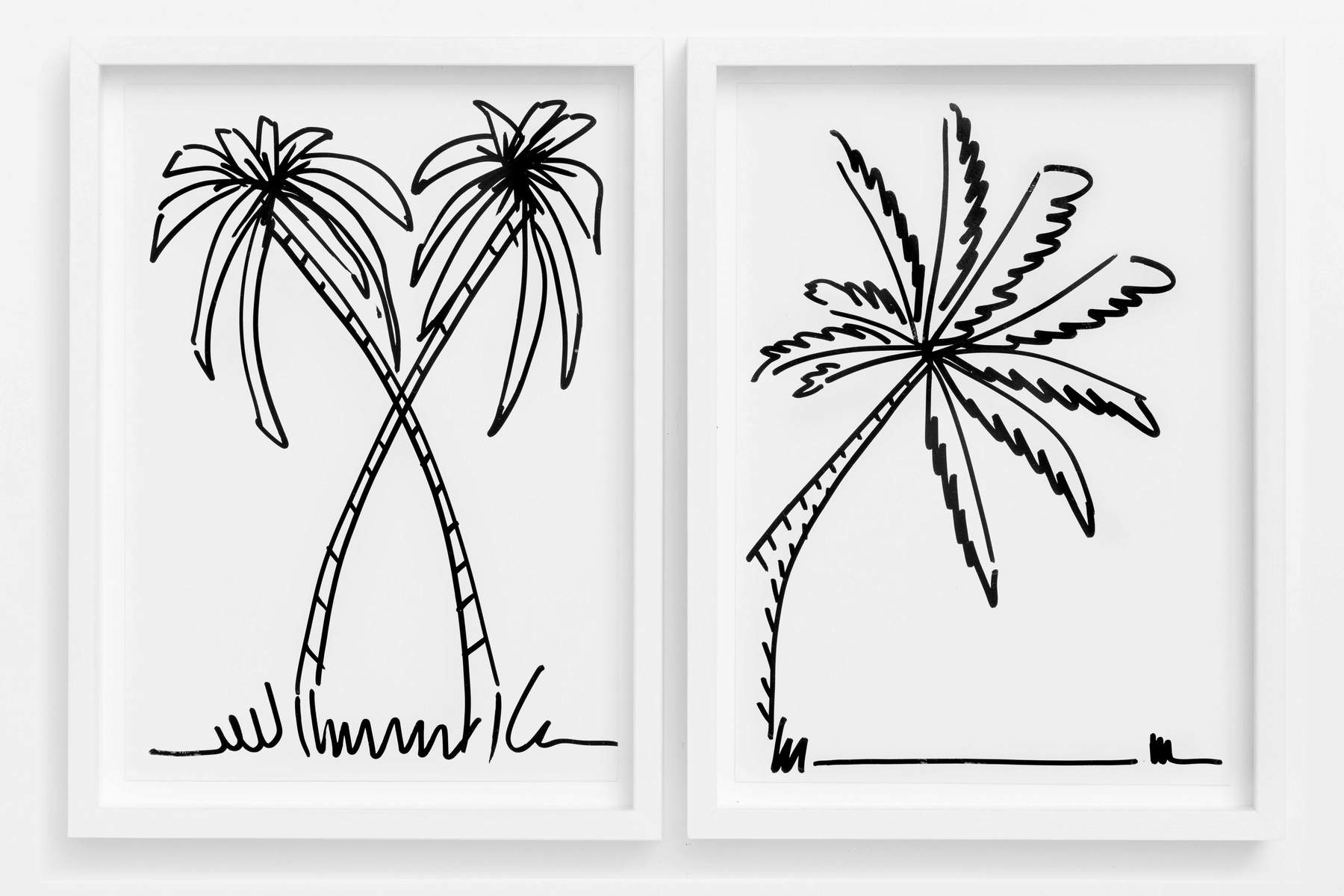by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), published on 24/02/2019
Categories: Bilan de l'exposition
/ Disclaimer
Compte-rendu de l'exposition 'Panorama. Approches et dérives du paysage en Italie', à Bologne, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, du 29 janvier au 13 avril 2019.
Le paysage, Henri-Frédéric Amiel en était convaincu, révèle un état de notre âme. Le philosophe français confie cette pensée à son Journal intime, écrit entre 1883 et 1884: des décennies après l’expérience de Friedrich avec ses panoramas à la fenêtre, l’invention de l’appareil photographique avait été pleinement acceptée (du moins par les peintres les plus ouverts, les plus modernes et les plus clairvoyants), et le chemin avait été pris qui allait conduire beaucoup à abandonner un art fondé sur la pure mimesis. Friedrich, observant son Dresde derrière la fenêtre de son atelier, avait introduit dans la peinture de paysage le sujet qui l’observait (et c’était une vision poignante, un désir irréalisable, une aspiration romantique à l’infini qui ne pouvait être satisfaite), lesimpressionnistes seraient les premiers à étudier les conditions changeantes de la lumière sur le paysage, et une certaine peinture symboliste d’abord (Khnopff surtout) et divisionniste ensuite (pensons à Segantini, Grubicy, De Maria, et dans une certaine mesure même à Morbelli) chargeront le paysage d’une tension spirituelle sans précédent afin de l’utiliser comme moyen de transmission d’un certain état d’esprit au spectateur. Et peu après, la peinture de paysage connaîtra de nouveaux bouleversements: en témoignent les vues futuristes qui nous parlent de villes en profonde transformation, projetées vers la modernité.
Si l’on a voulu donner ici un aperçu très bref, et forcément incomplet, des événements qui allaient conduire au paysage du XXe siècle, c’est avant tout pour dire que Claudio Musso a raison lorsqu’il introduit son exposition Panorama. Approdi e derive del paesaggio in Italia (à la Fondazione del Monte à Bologne jusqu’au 13 avril 2019), il précise qu’il est difficile, voire presque impossible, de trouver une définition du “ paysage ”: pour citer quelques exemples illustres, pour Fernow le paysage est comme la musique, puisqu’il n’a pas de contenu précis et agit sur le sentiment de l’observateur comme la musique agit sur l’auditeur, et encore selon Ragghianti le paysage n’est pas un objet de perception mais plutôt “un décor ou un spectacle comme n’importe quel film ou n’importe quelle pièce de théâtre ou n’importe quel ballet” (et par conséquent, contempler un paysage, pour un peintre, équivaudrait à “faire danser les formes, les couleurs”, comme le ferait un maître de ballet avec des danseurs), et Argan, discutant des œuvres de Juvarra, avait inventé l’expression “nature architecturale” pour se référer au paysage. De la difficulté à trouver une voie univoque pour le paysage naît donc la nécessité de s’appuyer, en écho à Rosenberg, sur une définition s pour souligner que, écrit Musso, “c’est le paysage lui-même qui se définit, qui actualise continuellement son identité, tant au niveau littéral (circonscrire, dé-limiter, dé-terminer un con-end), qu’au niveau culturel, en fonction de l’époque et de la latitude à laquelle l’observation a lieu”. Il n’y a donc pas de paysage unique (et donc pas de peinture de paysage unique): il y a probablement autant de paysages que de sujets de vision.
Il est cependant possible de dégager un fil conducteur qui relie les expériences des artistes que Claudio Musso a réunis pour son exposition collective qui, d’une certaine manière, entend photographier l’état de l ’art italien du paysage aujourd’hui: d’une manière certes incomplète, mais néanmoins efficace. Il s’agit d’un fil conducteur qui part d’une exposition organisée à Bologne il y a presque quarante ans: entre 1981 et 1982, la Galleria d’Arte Moderna locale a accueilli une exposition dont le commissaire était Tomás Maldonado (Buenos Aires, 1922 - Milan, 2018) et qui s’intitulait Landscape: image and reality (Paysage: image et réalité). Dès le titre, il était clair que l’objectif était de présenter au public l’expérience du paysage à deux niveaux (l’objet de la vision d’une part et le sujet d’autre part), qui, dans l’expérience de l’artiste, sont co-présents, détachés puis réunis, mélangés, divisés et poursuivis, se déplaçant sur différentes dimensions (vécues, imaginées, rêvées, remémorées, construites, hypothétiques, et ainsi de suite). Et de l’exposition des années 1980, elle conserve l’optique d’ouverture, l’attitude “exploratoire” (telle que définie par Tomás Maldonado), l’intention de ne pas fournir de réponses mais de préparer un terrain de recherche.
 |
| Salle d’exposition Panorama. Atterrissages et dérives du paysage en Italie |
 |
| Salle de l’exposition Panorama. Atterrissages et dérives du paysage en Italie |
Les photographies de Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 - Reggio Emilia, 1992), dont l’une, Passignano, a été placée à l’ouverture du Panorama comme un manifeste clair d’intentions, ont également été discutées dans Paysage: image et réalité: En dressant un bref profil de sa poétique, Vittorio Savi écrit que les images de Ghirri sont déjà composées à la perfection dans le viseur du photographe (car pour Ghirri, le paysage, avant même d’être tel, est l’image du paysage), et l’artiste lui-même, en décrivant la série des Paysages italiens dont fait partie Passignano, explique qu’il ne s’agit pas tant d’une description que d’une perception du lieu qui fait l’objet de la photographie. Et du lieu, souligne Savi, Ghirri ne possède pas la notion scientifique, mais plutôt “la réalité qualitative et la conscience qu’il s’agit d’un concept clairement distinct des catégories de paysage (l’ensemble des faits physiques qui se manifestent et coexistent sous une forme transitoire dans l’espace d’un territoire, subjectivement perçu par l’observateur) et de site (la sphère territoriale circonscrite dont toutes les caractéristiques sont connues)”. Cette prémisse du “paysage comme image” dans l’exposition est ensuite enrichie par les dessins d’Antonio Sant’Elia (Côme, 1888 - Monfalcone, 1916), prêtés par la Fondation Cirulli de San Lazzaro di Savena: Si les photographies de Ghirri constituent le point de départ conceptuel de l’exposition, les dessins de Sant’Elia représentent une sorte d’introibo historique, et si le paysage du XXIe siècle est en grande partie une vision urbaine (évidemment dans toutes ses déclinaisons possibles), l’architecte futuriste par excellence, avec ses dessins imaginant les villes futuristes de demain, en est l’anticipateur le plus naturel.
Et si la ville est le point de départ, on ne peut s’empêcher de regarder le mur opposé pour se plonger dans les ruines industrielles d’Andrea Chiesi (Modène, 1966), qui nous obligent en partie à nous confronter à une réalité de précarité et de destruction, mais qui sont en même temps animées d’une tension spirituelle inattendue qui commence par un sentiment de mélancolie, à comprendre comme “un signe d’une géographie effacée”, selon la définition de Ghirri lui-même. Ce sentiment d’égarement implique la recherche d’un rapport renouvelé avec la nature (qui est d’ailleurs le protagoniste des recherches les plus récentes de Chiesi, bien qu’il faille souligner qu’il n’a jamais abandonné son art), ou le retour à des situations intimes: Dans l’exposition, nous avons l’occasion d’aborder les atmosphères émiliennes de The House, une autre série d’Andrea Chiesi, dont l’un des tableaux est exposé à Bologne, mais aussi la Stellar Road de Davide Tranchina (Bologne, 1972), qui raconte un paysage familier, celui de la Via Emilia, afin de le rediscuter en le transmutant dans une dimension universelle. Les atmosphères suspendues des œuvres de Chiesi et Tranchina se poursuivent avec Tornade de Francesco Pedrini (Bergame, 1973), un dessin avec lequel l’artiste tente de communiquer l’idée de l’incapacité à saisir dans leur intégralité certains phénomènes de la nature dont tout le monde est pourtant conscient (et que Pedrini, avec son Instrument qui recueille les sons et les bruits du ciel, nous invite à écouter), et avec l’olî de Valentina D’Amaro (Massa, 1966), qui est présente dans l’exposition avec quelques œuvres de la série des Viridis: La nature, apparemment si proche de nos propres sentiments, est en réalité élaborée, synthétisée, mise à nu, de sorte que le paysage perd son caractère propre et devient une métaphore pour toucher des cordes profondes, laissant un sentiment d’attente (il semble presque que les vues aliénantes de Valentina D’Amaro doivent se transformer à tout moment: après tout, le vert est aussi un symbole de vie, de régénération). La première salle se termine par Daniel González (Buenos Aires, 1963) et son Low-Cost Panorama (une architecture éphémère, celle d’un terrain de football gonflable enfermé dans un emballage, qui offre la possibilité de modifier temporairement l’espace), et par les œuvres ironiques de Filippo Minelli (Brescia, 1983) qui, comme l’artiste argentin, se penche sur le thème de la perception de l’espace, en essayant de désorienter l’observateur, même si c’est avec un expédient quelque peu banal, celui de la superposition d’images (dans ce cas téléchargées d’Internet) sur le véritable morceau de paysage auquel elles correspondent.
 |
| Luigi Ghirri, Passignano, de la série Paysage italien (1988 ; cibachrome à partir d’une diapositive, 19,9 x 24,9 cm). Avec l’autorisation de la collection privée, Bologne |
 |
| Antonio Sant’Elia, Sans titre (vers 1912 ; crayon sur papier, 29,6 x 31 cm). Avec l’autorisation de la Fondazione Massimo et Sonia Cirulli, Bologne. |
 |
| Antonio Sant’Elia, Sans titre (vers 1912 ; crayon sur papier, 29,7 x 24,5 cm ; Bologne, Fondazione Massimo e Sonia Cirulli) |
 |
| Andrea Chiesi, Eschatos 2 (2017 ; huile sur lin, 50 x 50 cm). Avec l’autorisation de d406, Modène |
 |
| Andrea Chiesi, The House 28 (2004 ; huile sur lin, 100 x 140 cm). Avec l’autorisation d’Angelo Zanetti, Modène |
 |
| Davide Tranchina, Strada Stellare #3 (2016 ; impression giclée véritable, dibond, cadre, 45 x 45 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
 |
| Davide Tranchina, Strada Stellare #4 (2016 ; impression giclée véritable, dibond, cadre, 45 x 45 cm). Avec l’aimable autorisation de l’artiste |
 |
| Francesco Pedrini, Tornado#6 (2016 ; graphite, fusain, pigments sur papier Kozo, 100 x 140 cm). Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galleria Milano, Milan. |
 |
| Francesco Pedrini, Strumento#5 (2017 ; bois, cuivre et cuir, hauteur 175 cm, diamètre 15 cm). Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galleria Milano, Milan. |
 |
| Valentina D’Amaro, Sans titre, de la série Viridis (2016 ; huile sur toile, 40 x 50 cm). Avec l’autorisation d’une collection privée |
 |
| Daniel González, Panorama low-cost (2018-19 ; architecture éphémère, terrain de football gonflable et emballage). Avec l’autorisation de l’artiste |
 |
| Filippo Minelli, Sans titre (2018 ; techniques mixtes). Avec l’autorisation de l’UNA, Piacenza |
En voulant trouver un lien qui unit les œuvres de la deuxième salle, on pourrait penser au paysage comme une rencontre et un choc (par exemple entre la nature et la ville: une ville également évoquée avec le paysage vivant de la porte en verre donnant sur la Via del Monte), comme une stratification, comme une mesure de la durabilité. L’exposition commence par les conséquences extrêmes représentées par les visions dystopiques du groupe Superstudio, le studio d’architecture fondé en 1966 à Florence par Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Gianpiero Frassinelli, Roberto et Alessandro Magris, et Alessandro Poli: l’exposition présente quelques œuvres, dont la première des Douze cités idéales, une conséquence extrême de la modernité et du contrôle exercé sur les masses. Un paysage naturel apparaît enfermé dans une grille qui se perd au-delà de l’horizon: c’est la cité idéale où chaque cellule correspond à une unité qui garantit à ses habitants tout ce dont ils ont besoin pour atteindre une vie parfaite et éternelle (mais qui ne tolère pas la dissidence: ceux qui se rebellent contre la vie dans la cité idéale sont écrasés par le plafond de la cellule qui s’abaisse jusqu’au sol). Avec leurs tables, chacune accompagnée d’une description écrite sous une forme presque narrative, Superstudio présente à l’observateur, écrit Claudio Musso, “une altération qui va de la conception du territoire aux dynamiques sociales”. Presque tous les artistes présents dans la salle parlent d’altération, à commencer par Margherita Moscardini (Donoratico, 1981), qui situe plutôt sa dystopie sophistiquée dans l’histoire, en exhumant ses vestiges (comme dans la Maquette A, un ensemble composé d’asphalte, d’un vestige de marbre, de poussière et de verre), comme pour dire que pour le paysage, une fois qu’il a subi une modification, il n’y a pas de possibilité de revenir à ses origines. À tel point que le paysage lui-même est marqué de manière indélébile, comme c’est le cas dans The Mountains’ Factory, une vidéo que l’artiste toscane présente pour la première fois à l’occasion de l’exposition de Bologne.
Le choc (ou la rencontre) entre la nature et la ville est très présent dans l’œuvre d’Andrea De Stefani (Arzignano, 1982), qui ramasse des troncs d’arbre sur la plage en tant qu’objets trouvés et leur donne une nouvelle signification en les recouvrant de peinture pour carrosserie et en les plaçant sur un lit d’asphalte: le résultat est un effet bizarre d’éloignement qui, dans une certaine mesure, rappelle la grande sculpture baroque. Le travail d’Andreco (Rome, 1978), artiste et chercheur en ingénierie environnementale dont les expériences visent principalement à étudier les conséquences de l’interaction entre le paysage et l’espace urbain, vise également à réfléchir aux thèmes de la transformation du paysage et de la relation entre l’homme et la nature. Parade for the landscape, une performance bien connue qui s’est tenue en juin 2014 à Santa Maria di Leuca (c’est-à-dire dans la bande de terre la plus orientale d’Italie, la Finis Terrae de la péninsule) a vu un groupe de figurants, citoyens des communautés locales, se déplacer masqués le long d’un parcours de trois kilomètres le long de la côte en portant des drapeaux avec des symboles faisant clairement référence au paysage. Des frontières naturelles pour réfléchir aux frontières et aux limites humaines (y compris politiques), des drapeaux avec des représentations schématiques d’éléments naturels qui, comme l’écrit le sémiologue Massimo Leone dans son essai de catalogue, évoquent “l’impact que l’évolution et l’imposition de la technologie, en l’occurrence celle de la représentation numérique, exercent sur la perception de la familiarité du paysage”. La salle est fermée par les œuvres de Riccardo Benassi (Crémone, 1982), qui entretient un dialogue direct avec Superstudio, non seulement parce que son Autoroute verticale a été conçue en collaboration avec eux, mais aussi parce que les poèmes de Così per dire tentent une analyse sociologique du paysage traduite en vers (ou quelque chose de similaire) qui courent sur des feuilles à côté d’images de paysages construits par l’homme.
 |
| Superstudio, The First City, extrait de The Twelve Ideal Cities (1971 ; lithographie, 100 x 70 cm). Avec l’autorisation de Superstudio Archive |
 |
| Margherita Moscardini, Maquette (2013 ; asphalte, découverte de marbre, poussière de marbre, verre, dimensions environnementales). Courtesy Collezione Anna e Francesco Tampieri, Modena - Collection of Collections CoC |
 |
| Andrea De Stefani, Smash-Up (Rino’s flowerbed) (2017 ; bois peint, verre, asphalte, acier, 220 x 130 x 65 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
 |
| Riccardo Benassi, Vertical Highway, Study for Scale, Scale 1:2 (2009 ; impression laser Hp sur papier photo mat Hp 180 gm, cadre en chêne, 50 x 70 cm). Avec l’autorisation de l’artiste et de Collezione Marco Ghigi, Bologne. |
 |
| Riccardo Benassi, Così per dire (park) (2016 ; impression sur papier photographique Metal Kodak, impression laser sur passe-partout, cadre en chêne, 32,7 x 42,5 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
Pour la troisième et dernière salle, le leitmotiv pourrait être le paysage tant attendu, le paysage rêvé, et l’ouverture est confiée à un voyage, celui de Pianura uno pianura due de Mario Schifano (Homs, 1934 - Rome, 1998): une théorie de couleurs acides en mouvement apparaît derrière une silhouette qui suggère l’idée d’une fenêtre, presque comme si Schifano voulait y placer une voiture ou un train en mouvement et entendait nous faire admirer la vue qui s’écoule sous nos yeux. Le paysage comme voyage (plus attendu et recherché que réalisé) est également le thème des Vacances imaginaires de Luca Coclite (Gagliano del Capo, 1981), où les “vacances imaginaires” sont celles que les baby-boomers ont été contraints de passer dans des colonies de vacances, aujourd’hui presque complètement disparues (l’œuvre de Coclite est une installation, les lettres qui composent les mots Vacances imaginaires, placées devant l’ancienne Colonia Scarciglia à Castrignano del Capo, Salento): certes, rien de particulièrement original, mais évocateur tout de même), ainsi que l’intéressant projet 32 days at Rupert, œuvre de Marco Strappato (Porto San Giorgio, 1982) qui, en 2017, a passé du temps à Vilnius, en Lituanie, en rêvant de paysages exotiques. Il en résulte trente-deux dessins au feutre sur carton, au trait presque caricatural, qui, avec une certaine nostalgie, muent les froides forêts de la Baltique en palmiers et plages exotiques pour rappeler, du moins dans les intentions de l’artiste, le topos de l’évasion de la réalité typique des sous-cultures de la jeunesse anglo-saxonne contemporaine (le palmier est d’ailleurs l’un des symboles de la vaporwave). Le cercle est fermé par les dix-huit noix de coco créées avec Giovanni Oberti (Bergame, 1982) et exposées juste en dessous de 32 days at Rupert.
Les œuvres de Mauro Ceolin (Milan, 1963) font appel à l’imagination pour nous transporter dans des atmosphères de jeux vidéo avec des paysages de jeux vidéo reproduits à l’aquarelle ou avec des peintures acryliques en plein air, comme si l’écran de l’ordinateur était pour nous ce que la fenêtre était pour les romantiques, et comme si les panoramas de Ceolin donnaient vie à une sorte de Sehnsucht numérique. À côté, les paysages de Laura Pugno (Rome, 1970), qui étale du polyuréthane sur des photographies de cartes postales pour nous empêcher de les voir (et peut-être nous faire désirer encore plus ce paysage?), tandis qu’au centre de la salle se trouvent les œuvres de David Casini (Montevarchi, 1973), qui peint des paysages sur des supports inhabituels (comme les films protecteurs des smartphones) pour les faire devenir les protagonistes d’une histoire qui implique également les objets dont ses œuvres sont composées, à mi-chemin entre la peinture, la sculpture et l’installation. L’exposition s’achève avec les sculptures minimalistes de Martino Genchi (Milan, 1982) qui, dans Mindset, place un élément en plâtre au-dessus d’un plan en aluminium simulant un horizon, et une cale en bois en dessous: “deux couches de matière comme émanations du céleste et du terrestre” (Claudio Musso), créant une nouvelle image d’un paysage avec deux de ses éléments les plus fondamentaux, le ciel et la terre.
 |
| Mario Schifano, Pianura uno Pianura due (1971 ; émail sur toile, 140 x 240 cm). Courtesy Galleria de’ Foscherari, Bologne |
 |
| Luca Coclite, Vacances imaginaires (2018 ; plexiglas, 257 x 14 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
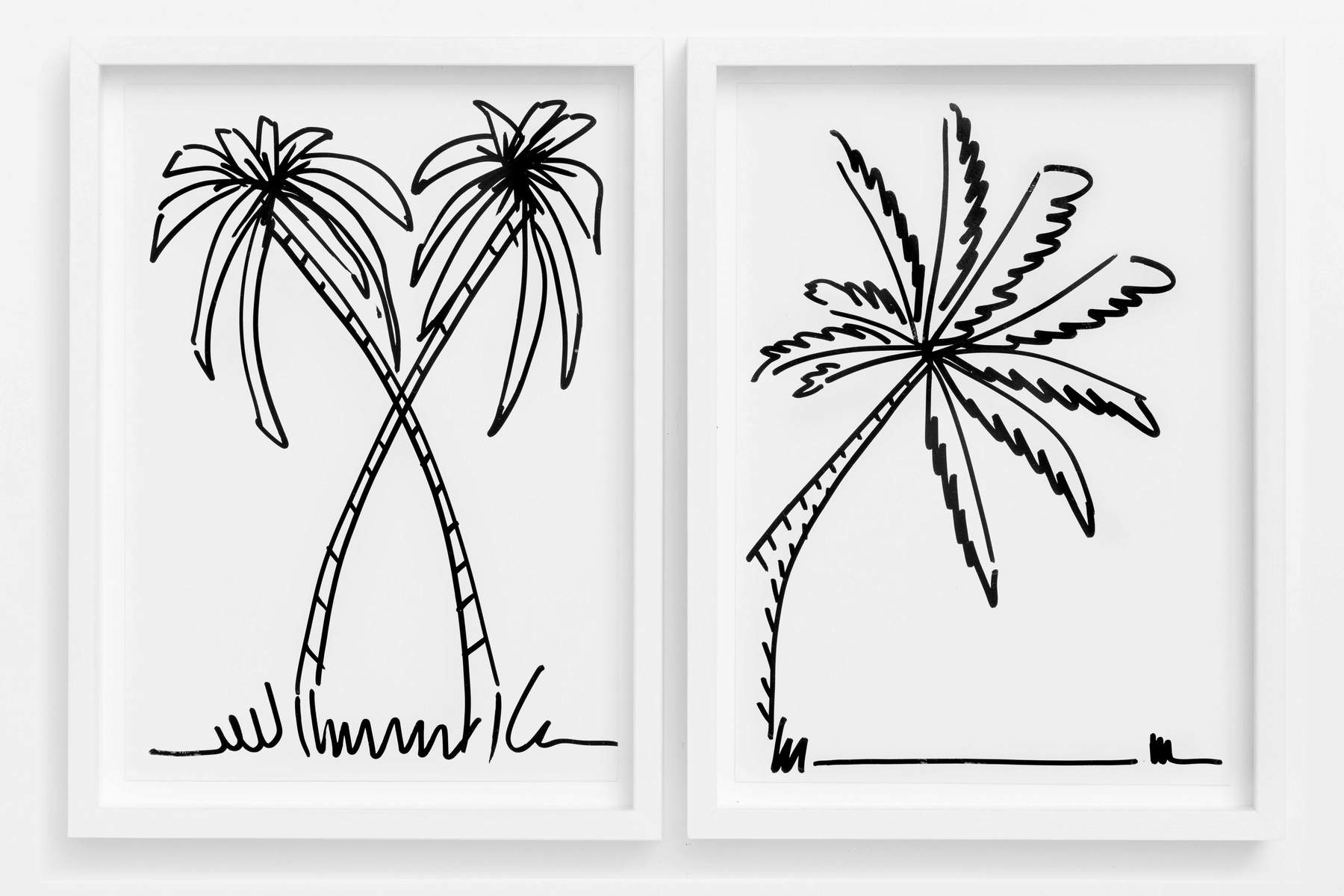 |
| Marco Strappato, 32 jours chez Rupert, Vilnius. Looking into the wood, dreaming palm trees (2017/2018 ; 32 dessins encadrés, marqueur acrylique sur carton, 210 x 140 cm environ). Avec l’autorisation de l’artiste et de The Gallery Apart, Rome. |
 |
| Giovanni Oberti et Marco Strappato, Trois demi-douzaines (2018 ; noix de coco, graphite, poudre, dimensions environnementales). Collection privée, avec l’autorisation des artistes |
 |
| Mauro Ceolin, DeerHuntLandscapes (2005/2006 ; acrylique sur plexiglas, 45 x 37 x 3 cm, 12 plaques). Avec l’autorisation de la collection privée, Monza |
 |
| Laura Pugno, Dominante Recessivo 01 (2017 ; tirage photographique et polyuréthane, 61 x 46 x 16 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
 |
| David Casini, Free Space (2018 ; verre, bois incrusté, laiton, résine, verre trempé, impression numérique UV, 45 x 26 x 26 cm). Avec l’aimable autorisation de CAR drde Gallery, Bologne |
 |
| Martino Genchi, Mindset (2018 ; aluminium, acier, plâtre, acrylique, bois de chêne, 13,5 x 27 x 12 cm). Avec l’autorisation de l’artiste |
L’un des aspects les plus significatifs de Panorama. Atterrissages et dérives du paysage en Italie (qui, comme nous l’avons vu, hormis les noms d’artistes historicisés présente exclusivement des œuvres d’artistes nés entre les années 1960 et 1980: Il s’agit d’un choix curatorial précis, puisque l’accent est mis sur des noms qui appartiennent à la première génération née à l’ère des sociétés de masse et qui ont donc été immédiatement immergés dans leurs médias et leurs langages, jusqu’à ceux qui ont grandi et se sont formés à l’aube de l’ère Internet, tout cela dans le but de faire ressortir les différentes conceptions du paysage) est la capacité d’élargir le spectre de l’enquête pour inclure des réflexions qui ont trait à la politique, à la société et, en même temps, aux pulsions de l’individu. L’expression “nature architecturale”, utilisée par Argan pour souligner une certaine caractéristique de l’art de Juvarra, a été citée au début, et il est intéressant de souligner comment le binôme nature-architecture est l’un des piliers sur lesquels repose l’exposition bolonaise, et ouvre à son tour des parenthèses importantes sur les débats les plus actuels concernant le développement urbain, l’aménagement du paysage, la relation entre les habitants et le territoire, l’utilisation et la fonction de l’espace public.
On peut sans aucun doute affirmer que Panorama. Approches et dérives du paysage en Italie est une exposition courageuse, non seulement parce que le simple fait de monter une exposition collective d’art contemporain est en soi une opération audacieuse et téméraire, mais aussi pour plusieurs autres raisons pour la volonté de se mesurer à une exposition qui a marqué l’histoire de la peinture contemporaine de paysage en Italie (en réussissant à rappeler et à poursuivre sa recherche), pour le caractère politique (au sens le plus élevé et le plus noble du terme) qui l’anime en partie, pour avoir tenté de placer les œuvres des peintres, sculpteurs, photographes et performers contemporains sélectionnés dans une perspective historique imprévue, pour avoir tenté (et réussi) un équilibre entre les langages utilisés par les artistes de l’exposition. Enfin, mentionnons le catalogue qui, bien que beaucoup plus agile que celui de l’exposition des années 1980, a le mérite de fournir au lecteur des images d’œuvres qui ne font pas partie de l’exposition afin d’offrir une perspective plus large sur les artistes sélectionnés (même si une plus grande clarté aurait peut-être été souhaitable dans la présentation des œuvres qui font partie de l’exposition et de celles qui n’en font pas partie, mais cela est peut-être dû au fait que le volume ne se veut pas seulement un catalogue, mais plus généralement une publication sur la peinture de paysage en Italie aujourd’hui) et une bibliographie annotée étendue.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils
automatiques.
Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au
programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.