Si la Biennale de Venise devient un safari photo entre marginaux. Les limites de l'exposition de Pedrosa
Cinquante ans exactement se sont écoulés depuis qu’un “Comité d’initiative pour la peinture naïve à la Biennale de Venise” a écrit une lettre passionnée à Carlo Ripa di Meana, qui venait d’être nommé président de la Biennale récemment réformée, demandant à l’institution une pleine reconnaissance du mouvement naïf, qui serait peut-être sanctionnée par la présence dans l’exposition d’une exposition “naïve” consacrée à ceux qui avaient été ostracisés par la plupart des critiques pendant des années, exclus des cercles nobles, souvent même moqués, mais qui étaient néanmoins capables d’imprégner le monde.une exposition consacrée à ces “naïfs” qui, pendant des années, ont été ostracisés par la plupart des critiques, exclus des cercles nobles, souvent même moqués, mais qui ont néanmoins pu faire rage sur le marché, incarnant avec une vivacité solaire l’hypothèse selon laquelle l’histoire de l’art et l’histoire du goût voyagent souvent sur des routes éloignées. Nous sommes au printemps 1974 : “Nous sommes sûrs, écrit le comité à l’adresse de Ripa di Meana et du conseil d’administration, que l’importance du phénomène historique de la ”nouvelle imagination“ n’aura échappé à aucun d’entre vous” : la croissance d’un mouvement, défini comme art naïf, qui est quantitativement et qualitativement un fait nouveau dans le développement de la sensibilité de masses de plus en plus grandes, les soi-disant énergies émergentes de notre temps. Il ne s’agit plus d’éclairs d’imagination extra-académique ou primitive ou populaire [...]. Il s’agit d’un mouvement qui ne s’arrêtera plus et qui grandira, même dans les conditions difficiles actuelles de la culture des peuples et dans les rapports compliqués avec les arts et la conscience esthétique des masses. C’est en raison de cette conscience précise et ferme que nous vous demandons de reconnaître concrètement à la nouvelle peinture naïve le statut culturel à part entière, la dignité professionnelle et le respect artistique qui lui sont dus, contre toute conception élitiste ou subalterne de la culture". Les signataires de cette lettre étaient loin d’imaginer qu’à l’occasion d’un anniversaire rond, en 2024, des légions d’artistes folkloriques et brutaux de toute la planète seraient enfin exposés à l’exposition la plus importante du monde et que l’admission institutionnelle tant convoitée de l’art “marginalisé” serait enfin arrivée, bien que le conservateur de l’exposition n’ait pas été en mesure de le faire. serait enfin arrivée, bien que le commissaire de la 60e édition de la Biennale, Adriano Pedrosa, ait du mal à l’imaginer comme une reconnaissance, et préfère penser, bien que de manière quelque peu implicite, que la convocation hypertrophique d’artistes indigènes, queer et outsiders à sa Biennale est, au mieux, la conséquence paisible d’une sorte de cours naturel de l’histoire de l’art.
D’une certaine manière, Pedrosa a raison lorsque, dans son entretien avec Julieta González publié dans le catalogue, il affirme qu’il est assez facile pour un visiteur européen ou américain de reconnaître les artistes contemporains de ce qu’il appelle le “Global South”, puisque “depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, les artistes contemporains de notre partie du monde ont acquis une plus grande visibilité : si ce n’est pas tous, du moins certains d’entre eux voyagent et exposent dans des musées, des galeries et des biennales”. En Italie, nous le ressentons peut-être moins car nos musées d’art contemporain suivent le plus souvent d’autres orientations, mais il suffit de visiter les principales foires pour se rendre compte des tonnes d’art africain, asiatique et latino-américain proposées par tant de galeristes qui, forcément, interceptent un goût et un intérêt qui depuis au moins deux décennies, et avec une constance croissante, suscitent l’appétit des collectionneurs du bout du monde, et en ce sens les Italiens ne sont pas une exception. Foreigners everywhere - Foreigners everywhere, l’exposition internationale de la Biennale 2024, ne révèle donc aucune nouveauté substantielle digne d’intérêt (même les essais qui composent le catalogue, à l’exception de la seule contribution inédite de Claire Fontaine, constituent un recueil d’articles publiés entre 1998 et 2023) : doit, au contraire, être lue, d’une part, comme un moment de consécration officielle pour des artistes présents sur le marché depuis des années, même avec des cotations résolument élevées, et d’autre part, comme un moyen d’amplifier des discussions déjà engagées depuis un certain temps, comme un moyen de livrer aux visiteurs de la Biennale des artistes que d’autres institutions, au cours des années précédentes, avaient portés à la connaissance du public européen et américain. À l’Arsenale, le parcours s’ouvre sur Claire Fontaine et Yinka Shonibare, des artistes bien connus de ceux qui fréquentent l’art contemporain.L’Arsenale est une exposition d’art contemporain, représentée par deux galeries de premier plan (respectivement la parisienne Mennour et la new-yorkaise Goodman), mais le discours pourrait être étendu à une partie résolument consistante, peut-être même à la majorité, des artistes vivants de l’exposition, bien présents sur un marché dominé par le cash blanc et eurocentrique, qu’il s’agisse d’artistes autodidactes ou populaires ou, au contraire, d’artistes ayant une formation traditionnelle, formelle et académique : Frieda Toranzo Jaeger (représentée par la Barbara Weiss Gallery), Emmi Whitehorse (Garth Greenan), Greta Schödl (Labs Gallery), Julia Isídrez (Gomide&Co), Dana Awartani (Lisson), etc. Même l’aborigène Naminapu Maymuru-White, “grand old yolnu” comme elle nous est présentée par les légendes de l’exposition, a confié la garde de ses intérêts à l’une des principales galeries de toute la région Asie-Pacifique (l’australienne Sullivan+Strumpf, qui fait partie des habitués d ’Art Basel).
La même hypothèse s’applique, bien sûr, à la section installée dans le pavillon central des Giardini, où l’on trouve, entre autres, Louis Fratino, l’un des artistes actuellement les plus gonflés par le marché (inséré dans un dialogue curieux et bizarre avec Filippo de Pisis, sur la base de leur homosexualité commune, du moins à en croire les légendes), ou la native Kay Walkingstick qui n’a eu qu’une seule exposition avec sa galerie lors de la dernière édition d’Art Basel Miami, ou encore l’Australienne Sullivan+Strumpf, qui compte parmi les habitués d’Art Basel.La plupart des artistes non vivants (qui constituent un tiers des noms de cette Biennale) ont de toute façon déjà été montrés dans des expositions majeures, du MoMA de New York à la Tate de Londres en passant par de nombreux grands musées internationaux d’art contemporain. Et si l’on imagine un Pedrosa parcourant la forêt amazonienne à la recherche des œuvres des chamans Yanomami pour révéler au public européen des images inédites sous nos latitudes, on sera déçu : les œuvres d’André Taniki et de Joseca Mokahesi parcourent les musées de notre continent depuis au moins vingt ans, la Fondation Cartier ayant ouvert la voie en 2003 avec l’exposition Yanomami. L’esprit de la forêt.




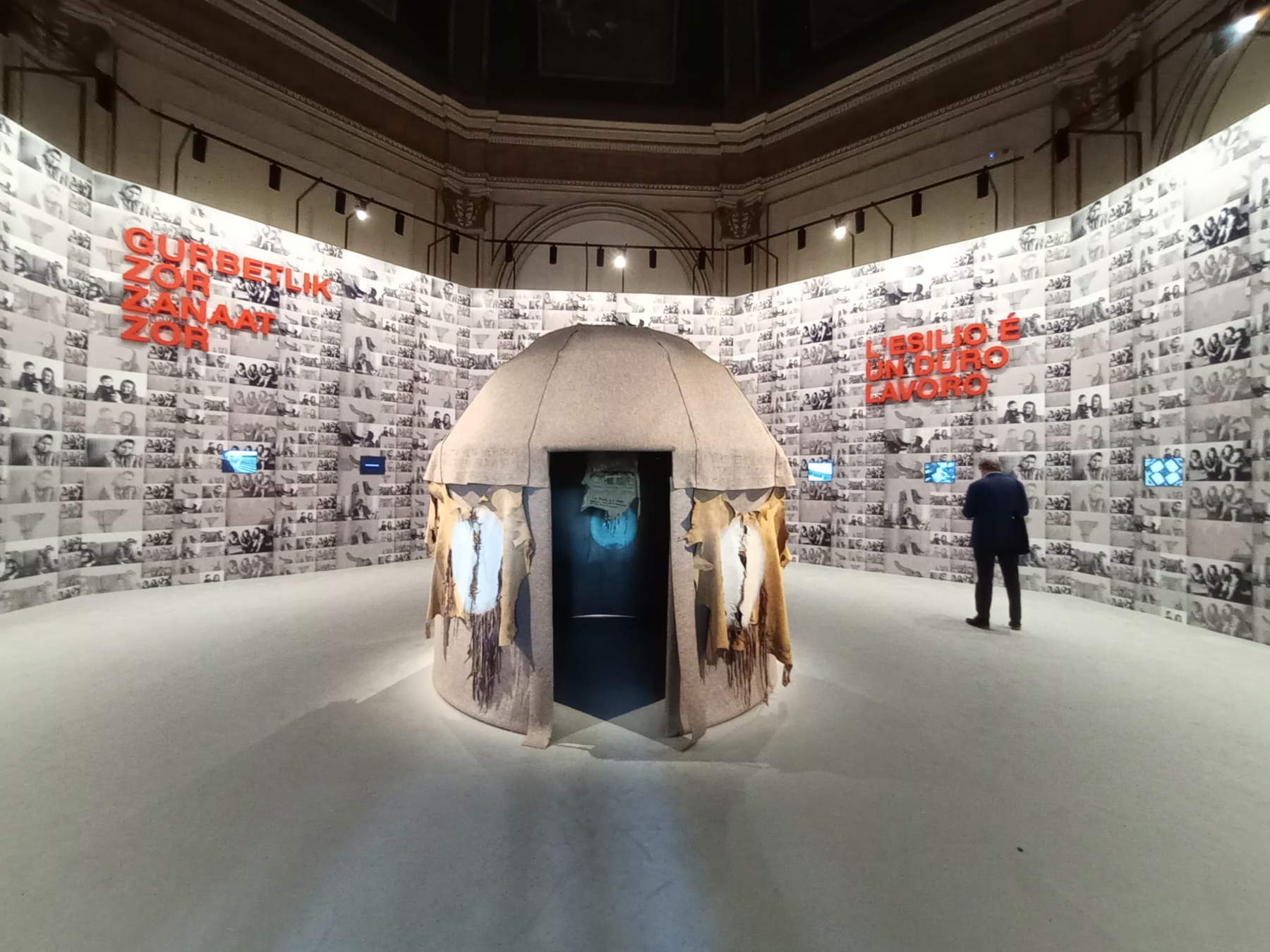

La première conséquence est donc une sorte de retour du colonialisme qui avait déjà enveloppé l’atmosphère de la dernière édition de l’exposition internationale, Il latte dei sogni (Le lait des rêves ) de Cecilia Alemani, et qui, cependant, devient un thème incontournable dans une édition, l’actuelle, qui entend placer le thème de la décolonisation au centre de l’attention. Seul Ticio Escobar, dans son essai publié dans le catalogue, n’hésite pas à aborder le sujet en soulignant que les artistes “populaires” ont “le droit d’utiliser tous les canaux et institutions (avec lesquels la culture dominante s’interrompt et interfère) et de s’en servir comme refuges, tranchées ou même comme pistes d’atterrissage pour des vols potentiels”.Il est donc impossible, de ce point de vue, de critiquer la décision de recourir au marché et de lutter pour des prix plus justes et une plus grande reconnaissance de la créativité populaire“. Ce constat est plus que juste, mais il ouvre une série de questions non moins importantes : un artiste qui est mis sous contrat par l’une des galeries les plus puissantes du monde et qui introduit ses œuvres dans les contextes les plus institutionnels de l’univers de l’art contemporain peut-il vraiment être considéré comme ”exclu" ? Dans quelle mesure le récit sur lequel cette biennale a été mise en place peut-il tenir la route ? Dans quelle mesure peut-on considérer comme inconscient l’art d’un chaman qui a passé ces dernières années à voyager entre Paris, Londres et Shanghai ? Ne risque-t-on pas d’exploiter cette créativité populaire à l’inverse de l’effet recherché ? Le chaman a évidemment le droit de recourir aux marchés européens et nord-américains pour obtenir une reconnaissance économique, culturelle et sociale (le rêve de beaucoup d’outsiders est justement la reconnaissance officielle), mais en même temps, le public a lui aussi le droit de s’interroger sur les effets de l’opération, de se poser des questions sur la spontanéité d’un artiste qui se mesure depuis des années au marché occidental, sur son réel degré d’exclusion, sur la véritable raison de sa présence : Est-il ici parce que nous sommes réellement intéressés par ce qu’il a à dire et peut-être même par les conditions de sa communauté, ou est-il ici parce que nous l’exposons comme une curiosité que nous oublierons plus tard lorsque nous serons fatigués d’admirer l’habileté de ses mains qui n’ont jamais touché aux outils modernes occidentaux ? Déjà à l’époque de l’explosion des naïfs, Giancarlo Marmori, dans un de ses articles mémorables, observait qu’“un naïf, une fois découvert, ne peut ignorer longtemps qu’il l’est”, et qu’“aujourd’hui, un naïf a peu de chances de mener une vie clandestine, authentique et sereine” : c’était vrai au milieu des années 1970, lorsque Marmori a écrit son article dans L’Espresso, c’est encore plus vrai aujourd’hui, dans le monde post-mondialisation, à l’ère de l’internet et des médias sociaux, et avec le publicdu monde de l’art habitué à voyager, une semaine à Venise, la suivante à New York, la suivante à Séoul.
Certes, plusieurs des artistes ou projets choisis par Pedrosa pour son exposition (qui, contrairement à l’édition précédente de l’exposition internationale, se distingue par une plus grande clarté, une mise en page plus nette et une fraîcheur plus immédiate) sont capables de surprendre le public, surtout s’il ne les connaissait pas : On est alors véritablement impressionné par la puissance visionnaire de Santiago Yahuarcani, peintre autodidacte de la nation Uitoto, qui, avec ses œuvres au milieu des forêts enchevêtrées, des esprits tutélaires et des animaux de son Amazonie, rappelle les jugements universels de nos églises des XIIIe et XIVe siècles. Nous sommes émus par les histoires de chauffeurs de motos-taxis nigérians racontées dans une vidéo candide de Karimah Ashadu. Touchants sont les textiles de l’artiste turque Günes Terkol, dont les tissus transfigurent l’actualité en une histoire qui semble presque dépourvue de toute dimension temporelle réelle, donnant vie à des polyphonies de voix féminines avec lesquelles nous sommes immédiatement en empathie. Les photographies soignées de l’Angolais Kiluanji Kia Henda parviennent à communiquer efficacement et poétiquement ce qu’est le privilège, ce qu’est la fracture sociale. On est captivé pendant quelques instants par les sculptures en céramique dorées et scintillantes de Victor Fotso Nyie, un jeune Camerounais qui vit et travaille à Faenza depuis un certain temps. On peut se réjouir de la reconnaissance que cette édition de la Biennale a accordée à Nedda Guidi, une importante céramiste qui a longtemps été marginalisée et qui figure pourtant dans l’exposition non pas tant pour son rôle de pionnière dans la voie de l’ennoblissement de la céramique qui a traversé l’art de la seconde moitié du XXe siècle, mais plutôt parce qu’elle est une "femme queer, une féministe convaincue". Là encore, on peut goûter à l’acuité de projets tels que Disobedience Archive de Marco Scotini ou Museum of the Old Colony de Pablo Delano. Outre ces points et quelques autres, le commentaire que Jonathan Jones, le célèbre critique du Guardian, écrivait il y a huit ans à propos de l’exposition de l’artiste indien Bhupen Khakhar (présent dans cette édition de la Biennale) à la Tate de Londres s’applique à la Biennale de Pedrosa : "pourquoi la Tate Modern expose-t-elle un artiste démodé, de second ordre, dont l’art rappelle le genre de peintres britanniques qu’elle ne laisserait jamais franchir ses portes ?










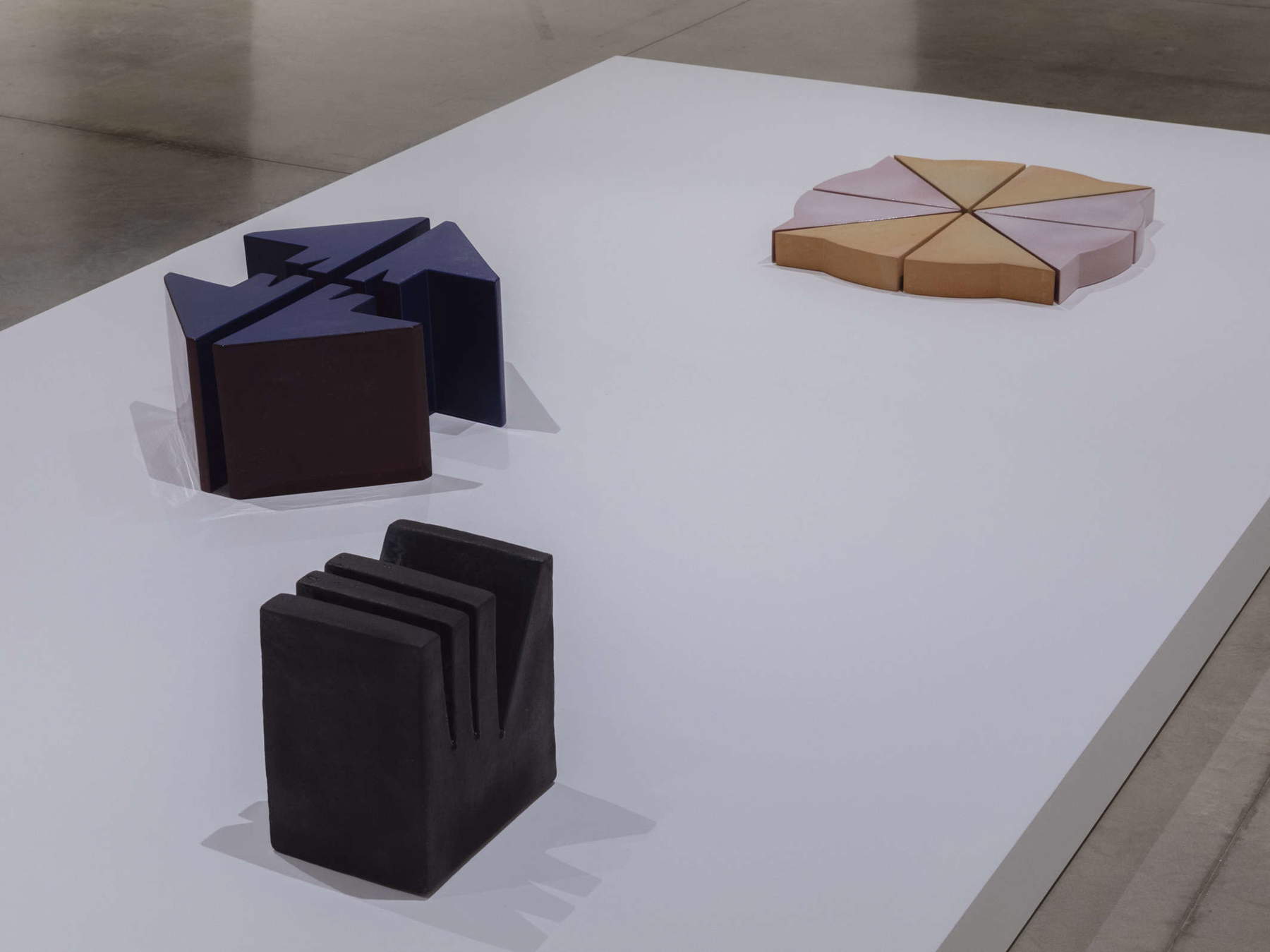

On pourrait poser la même question à Adriano Pedrosa, étant donné la grande quantité d’art outsider, folklorique et naïf dans sa biennale : quelle différence y a-t-il entre un artiste autodidacte né et élevé dans la forêt amazonienne et, disons, l’un des nombreux peintres paysans de l’Émilie d’après-guerre qui n’est jamais entré dans un musée ou n’a jamais pris un livre d’histoire de l’art en main ? Quelle est la différence entre un indigène Diné et un berger des Apennins qui, citant Soffici, n’a jamais vu la moustache d’un professeur ? Quelles sont les caractéristiques de nos Ghizzardi, de nos Zinelli, de nos Bolognesi qui ne correspondent pas à la définition de l’outsider comme "un artiste qui se trouve en marge du monde de l’art, tout comme l’autodidacte, l’artiste folklorique ou l’artiste populaire" donnée par Pedrosa dans le catalogue de son exposition ? Quelle déception pour le comité d’il y a cinquante ans : marginalisé à la Biennale, oui, mais seulement s’il est exotique. La seule justification de l’exclusion des outsiders européens ou nord-américains (le seul présent dans l’exposition, on ne sait trop pourquoi, est l’Autrichien Leopold Strobl), au-delà Outre le fait qu’un Italien, un Français ou un Espagnol finirait par diluer notre mea culpa pour les siècles de colonialisme auxquels nous avons soumis le reste du monde, c’est probablement le poids spécifique que l’art irrégulier, l’art populaire ont dans l’économie de l’art des autres continents.
Partant de cette hypothèse, il nous appartient de nous demander si c’est la manière la plus sérieuse et la plus correcte d’inclure la Biennale de Venise dans les processus de décolonisation culturelle en cours. En d’autres termes : est-il vraiment utile d’amener à Venise une agglomération monolithique d’exclus, d’indigènes et de personnes queer, en coupant dogmatiquement tout le reste, à quelques exceptions près ? Probablement pas, pour plusieurs raisons. En attendant, même avec toutes les excellentes intentions qui animent certainement la direction artistique de cette Biennale, elle finit par alimenter, bien qu’inconsciemment, une dynamique de confrontation qui n’est même pas dans l’intérêt des exclus que l’exposition entend ramener au centre (en se souvenant d’Errico Malatesta : “les masses opprimées [...] ne pourront s’émanciper que par l’union, la solidarité avec tous les opprimés, avec tous les exploités du monde entier”). Une dynamique qui, vécue dans d’autres domaines et à d’autres niveaux (car, comme on le sait, les arts visuels ne comptent plus pour grand-chose) entraîne nécessairement, et on le voit dans la réalité des faits, le renforcement des affabulations populistes, nationalistes, réactionnaires qui ne cessent de secouer le “Nord du monde”, pour reprendre la terminologie chère au commissaire de cette Biennale. Difficile d’ailleurs de ne pas entrevoir une logique d’opposition quand on comprend l’histoire de l’art non pas comme un processus historique qui a toujours eu et aura toujours des ramifications régionales et locales, mais plutôt comme une sorte de règlement de compte avec le passé, comme une revanche, comme une atteinte à une règle. De plus, elle n’est pas utile parce qu’elle risque de transformer la Biennale non pas en la section transversale du monde contemporain qu’elle devrait être, avec peut-être la prétention d’identifier une direction future, mais en une sorte de monde cinématographique divisé en salles, en un compendium des productions folkloriques et artisanales de ce que nous aurions autrefois appelé le “tiers monde”, dans le format d’exposition équivalent à un safari photographique. C’est ce qu’a implicitement confirmé le grand farrago gauche caviar de la maison qui, lors des journées d’avant-première, se laissait déjà aller à l’exposition colorée offrant un condensé des milliers de merveilleuses techniques artisanales du Sud. Ne risque-t-on pas de creuser un fossé supplémentaire entre l’Occident et le reste du monde ? Créer une vitrine à Venise où l’on expose une suite de batiks, de tissus andins et de dessins de chamans séparés du reste, n’est-ce pas exposer ces artistes au risque d’alimenter les stéréotypes à leur égard ? Ou de rendre encore plus évidente cette marginalité que l’on voudrait annuler ? L’attitude qui anime Foreigners Everywhere ne risque-t-elle pas de ressembler à celle des ethnologues qui ont installé leurs cabinets de curiosité il y a des siècles ? Et d’ailleurs, ne pourrait-on pas enfin se débarrasser de l’idée qu’un artiste fluide doit toujours être perçu comme “étrange” ?
Les limites de la Biennale de Pedrosa ressortent également des trois “Noyaux historiques”, trois petites revues de l’histoire de l’art du XXe siècle, plus embarrassantes les unes que les autres, conçues avec tous les défauts du Noyau contemporain. Le premier Nucleus historique que l’on rencontre (si l’on veut commencer la visite à partir de l’Arsenale), Italiani ovunque, nous citons le catalogue, “rassemble des œuvres d’artistes italiens qui ont voyagé et vécu à l’étranger, développant leur carrière en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu’aux États-Unis et en Europe”, “des immigrés italiens de la première et de la deuxième génération qui sont devenus à leur tour des étrangers dans le sud du monde et au-delà au cours du 20e siècle”. Les critères de sélection ne sont pas bien compris, car outre les artistes qui ont effectivement quitté l’Italie pour s’installer définitivement ailleurs, il y a aussi ceux qui, comme Galileo Chini, sont restés en Thaïlande juste le temps d’achever une œuvre. En effet, outre les artistes qui ont effectivement quitté l’Italie pour s’installer définitivement ailleurs, il y a aussi ceux qui, comme Galileo Chini, sont restés en Thaïlande juste le temps d’achever une œuvre (il est curieux de constater que la seule œuvre in situ de Chini, les fresques décorant la coupole du Pavillon central des Giardini, a été laissée dans l’obscurité) : pas même un minimum de respect pour l’un des artistes sélectionnés). Mais au-delà des raisons de la sélection, le Nucleus n’est qu’une sorte d’album d’autocollants qui occupe une salle entière, un essaim informe d’artistes sans lien entre eux, un pêle-mêle indistinct qui rassemble des expériences souvent profondément différentes, et pas même le beaumême pas le beau décor (le cavalete de cristal, les vitrines transparentes conçues pour Lina Bo Bardi en 1968 pour le MASP de São Paulo, le musée aujourd’hui dirigé par Pedrosa) ne parvient pas à relever le résultat d’une très mauvaise exposition.
Ce n’est pas mieux avec les deux Noyaux historiques des Giardini, celui consacré à l’abstraction et celui sur les portraits, tous deux animés par le souci d’observer les déclinaisons des mouvements du début du XXe siècle rendues par des artistes qui ont travaillé loin des continents où les avant-gardes ont émergé. Ici aussi, il n’y a pas de cadre historique autre que la volonté de montrer que, dans le sillage de ce qui se produisait au début du XXe siècle dans les centres moteurs d’Europe et d’Amérique du Nord, dans le reste du monde, certains ont apporté leur propre contribution et ont développé localement les suggestions provenant d’autres centres. C’est ce qui s’est toujours passé dans l’histoire de l’art : la Renaissance est née à Florence, mais il y a eu une Renaissance lombarde, une Renaissance d’Urbino, une Renaissance ligure et ainsi de suite, chacune avec son propre tempérament et son propre caractère original. Cependant, aucun historien de l’art sérieux ne songerait à organiser une exposition dans une seule salle où seraient dispersés un Boltraffio, un Fra’ Carnevale, un Ludovico Brea et ainsi de suite, sans fournir au visiteur une sorte d’orientation, au-delà de quelques notes biographiques sur les artistes exposés. Car telle est la situation devant laquelle le visiteur se trouve en parcourant les deux Noyaux Historiques des Jardins : Un panorama incompréhensible d’artistes africains, latino-américains et asiatiques du début du XXe siècle, juxtaposés sans critères, sans guides (seules de courtes biographies sont présentes), sans subdivisions claires, dans une masse confuse où il n’y a pas de distinction entre des contextes pourtant radicalement différents, où les artistes vraiment originaux, comme Tarsila do Amaral ou Candido Portinari dans la section des portraits, se noient parmi des peintres de second et troisième ordre, avec le risque que le visiteur finisse par les perdre. Les Noyaux historiques sont donc aussi une occasion manquée.




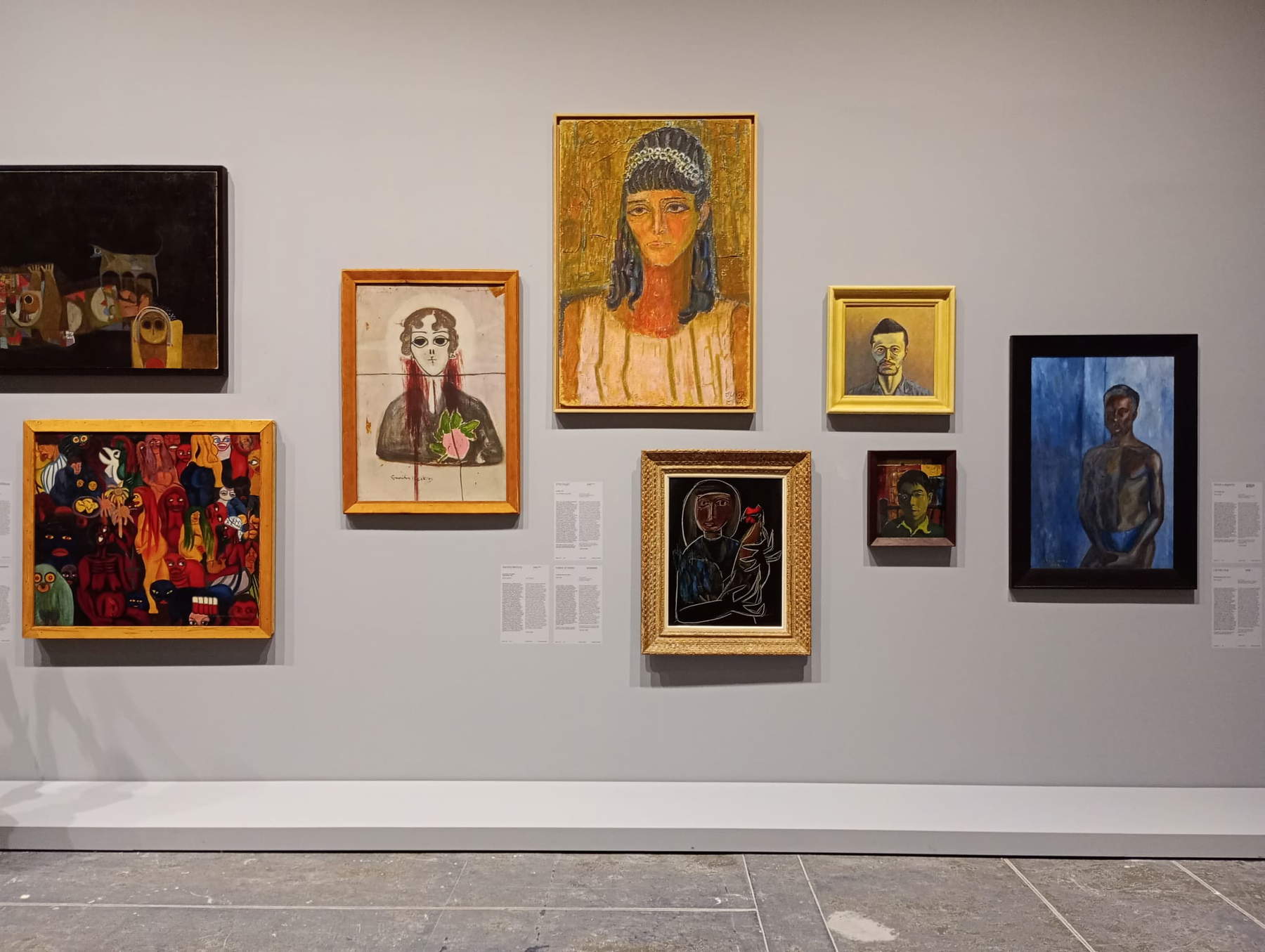
Cela peut sembler paradoxal, mais il y avait un air plus frais à la Biennale organisée par Ralph Rugoff, dont on ne se souvient peut-être pas comme d’une des meilleures éditions de l’histoire, mais c’était la dernière où la direction a réuni des artistes du “Nord” et du “Sud” sans ghettoïsation et sans reddition. et du “Sud” sans ghettoïsation et sans logique d’épreuve de force, mettant sur le même plan les productions artistiques de l’Occident et celles du reste du globe, avec l’objectif commun d’offrir une vision du monde et d’essayer d’émettre des hypothèses de parcours. Il n’est pas certain que l’hypothèse sur l’avenir soit alors correcte, il n’est pas certain que l’époque ne contredise pas les idées d’un conservateur, mais au moins, dans le passé, les visiteurs se voyaient offrir la possibilité de discuter d’une direction. Aujourd’hui, pour trouver une proposition artistique visionnaire à Venise, il faut sortir de la Biennale et voir la puissante exposition de Pierre Huyghe à la Punta della Dogana, car Stranieri ovunque - Foreigners Everywhere est une exposition inoffensive, affable, axiomatique, peu incisive, au mieux résumante.
Les deux dernières Biennales ont été plus préoccupées par la nécessité de satisfaire un goût, elles se sont engagées dans une recherche d’antithèses, elles ont ajouté à des discussions déjà entamées ailleurs et sans même apporter de contributions particulièrement intéressantes. Au contraire, la Biennale 2024 a probablement sanctionné une régression, puisque l’exposition internationale de cette année impose une idée de décolonisation qui semble presque ignorer toute forme de dialogue. Après tout, c’est Pedrosa lui-même qui, dans son entretien avec Julieta González, affirme que la raison d’être des deux noyaux historiques des Giardini est de “défier le canon occidental”. Et la décolonisation comme défi à l’Occident est d’ailleurs une idée qui, dans l’illusion de résoudre un problème, finit par en créer d’autres : dans le New York Times, Jason Farago a souligné à juste titre les soudures entre ce type de récit et la rhétorique anticoloniale d’un Poutine qui tente de promouvoir sa Russie comme amie des pays africains, tout en essayant d’imposer son propre impérialisme à l’Ukraine, en dehors de l’histoire. Ce n’est donc pas vraiment la décolonisation culturelle dont nous avons besoin.
Existe-t-il cependant une autre possibilité ? Certainement, et on la trouve dans certains pavillons nationaux (même s’il n’y en a pas beaucoup qui dépassent la simple présentation des exclus chez eux) : dans celui de la France, par exemple, où Julien Creuzet indique, avec une œuvre totale empreinte de poésie, que le processus de décolonisation doit être imaginé comme un moment où l’on repense non seulement nos structures politiques, mais aussi notre positionnement dans le monde. La décolonisation, donc, comme une restructuration, plutôt que comme un défi ou un bilan. Sinon, nous pouvons continuer à penser que nous avons fait le nôtre en nous contentant de quelques naïfs exotiques. Le Comité d’il y a cinquante ans s’en serait probablement réjoui.
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.



























