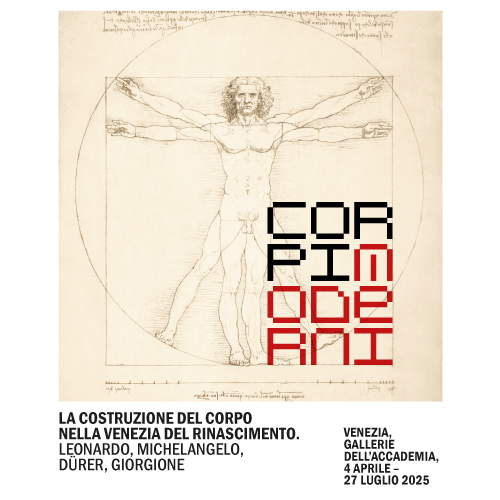Le Mantegna parisien. Les œuvres du Musée Jacquemart-André
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la pratique des échanges en bloc d’œuvres d’art entre musées internationaux n’est pas récente. Au contraire, l’habitude s’est prise récemment de mettre en place des prêts réciproques qui alimentent des expositions totalement inutiles de part et d’autre, et il est assez fréquent qu’au centre demeurent, ça va sans dire, les grands noms, les artistes capables plus que d’autres d’exercer un attrait magnétique sur le public. Prenons l’exemple du Caravage: l’année dernière, dans le cadre d’un accord entre la Galleria Borghese et une célèbre maison de couture, des tableaux du Caravage sont partis pour Los Angeles, et la Californie a rendu la pareille avec un buste du Bernin inclus dans l’exposition sur le génie baroque mise en place par le musée romain. Si les Caravage de la Galleria Borghese étaient restés à Rome et le buste du Bernin à Los Angeles, personne ne l’aurait probablement remarqué, car l’exposition californienne ne reposait pas sur des hypothèses scientifiques pertinentes et la présence de la sculpture de Los Angeles à Rome n’avait pas un poids décisif dans l’économie globale de la monographie du Bernin. La situation est différente en 1982, lorsque le Metropolitan de New York signe un protocole avec le ministère italien des Biens culturels: Trois ans plus tard, des œuvres du Caravage partaient pour les Etats-Unis afin d’animer une importante exposition consacrée au génie lombard(L’âge du Caravage, transporté ensuite à Naples quelques mois plus tard), tandis que l’Italie, en 1983, grâce au même accord de collaboration, avait pu organiser, au Palazzo Venezia, une exposition d’un noyau fondamental de trente-huit œuvres de Jackson Pollock que Lee Krasner avait donné au Metropolitan l’année précédente. Cette année, en revanche, deux œuvres du Caravage ont quitté le Palazzo Barberini pour Paris à l’occasion de l’exposition Caravage à Rome au Musée Jacquemart-André et, en échange, la Galleria Nazionale d’Arte Antica a obtenu six œuvres, dont deux d’Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 - Mantoue, 1506), avec lesquelles elle a monté une petite exposition intitulée La stanza di Mantegna. Chefs-d’œuvre du Musée Jacquemart-André de Paris, sous la direction de Michele Di Monte.
Il faut souligner qu’il s’agit d’une exposition qui n’apporte rien à notre connaissance de Mantegna, mais la direction du Palazzo Barberini a néanmoins agi de manière astucieuse, en donnant à Di Monte l’occasion de concevoir une exposition dont la valeur populaire n’est pas négligeable. Pour deux raisons substantielles, l’une concernant l’histoire de l’art et l’autre l’histoire de la collection. Le fait qu’une exposition sur Mantegna soit organisée à Rome trouve sa raison d’être dans le fait que le grand artiste vénitien a travaillé à Rome entre 1488 et 1490, invité par le pape Innocent VIII de l’époque à travailler sur les fresques de la chapelle de San Giovanni au Palais du Belvédère, comme nous l’apprend Vasari dans ses Vies (“il acquit une telle renommée que le pape Innocent VIII, ayant entendu parler de son excellence en peinture et des autres qualités dont il était merveilleusement pourvu, le fit venir pour qu’après avoir achevé la construction du mur du Belvédère, comme il l’avait fait faire à beaucoup d’autres, il l’orne de ses peintures”). Lorsqu’il se rendit à Rome, il fut très favorisé et recommandé par le marquis, qui le fit chevalier pour l’honorer davantage, et il fut reçu avec amour par le pontife, qui lui confia immédiatement la tâche de construire une petite chapelle, qui se trouve au même endroit. Avec diligence et amour, il y travailla si minutieusement que la voûte et les murs ressemblent plus à des miniatures qu’à des peintures ; et les plus grandes figures sont au-dessus de l’autel, qu’il peignit à fresque comme les autres, et elles représentent saint Jean baptisant le Christ, et autour d’elles des gens qui se déshabillent pour montrer qu’ils veulent être baptisés"). Aujourd’hui, cependant, il ne reste rien de sa production romaine, et bien que les deux œuvres du musée Jacquemart-André soient chronologiquement éloignées de la période qu’il a passée dans la capitale de l’État pontifical (l’une trop tôt, l’autre trop tard), l’exposition permet à un artiste qui a travaillé dans la ville et qui avait une forte passion pour les antiquités romaines de revenir à Rome pendant quelques mois.
En outre, l’exposition se propose de nous faire pénétrer dans les salons privés (d’où le titre) des deux collectionneurs qui ont acheté les œuvres exposées au Palais Barberini, Édouard André (Paris, 1833 - 1894) et son épouse Nélie Jacquemart (Paris, 1841 - 1912), nous offrant ainsi un précieux aperçu du collectionnisme de la fin du XIXe siècle, en nous plongeant dans le goût de l’époque. Conformément à la mode de l’époque, Édouard et Nélie ont également nourri une profonde passion pour l’art italien, en particulier l’art médiéval et de la Renaissance. Une passion si profonde qu’elle les conduisit à aménager un étage de leur résidence parisienne en véritable musée italien organisé en salles (ou... chambres) thématiques. Et dans ces salles, écrit Michele Di Monte dans un livret distribué gratuitement lors de l’exposition (il n’y a pas de catalogue), ce ne sont pas seulement des objets et des œuvres d’art qui ont été collectionnés, mais aussi “un désir d’appropriation qui se dessine, d’autant plus fort que son objet est insaisissable, que cet objet est un fantôme que la passion, la passion de l’amateur, paradoxalement, ne peut contempler qu’à distance”. Le désir inatteignable, c’est la volonté de faire revivre le passé. Un désir commun aux collectionneurs du XIXe siècle et aux artistes de la Renaissance: et comme faire revivre le passé “sans le transformer [...] en autre chose que ce qu’il a été” est une tâche impossible, on finit par l’exposer. Ce qui anime l’art d’Andrea Mantegna est donc un “archéologisme romantique” (Antonio Paolucci), et Mantegna est un artiste profondément visionnaire qui regarde le passé avec un esprit d’archéologue, mais qui sait aussi être un “classique moderne” (Giovanni Agosti), et les points culminants de sa modernité se trouvent dans son attitude envers l’image qui, comme le souligne Di Monte, “interroge toujours ses contemporains” et pousse les artistes vers des réponses précisément modernes. D’où l’originalité de sa recherche spatiale, l’invention d’iconographies jamais osées par d’autres auparavant, la tension vers une implication directe du sujet.
 |
| Images de l’exposition La stanza di Mantegna. Ph. Crédit Finestre sull’Arte |
 |
| Images de l’exposition La stanza di Mantegna. Ph. Crédit Fenêtres sur l’art |
 |
| Images de l’exposition La stanza di Mantegna. Ph. Crédit Fenêtres sur l’art |
C’est dans ce sens qu’il faut lire l’Ecce Homo, vers lequel le visiteur est nécessairement attiré dès qu’il franchit l’entrée de l’exposition (qui occupe une seule salle). Le caractère profondément novateur de ce tableau, “l’un des chefs-d’œuvre les plus sublimes et les plus personnels de la dernière phase de la carrière de Mantegna” (Keith Christiansen), se manifeste par la simple observation de la corde autour du cou du Christ, qui égale les inventions d’Antonello da Messina (Messine, 1430 - 1479) et ajoute de la souffrance à la souffrance, mais l’artiste vénitien va encore plus loin, en éliminant totalement la figure de Ponce Pilate du tableau. Jésus n’est accompagné que de deux voyous dont la laideur crasse est une allégorie de la corruption de leur âme (un expédient typique de la peinture nord-européenne de l’époque) et qui sont modelés par le signe dur et tranchant de Mantegna, qui tend à ne pas admettre d’argument mais qui, ici, compte tenu de la chronologie tardive de l’œuvre, n’a rien à envier à celui de l’artiste. compte tenu de la chronologie tardive de l’œuvre (Christiansen a proposé une date, aujourd’hui largement acceptée, autour de 1500), pourrait suggérer que le peintre connaissait les études physionomiques de Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519). Le bourreau de gauche est une sorte de petit manifeste de la culture antiquaire d’Andrea Mantegna: il s’agit d’une vraisemblance du passé , mais non d’une exactitude (et c’est en substance ce que Berenson lui reprochait: avoir donné vie à une Rome rêvée et non à une Rome philologique, et c’est peut-être aussi pour cela que la rencontre avec la vraie Rome, à la fin du XVe siècle, a déçu l’artiste), et elle est illustrée par les inscriptions bizarres sur le turban du tortionnaire, qui ne sont pas écrites dans une langue connue, mais qui imitent l’hébreu. Le texte qui apparaît couvert par l’auréole de Jésus (sur la tête du personnage à l’arrière-plan: quatre personnes au total accompagnent Jésus, mais deux sont à peine visibles) est encore moins identifiable, tandis que les deux cartouches latéraux, qui portent la phrase “Crucifige eum, tolle eum, crucifige cruc.” (“Crucifiez-le, prenez-le, crucifiez-le !”) insérée sous forme de dessin humoristique pour évoquer les cris de la foule, sont faciles à lire. L’implication de l’observateur dans l’œuvre devient ainsi totale et synesthésique: la forte impression visuelle du demi-buste qui lui est présenté, presque comme si c’était l’observateur lui-même qui devait juger, à la place de Pilate absent de la scène, se combine à la suggestion auditive exercée par ces deux rouleaux placés aux angles du tableau.
Et c’est précisément l’absence de Pilate qui, pour Di Monte, constitue l’élément le plus choquant de l’œuvre. "L’Ecce Homo [...] ne représente pas Pilate présentant le Christ au peuple, mais au contraire le peuple présentant le Christ à Pilate. Et Pilate, à juste titre, n’est pas là, parce qu’il “est” de notre côté de l’image. L’ancien juge romain, qui a le pouvoir de vie et de mort, c’est nous, devant l’image. Chacun doit faire face à ses propres démons, dans sa propre chambre ou, comme Dante l’aurait mieux dit, dans la “chambre la plus secrète du cœur”. La demande de jugement est certes urgente, pressante, inévitable (et tout y contribue: l’absence étouffante de vides où se réfugier en détournant le regard, la douleur d’un Christ dont le corps porte encore les marques du fouet reçu peu avant, les bouches ouvertes des personnages louches qui l’accompagnent), mais le destin de Jésus semble inéluctable, puisque des gouttes de sang tachent déjà les cartouches (et c’est peut-être dans ce sang que se manifeste, s’il en est besoin, la présence de Pilate).
La comparaison sur le mur du fond est complétée par une œuvre datable d’une quarantaine d’années plus tôt (c’est-à-dire vers 1455): la Vierge à l’Enfant avec les saints Jérôme et Louis de Toulouse, qui se trouve depuis 1814 dans les collections d’un général de Brescia, Teodoro Lechi, dans une notice où elle est décrite comme suit: “la Vierge est représentée affligée, pensant peut-être aux souffrances futures du divin Fils qu’elle tient près de son sein: il est debout sur une petite table et il pleure. À droite, saint Jérôme habillé en cardinal. À gauche, un saint évêque habillé en moine, les épaules légèrement tournées. Les visages des deux sont mélancoliques. Au-dessus, un feston de fruits et de fleurs, et un horizon au loin”. Achevé chez le marchand Michelangelo Guggenheim, le panneau est ensuite vendu en 1887 à Édouard André et Nélie Jacquemart (précédant ainsi de quatre ans l’achat de l’Ecce homo, en 1891). Avec une autre Vierge à l’Enfant avec des saints, peinte dans les années 1990 et non présentée à l’exposition romaine, la Madone d’environ 1455 complète le noyau d’autographes de Mantegna dans la collection Jacquemart-André, particulièrement prisée par ceux qui fréquentaient leur résidence à Paris. Quant au tableau, qui a fait l’objet dans le passé de vicissitudes d’attribution complexes (Longhi, par exemple, voulait qu’il ait été peint en collaboration avec Bellini), plusieurs éléments ont conduit à le placer dans les années padouanes de Mantegna: le coussin posé sur la balustrade et la position de l’Enfant au regard triste (la balustrade de marbre et le coussin sont en fait une allégorie du sarcophage qui l’accueillera après la crucifixion: C’est aussi pour cela que la mère est triste) suggèrent que le goût pour une vue d’en bas en raccourci prédomine ici, tandis que le feston dans un goût clairement squarcionesque et le fait que deux saints érudits étaient en phase avec le milieu culturel padouan, animé par son université, sont d’autres éléments qui ne laisseraient pas beaucoup de doutes quant à l’époque de la réalisation. Mais la tendance à vouloir impliquer le spectateur est déjà précoce: la balustrade crée une barrière qui est cependant brisée par le coussin qui s’avance vers nous et par le lambeau des vêtements de saint Ludovic qui envahit notre espace, presque comme pour nous faire participer à la scène.
 |
| Andrea Mantegna, Ecce Homo (vers 1500 ; tempera sur toile montée sur panneau, 54,7 x 43,5 cm ; Paris, Musée Jacquemart-André) |
 |
| Andrea Mantegna, Vierge à l’enfant avec les saints Jérôme et Louis de Toulouse (vers 1455 ; tempera sur panneau, 69 x 44 cm ; Paris, Musée Jacquemart-André) |
Comme prévu, l’exposition est complétée par quatre œuvres. La première est un petit bronze d’Andrea Briosco dit Il Riccio (Trente, vers 1470 - Padoue, 1532) représentant un Moïse, qui suggère que, dans la Padoue de 1513 (l’œuvre a en fait été exécutée cette année-là pour le monastère de Santa Giustina dans la ville vénitienne: ), la tendance à vouloir fusionner les exigences de la religion chrétienne avec les instances païennes était loin d’être endormie, puisque Moïse nous est présenté avec les deux cornes classiques, attribut iconographique du prophète biblique par erreur (il est bien connu que saint Jérôme, dans sa Vulgate, à propos du visage de Moïse après la rencontre avec Dieu a traduit le mot hébreu karan par l’adjectif “cornu” au lieu de l’adjectif correct “radieux”, le confondant avec le terme keren, qui signifie en fait “cornu”), mais elles sont transformées, comme les critiques l’ont noté depuis longtemps, en cornes de bélier, symbole d’Amon (ou Ammon), une divinité de l’Égypte ancienne dont l’attribut le plus reconnaissable était une paire de longues cornes de bélier. Cette représentation a des raisons précises: à Rome, Amon était vénéré sous le nom de Jupiter Ammon, et la mythographie rapporte un épisode où il s’est transformé en bélier pour venir en aide à un Bacchus qui brûlait de soif dans le désert, parvenant à le guider hors de l’environnement inhospitalier (comme Moïse l’a fait avec le peuple juif). À côté de la statue du Hérisson apparaît, dans une position malheureuse puisque les visiteurs sont contraints par le cordon de sécurité de rester à une trop grande distance pour l’apprécier, un dessin de l’école de Mantegna: Hercule et Antée, une variante de l’un des sujets les plus reproduits de l’artiste vénitien (en effet, c’était “un sujet qui lui était cher depuis le début des années 1960”, précise Giovanni Agosti) car il était l’un des plus propices à l’étude du nu en mouvement et dans des poses difficiles, comme celle présentée sur cette feuille, qui nous montre un Hercule serrant avec force, dans une prise inconfortable, son malheureux rival dont la lutte est à la fois soulignée et dynamisée par la chevelure en mouvement et le drapé qui se soulève.
Sur le mur opposé, une douce Vierge à l’enfant de Cima da Conegliano (Conegliano, 1459/1460 - 1517/1518) et un Portrait d’homme de Giorgio Schiavone (de son vrai nom Juraj Ćulinovi&cacute ;, Scardona, 1433/1436 - Šibenik, 1504) clôturent l’exposition. La Madone de Cima, modelée sur les exemples de Bellini, est révélatrice de la relation entre Bellini lui-même et Andrea Mantegna (les deux étaient beaux-frères et leurs liens artistiques et personnels sont explorés pour la première fois dans une exposition à la National Gallery de Londres au tournant de l’année 2018-2019): le panneau, écrit Giovanni Carlo Federico Villa, exprime “une monumentalité d’ensemble accompagnée par la simplicité de la draperie et encore une certaine naïveté structurelle, non résolue le raccourci des jambes de l’Enfant, excessivement maladroites et gonflées” (il convient de souligner qu’il s’agit d’une œuvre de jeunesse de l’artiste vénitien, exécutée alors que Cima avait une trentaine d’années). Enfin, le portrait du Croate Ćulinovi&cacute ; est destiné à évoquer le milieu humaniste de la fin du XVe siècle à Padoue: Déjà exposé dans la section padouane de la grande exposition Mantegna de 2006 (qui s’est tenue à Mantoue, Padoue et Vérone), le portrait viril sur parchemin de Schiavone, caractérisé par un naturalisme extrêmement intense et un relief presque plastique (il suffit de regarder les détails des yeux et de l’oreille, qui semblent presque émerger du support de parchemin), perpétue une tradition (celle de l’art de l’art de la peinture) qui est celle de l’art de la peinture. Elle perpétue une tradition (celle des portraits sur parchemin) qui remonte au Moyen-Âge et qui visait à envelopper le portrait de la personne représentée de profondes références symboliques, le parchemin ayant été pendant longtemps le principal support de l’écriture, mais nous n’avons pas d’informations certaines sur l’usage auquel cette œuvre était destinée. En d’autres termes, nous ne savons pas s’il s’agit d’un portrait stricto sensu ou d’une feuille insérée dans un codex.
 |
| Andrea Briosco dit Riccio, Moïse (1513 ; bronze, 49,8 x 21 cm ; Paris, Musée Jacquemart-André). Ph. Crédit Studio Sébert Photographes |
 |
| École de Mantegna, Hercule et Antée (XVIe siècle ; encre sur papier, 29,4 x 18 cm ; Paris, musée Jacquemart-André). Ph. Crédit Studio Sébert Photographes |
 |
| Giovanni Battista Cima da Conegliano, Vierge à l’enfant (1490-1492 ; huile sur panneau, 44 x 33 cm ; Paris, musée Jacquemart-André). Ph. Crédit Studio Sébert Photographes |
 |
| Giorgio Schiavone, Portrait d’homme (vers 1460 ; tempera sur parchemin monté sur panneau, 37,7 x 29,8 cm ; Paris, musée Jacquemart-André). Ph. Crédit Studio Sébert Photographes |
Une caractéristique qui ne ressort pas de l’exposition, mais qu’il est néanmoins important de souligner, est que les acquisitions d’Édouard André et de Nélie Jacquemart sont une conséquence de la redécouverte de Mantegna qui a fasciné les collectionneurs en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le noyau Mantegna est donc l’un des plus anciens de leur collection et a commencé à se former alors que les deux époux étaient jeunes mariés: L’achat de la Vierge à l’Enfant non présentée dans l’exposition date de 1881, année de la célébration du mariage le 30 juin, et dans les cinq ans qui suivirent, le couple s’était procuré trois précieuses copies antiques de trois scènes peintes à fresque par le génie vénitien dans l’église des Eremitani à Padoue, et, comme nous l’avons déjà mentionné, l’achat de la Vierge à l’Enfant avec les saints Jérôme et Ludovic de Toulouse date de 1887. Il fallut donc dix ans (l’Ecce Homo, déjà mentionné, entra dans la collection en 1891) pour compléter la partie Mantegna qui, lorsque le musée italien de Jacquemart-André fut ouvert au public en 1913 après la mort de Nélie, fut largement salué par la critique, dans un climat de vif renouveau, puisque trois ans auparavant le Louvre avait acquis le célèbre Saint-Sébastien.
L’importance du musée résonne dans les mots utilisés par le critique Georges Lafenestre, dans un article de poids publié dans la Gazette des Beaux-Arts au lendemain de l’ouverture du musée de Nélie et Édouard, pour décrire la collection “par le nombre, la variété et la qualité des objets qui la composent, elle est, depuis la donation du château de Chantilly et du musée Condé par le duc d’Aumale, le plus magnifique legs d’œuvres d’art qu’un patriotisme éclairé ait pu faire à notre pays pour la jouissance et l’instruction de tous ceux qui aiment, étudient, pratiquent ou protègent les arts”. Et Lafenestre lui-même n’a pas manqué de louer, dans ses écrits, la section du musée consacrée à Mantegna, auquel pas moins de trois pages sont dédiées, s’ouvrant sur des tonalités particulièrement emphatiques: "mais nous voici devant le véritable maître de l’Italie du Nord, le puissant Andrea Mantegna. Trois œuvres, deux Madones et un Ecce Homo, dans un état de conservation et de valeur inégalé, portent sa marque: un réalisme énergique, parfois impitoyable, brutal, presque pédant, mais toujours justifié et ennobli par une intelligence vraiment ancienne de la beauté humaine dans ses formes animées et, en outre, par une sensibilité d’observation plus touchante qu’on ne pourrait le croire, puisqu’il admire et analyse, avec une délicatesse visible et sympathique, les gestes et les physionomies spontanés des femmes et des enfants".
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.