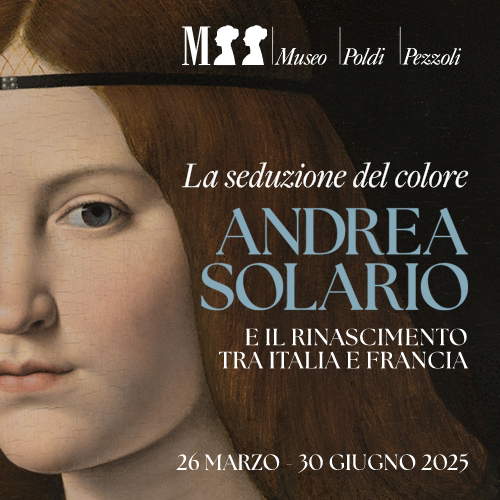Égypte, découvertes extraordinaires au Ramesseum : tombes, réserves et première école de l'Égypte ancienne
Louxor n’en finit pas d’étonner. La récente campagne de fouilles autour du temple de Ramesseum a mis en lumière de nouvelles preuves surprenantes de l’intense vie religieuse, économique et administrative de l’Égypte ancienne. Les fouilles ont été menées par une mission archéologique franco-égyptienne composée du secteur de la conservation et de l’enregistrement du Conseil suprême des antiquités, du Centre national de recherche français et de l’université de la Sorbonne. La zone concernée est située sur la rive ouest du Nil, où se dresse le célèbre temple funéraire dédié au pharaon Ramsès II (vers 1303-1213 av. J.-C.), également connu sous le nom de “temple des millions d’années”.
L’une des découvertes les plus importantes est l’identification de la “Maison de la vie”, une école scientifique rattachée aux grands temples de l’Égypte ancienne. Les fouilles à l’intérieur du temple ont révélé la structure architecturale de l’institution et une collection d’objets liés à l’éducation, tels que des dessins et des jeux scolaires. Il s’agit de la première preuve tangible de l’existence d’une école au sein du Ramesseum, ce qui témoigne du rôle central du temple en matière d’éducation.

Un centre administratif et de production
Les découvertes ne se limitent pas à la zone éducative. Sur le côté est du temple, un nouveau groupe de bâtiments est apparu, dont on suppose qu’il servait de bureaux administratifs. Les recherches se poursuivent pour clarifier la fonction spécifique de ces structures, mais leur disposition suggère une gestion centralisée des activités religieuses et économiques du complexe.
Plus éloquentes encore sont les découvertes du côté nord, où des entrepôts pour le stockage de l’huile d’olive, du miel et des graisses ont été découverts, ainsi que des caves à vin. De nombreuses étiquettes de jarres retrouvées sur le site témoignent d’un stockage et d’une distribution intensifs de denrées alimentaires. Des ateliers de tissage et de travail de la pierre, des cuisines et des boulangeries ont également été découverts dans la région, complétant l’image d’un établissement pleinement opérationnel. La présence de ces installations renforce l’hypothèse selon laquelle Ramesseum était un véritable centre névralgique de la vie sociale et économique de la région.

Un cimetière et la redécouverte de Sahhotep Ib Ra
Un vaste complexe funéraire datant de la troisième période intermédiaire est apparu dans la région nord-est du site. Les tombes contenaient des chambres funéraires, des puits, des jarres canopes bien conservées, des ustensiles, des cercueils emboîtés, 401 figurines d’ushabti en céramique et une collection d’ossements humains. Ces éléments enrichissent notre connaissance des pratiques funéraires et de l’organisation sociale de l’époque.
Dans une zone adjacente, sur le côté nord-ouest du temple, a été redécouverte la tombe de Sahhotep Ib Ra, déjà identifiée en 1896 par l’archéologue anglais James Quibell et datant du Moyen Empire. Des scènes de funérailles du défunt sont représentées sur les murs intérieurs, confirmant la valeur historique et rituelle du monument.


Un patrimoine complexe : le Ramesseum avant et après Ramsès II
Les découvertes récentes offrent également de nouvelles perspectives sur l’évolution historique du Ramesseum. Mohamed Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, explique que des études scientifiques ont montré que le site était déjà occupé avant la construction du temple par Ramsès II. Plus tard, après avoir été pillé, il a été transformé en cimetière pour les prêtres, puis réutilisé comme base d’opérations par les carriers des périodes ptolémaïque et romaine.
Le temple de Ramesseum n’était donc pas seulement un lieu de culte. Son rôle incluait des fonctions administratives, économiques et politiques. Selon Ismail, le site était un point de redistribution des biens produits ou stockés dans les entrepôts et les ateliers situés à l’intérieur, biens qui étaient ensuite destinés à la population, notamment aux artisans de Deir el-Médineh. En plus des fouilles, la mission a réalisé d’importants travaux de restauration. Tout le côté sud du temple, de la salle hypostyle au Sancta Sanctorum, a été restauré. Une attention particulière a été portée à la statue de Tuya, mère de Ramsès II, dont les fragments ont été replacés à leur emplacement d’origine, au sud de la statue du roi. Les parties conservées de la statue de Ramsès II ont également été restaurées, en particulier les jambes, qui ont été repositionnées sur la base reconstruite. Une étude a également été menée sur l’état général de la statue.
Le palais royal et les audiences du souverain
Christian Leblanc, chef de la mission française, a illustré les travaux réalisés sur le palais royal adjacent à la première cour du temple. Les investigations ont permis d’identifier le plan originel du palais, qui comprenait une salle de réception et une salle du trône où Ramsès II recevait les dignitaires. Aujourd’hui, il ne reste que quelques bases de colonnes, mais la reconstitution architecturale est rendue possible par les murs en briques crues qui formaient la structure d’origine.
Parmi les découvertes faites, on trouve une partie du linteau en granit de la porte du deuxième pilier, sur lequel Ramsès II est représenté comme une divinité en présence d’Amon-Rê. À proximité, les vestiges d’un cadre décoré d’une frise représentant des singes, faisant probablement partie d’un récit mythologique, ont été mis au jour. La mission a également enlevé des débris le long des chemins de procession du temple, mettant au jour des vestiges de la Troisième Période Intermédiaire. On a découvert que l’une des rues était ornée de statues d’Anubis représentées allongées sur de petites châsses. Plusieurs de ces fragments ont été collectés et restaurés, donnant une image plus complète de la sacralité du site. La mission franco-égyptienne travaille sur le temple du Ramesseum depuis 1991, avec une continuité rare sur la scène archéologique internationale. En 34 ans d’activité, les fouilles systématiques, les études et les restaurations ont transformé la compréhension du site, restituant à l’histoire un temple vivant et dynamique, capable de révéler encore aujourd’hui de nouveaux aspects de la civilisation égyptienne.
 |
| Égypte, découvertes extraordinaires au Ramesseum : tombes, réserves et première école de l'Égypte ancienne |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.