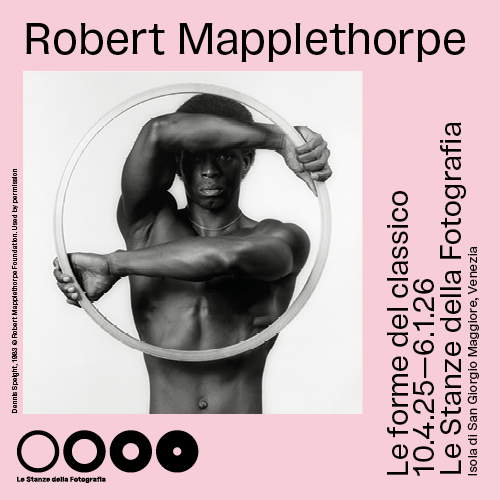Découverte des premiers génomes anciens du Sahara vert : l'humanité isolée pendant des milliers d'années
Il y a sept mille ans, alors que le Sahara était encore une étendue verte et fertile, un groupe humain isolé habitait l’actuelle Libye, sans contact avec les populations subsahariennes. C’est ce que révèle une nouvelle étude basée sur l’analyse de l’ADN de deux individus naturellement momifiés découverts dans l’abri sous roche de Takarkori, dans le Sahara central. Les résultats, publiés par une équipe internationale de chercheurs de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne, redéfinissent l’histoire génétique de l’Afrique du Nord, en montrant que la région n’était pas un passage migratoire entre le nord et le sud du continent, comme on le supposait auparavant.
Les échantillons génétiques, parmi les plus anciens jamais prélevés dans la région, ouvrent une fenêtre inédite sur la vie durant la période dite humide de l’Afrique (entre 14 500 et 5 000 ans), lorsque le Sahara était sillonné de rivières et parsemé de lacs, ce qui favorisait la présence humaine et l’expansion du pastoralisme. La désertification qui a suivi a fait de la région le plus grand désert du monde, ce qui a rendu la préservation du matériel génétique exceptionnelle.
“Nos résultats suggèrent que les premières populations d’Afrique du Nord étaient largement isolées, mais qu’elles ont reçu des traces d’ADN néandertalien en raison d’un flux génétique provenant de l’extérieur de l’Afrique”, a déclaré Johannes Krause, directeur de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste et auteur principal de l’étude.
“Nos recherches remettent en question les hypothèses antérieures sur l’histoire de la population nord-africaine et soulignent l’existence d’une lignée génétique profondément enracinée et isolée depuis longtemps”, affirme Nada Salem, premier auteur à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutionniste. "Cette découverte révèle comment le pastoralisme s’est répandu dans le Sahara vert, probablement par le biais d’échanges culturels plutôt que de migrations à grande échelle.
“L’étude souligne l’importance de l’ADN ancien pour reconstruire l’histoire de l’humanité dans des régions telles que l’Afrique centrale du Nord, en apportant un soutien indépendant aux hypothèses archéologiques”, poursuit David Caramelli, auteur principal à l’université de Florence.
“En faisant la lumière sur le passé profond du Sahara, nous visons à accroître notre connaissance des migrations humaines, des adaptations et de l’évolution culturelle dans cette région clé”, a ajouté Savino di Lernia, auteur principal à l’université Sapienza de Rome.



Une lignée séparée par plus de 50 000 ans
Les analyses génomiques indiquent que les individus de Takarkori appartenaient à une lignée génétique nord-africaine distincte qui s’est séparée des populations subsahariennes il y a environ 50 000 ans, c’est-à-dire au moment où les humains modernes ont commencé à se répandre hors d’Afrique. Cette lignée est restée génétiquement isolée jusqu’à la période humide africaine, ce qui suggère une continuité génétique dans la région pendant des milliers d’années. Bien que cette lignée génétique n’existe plus aujourd’hui sous sa forme originale, elle reste un élément central du patrimoine génétique des populations nord-africaines. Cette découverte révèle que l’histoire génétique de l’Afrique du Nord est beaucoup plus complexe et stratifiée qu’on ne le pensait auparavant.
Contrairement à l’idée répandue selon laquelle le Sahara vert a favorisé le mélange entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, l’étude montre que les flux génétiques entre ces deux régions sont restés limités. Les individus analysés ne présentent aucune trace d’ascendance subsaharienne, ce qui réfute l’hypothèse du Sahara comme pont migratoire entre les deux macro-régions africaines. La diffusion du pastoralisme au Sahara, selon les chercheurs, ne se serait pas faite par le déplacement de populations, mais par un transfert de connaissances culturelles et technologiques. Cette découverte minimise donc le rôle des migrations dans la diffusion des innovations en Afrique du Nord préhistorique.
Liens avec les chasseurs-cueilleurs de l’ère glaciaire
Un autre élément clé qui ressort de la recherche est le lien génétique entre les individus de Takarkori et les chasseurs-cueilleurs qui vivaient au Maroc il y a 15 000 ans sur le site de Taforalt. Ces derniers étaient associés à l’industrie lithique ibéromaurusienne, une culture préhistorique antérieure à la période humide africaine. Les deux groupes sont également éloignés des populations subsahariennes, ce qui confirme que malgré le climat favorable du Sahara vert, les deux régions sont restées génétiquement séparées.
L’étude apporte également de nouvelles informations sur la relation entre les premiers Nord-Africains et les Néandertaliens. L’analyse de l’ADN montre que les individus de Takarkori possédaient dix fois moins de matériel génétique néandertalien que les populations non africaines actuelles, mais plus que les populations subsahariennes contemporaines. L’étude marque donc une étape fondamentale dans la compréhension de la dynamique humaine dans le Sahara préhistorique. La découverte d’une lignée génétique restée isolée pendant plus de 50 000 ans et la confirmation d’une faible interaction avec l’Afrique subsaharienne appellent à une révision des théories sur les migrations dans cette région.
 |
| Découverte des premiers génomes anciens du Sahara vert : l'humanité isolée pendant des milliers d'années |
Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.